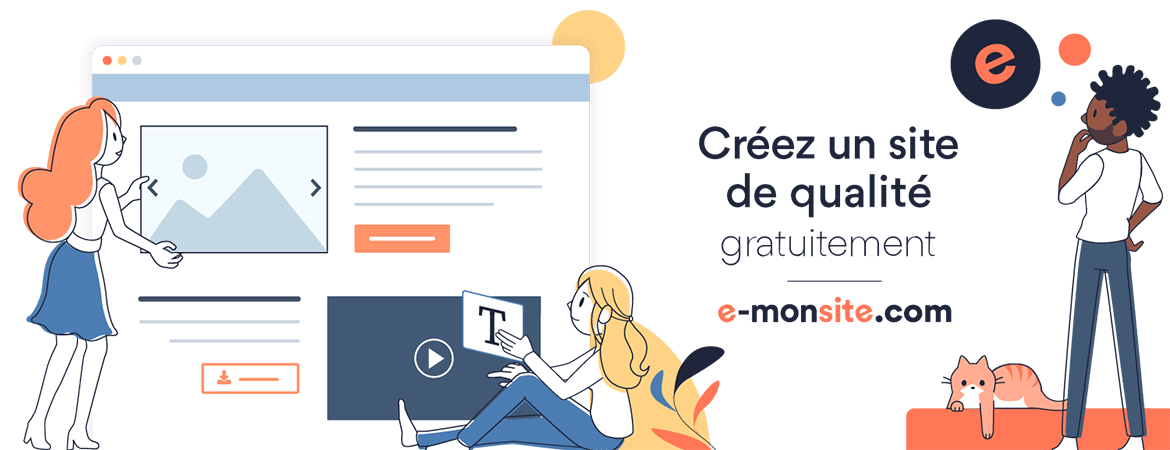- Accueil
- L'origine de l'Église
- L'histoire de l'Église
- symbol du pain
- Suite multiplication des pains
Suite multiplication des pains
Être ému de compassion.
Qu’en Jésus fut descendu de la barque il est dit :
« Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger ».
Comme la bonté, la compassion de Dieu tient une bien plus grande place dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau Testament car, dans celui-ci, c’est l’amour qui est toujours au premier plan et tout le reste lui est subordonné (voir Deutéronome 30.3 ; 2 Samuel 24.14 ; Psaumes 79.8 ; Psaumes 103.13 ; Psaumes 103.14 ; Psaumes 116.5 ; Psaumes 119.77 ; Psaumes 119.156 ; Ésaïe 54.8 ; Jérémie 12.15 ; Lamentations 3.22 ; Daniel 9.18 ; Osée 14.3 ; Romains 12.1 ; Jacques 5.11).
La compassion de Dieu est sa bonté qui s’émeut à la vue de la souffrance et de l’angoisse des hommes. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il connaît notre faiblesse, II compatit à nos douleurs.
Mais trop souvent, on donne à la compassion une connotation religieuse. S’il en est ainsi, c’est parce qu’elle occupe une place très importante dans la plupart des religions et des textes qui s’y rattachent. Bouddha et Jésus, en particulier, en ont fait le fondement de leur philosophie. Si je dis « philosophie », c’est parce que cette vertu ne constituait pas pour eux un point de doctrine, mais un idéal de comportement envers ceux qui souffrent ou sont dans le besoin. Ainsi la compassion est à la basse de deux grandes religions : le bouddhisme d’une part et le christianisme de l’autre. Vu sous cet angle, il n’est nul besoin d’avoir la foi pour compatir à la souffrance d’autrui et agir pour essayer de la soulager ou de la faire disparaître. Il suffit, si l’on peut dire, d’être humaniste, et en quelque sorte L’humanisme en religion apparaît avec le Nouveau Testament car dans ce dernier Dieu lui-même se fait homme et meurt pour les hommes. N’est ce pas de l’humanisme ?
À ses disciples qui lui demandent de formuler clairement son message, Jésus répond : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu, 22, 37-39)
Cependant les rapports entre le christianisme et l’humanisme sont restés complexes du fait de la diversité des interprétations de la formule « aimer son prochain ». En effet chacun interprète à sa manière comme cela l’arrange cet enseignement central de Jésus. Car peut de temps avant de dire cela Jésus dit aussi : « rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », cela est pour certain une invitation à séparer le registre divin et le registre des humains. Alors que Jésus disait simplement que seul Dieu doit être le sujet d’un culte car pour les Romains César Empereur des Romains, était une divinité et ils lui rendaient un culte qui doit revenir à Dieu seul. Est venu ensuite Paul de Tarse fondateur historique du christianisme, qui exhorte : « ne vous conformez pas au siècle présent » (Romain 12,12), trop vite compris et interprété comme quoi le chrétien doit s'immerger dans le monde sans jamais en partager les valeurs. Et dès les premiers siècles, les Pères de l'Église combattront ceux qui remettront en cause, par-delà « le mystère de l'incarnation », ce que celui-ci recouvre, le caractère indissociable des commandements : aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même, qui est indissociable de la vertu de la compassion.
Nous aimerions alors répondre qu’assurément le christianisme est un humanisme. Car le contraire de l’humanisme, c’est la barbarie et les actualités nous en décrivent hélas les faits au quotidien. Or au cœur de l’expérience chrétienne demeure un héritage, celui de la Loi de Moïse : « Tu ne commettras pas de meurtre. » Pas plus qu’il n’est permis de mettre la main sur Dieu, « rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César » il n’est loisible d’attenter à la personne humaine créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. L’humanisme est d’ailleurs toujours hanté par cette figure de la barbarie, que l’on voit transparaître dans l’Ancien Testament comme dans la considération d’une énigme : l’homme, un peu moindre qu’un Dieu, est cependant capable de monstruosité. Delà à refouler le fait dans le subconscient et l’attribuer à un ange déchut à un diable ou à satan ce caractère démoniaque il n’y a qu’un pas qui fut vite franchi par les pères de l’Église puisqu’ils rejetaient et condamnaient en bloc l’idée que l’être humain peut être libre et responsable de ses actes qui sont le fondement de l’humanisme.
Suite aux pères de l’Église, et aux mauvaises interprétations des épîtres de Paul, le christianisme a progressivement élaboré un discours doctrinal sur l’homme. Une théologie de la création voyait en l’homme, être de mémoire, d’intelligence et de volonté, située dans un cosmos harmonieux et hiérarchisé, une image de Dieu, encore à l’ébauche. Une théologie de l’incarnation affirmait que cette image déjà esquissée trouvait sa parfaite réalisation dans le Christ, dont la nature humaine était intimement liée à la personne du Verbe éternel de Dieu. Figure humanodivine quasi mythologique, le Christ, nimbé de toutes les vertus de la perfection, était présenté comme le modèle d’une vie entièrement accomplie, ordonnée au souverain bien. Si on a vu émerger au Siècle des lumières un humanisme chrétien, animé d’une confiance en la nature humaine, le christianisme a également été hélas traversé par des courants antihumanistes, un Pascal par exemple, nourris tout particulièrement de la lecture d’Augustin. L’antihumanisme n’est cependant pas le contraire de l’humanisme, mais il correspond à une certaine manière de concevoir l’humanisme, animé par le refus de l’anthropolâtrie et de l’affirmation d’une totale autonomie de l’homme. L’antihumanisme est somme toute un humanisme traversé par le sentiment tragique de la vie et habité et hanté par la peur que plus on invite l’homme à se tenir debout, plus on l’invite à se passer de Dieu.
Les populismes font sans cesse référence au peuple. Mais il s’agit d’un peuple essentialisé, porteur d’une vérité unique voire d’une âme, fondée, certes non plus sur une conception biologique de « la race pure » (c’est encore vrai pour certains groupes néofascistes), mais sur une « identité commune », qui peut être une « identité nationale » et/ou un dogme religieux. Cette « identité » peut fluctuer en matière d’échelle qui peut aller de la nation à l’Europe, de l’Occident à des visions fondamentalistes de la chrétienté, de l’islam ou de la judaïté. Elle se nourrit de l’histoire coloniale et esclavagiste qui a construit les pseudo-théories antihumanistes, de l’inégalité des « races » et/ou des « civilisations ». Elle définit un « nous » contre tous les autres, qu’il s’agisse des pays étrangers dans le monde ou des ennemis de l’intérieur, ces « immigrés », ces « étrangers », ces « pas de chez nous », constitués en boucs émissaires de tous les maux du peuple alors qu’ils en sont partie intégrante. En cela le populisme est une forme d’antihumanisme.
Mais que peut-il rester de l’humanisme, après Verdun, Hiroshima, Auschwitz ? Qu’est-ce qu’être chrétien, juif, musulman, athée ou libre penseur, à quoi bon vouloir donner une définition de l’homme, si on est inhumain ? Désormais, s’il y a encore un défi de l’humanisme, ce serait alors celui de s’abandonner au risque de l’autre, en délaissant tout modèle d’humanité et toute théorie du sujet, pour éprouver en chaque individu la valeur de l’humain, la rareté sans prix de ce qui n’existe jamais qu’en un seul exemplaire et qui, à ce titre, est digne d’un infini respect. L’humanisme est donc antipopulisme.
À ce point, il peut être bon d’en revenir à Jésus, en son absolue singularité de prophète galiléen et de maître de sagesse. Un Jésus ouvert à la transcendance, en une familiarité avec un Dieu qu’il appelle papa ; dans une intériorité qui le rend entièrement présent à soi ; en une présence au monde qui l’établit dans une disponibilité permanente à la rencontre d’autrui, aussi inattendue soit-elle. Jésus, non plus comme un modèle éthique ou comme l’idéal d’une humanité régénérée, mais un homme comme personne, celui qui : « fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger ».
Comme nombre de vertus, la compassion n’est donc pas un sentiment religieux, d’ailleurs beaucoup de religieux dans l’histoire en manquèrent terriblement et certains en manquent toujours terriblement. La compassion n’est pas le monopole du christianisme. La compassion s’inscrit dans une démarche philosophique et humaniste. Il est évident que si cette vertu était plus répandue parmi les hommes, le monde serait infiniment meilleur. Il faudrait pour cela que chacun se sente concerné par le bien-être et le bonheur des autres, sans distinction de race, d’ethnie, de nationalité, de culture, ou de tout autre élément apparemment distinctif. Malheureusement, depuis que le monde est monde il a toujours des causes qui font que les êtres humains ont peur. Si ce n’est plus trop maintenant la peur du peuple voisin, c’est celle de la venue d’étrangers dans notre environnement, la crise économique et sociale à laquelle nombre de pays sont aujourd’hui confrontés depuis plusieurs années qui tendent à rendre les gens plutôt individualistes et nationalistes, deux comportements qui sont facteurs de discrimination et d’exclusion, attitudes peut compatibles avec la compassion.
Peut-être dans un souci d’être ou de paraître laïques, certaines personnes préfèrent parler d’empathie plutôt que de compassion, notion à laquelle elles attribuent (à tort) un caractère religieux. Pourquoi pas, puisque le mot « empathie » a pour définition « faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce qu’il ressent ». Cela étant, il me semble que le terme « compassion », qui se définit comme le « sentiment qui porte à plaindre et à partager les maux d’autrui », est à la fois plus précis et plus évocateur. Il s’agit en effet de ressentir les difficultés, les peines et les souffrances des autres, et de leur venir en aide si on le peut.
Une remarque : il ne faut pas confondre « compassion » et « apitoiement ». En effet, s’apitoyer sur le sort d’autrui traduit souvent une certaine forme de condescendance à son égard, comme si celui-ci était d’une condition inférieure ou dans une position moins élevée. Lorsque l’on compatit sincèrement à la situation d’une autre personne, on se projette en elle, d’égal à égal, de cœur à cœur. Il n’y a donc aucun jugement de valeur en ce qui la concerne, mais simplement le désir réel de partager son affliction, et si possible de l’assister.
Il est difficile pour l’être humain ordinaire c’est-à-dire vivant sans spiritualité d’avoir de la compassion car chez ces gens la peur du lendemain, des autres, des peurs souvent non fondées l’emportent toujours sur la compassion. Notre système vital soumis à notre conscience de soi, est fait de telle manière que nous avons ce magnifique attribut selon lequel lorsque nous prenons soin les uns des autres, cela apporte d’immenses bénéfices pour notre santé physique et mentale. Mais, à l’autre bout dans notre conscience soumise à notre ego, notre conscience anthropocentrique, nous avons un désir clanique d’être avec des gens qui nous ressemblent, car cela nous rassure. Si notre conscience ne peut s’élever vers une conscience supérieure mais reste comme « au ras des pâquerettes » cela peut causer beaucoup de stress, de peur et d’anxiété chez ces personnes. Comme nous le voyons en ce moment avec les populistes en Europe ou aux États-Unis, ces peurs peuvent être manipulées à des fins politiques qu’en ce ne sont pas les politiques qui, par souci électoral mènent eux-mêmes une politique populiste ségrégationniste. Cela résulte en un manque de compassion et une sorte de tribalisme selon lequel nos problèmes sont la faute des autres, de ceux « qui ne sont pas comme nous ». Dans notre monde actuel, la seule manière pour que notre espèce humaine survive aux défis futurs, ce n’est pas la division. C'est la reconnaissance que nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous des préjugés, et cela est un fait, et n’a nul besoin d’être prouvé scientifiquement. Mais si l’humain que nous sommes tous, arrive à reconnaître ce biais cognitif par la religion ou la spiritualité, si l’être humain parvient à élever son humanisme, il peut alors modifier son comportement pour en exclure la peur, le stress et l’anxiété. C’est seulement de cette manière que nous pouvons manifester le meilleur qui est en nous, et c’est le chemin qu’a choisi ici le Christ, et que les auteurs des évangiles nous invitent à suivre.
Jésus nous enseigne comme il enseigna cette foule, sur le comment manifester le meilleur de nous dans une société libéralisée qui encourage plutôt l’individualisme et la compétition qu’elle ne promeut des valeurs comme l’altruisme et la compassion ?
Car le problème ne réside pas dans le fait de vouloir être le meilleur, mais lorsque vous essayez d’être le meilleur au détriment d’autrui au détriment de son prochain pour reprendre les paroles de Jésus. On peut l’être sans heurter les autres. C’est l’un des défis pour l’être humain et je dirais pour chaque être humain venant au monde et durant toute sa vie, seulement très peut encore y parviennent. On dit souvent « je veux la paix » et c’est encore l’ego qui parle. Débarrassez-vous du « je » et du « vouloir » et il vous restera la paix et cela est bien suffisant. Si vous ouvrez votre cœur, comme Jésus dans les Évangiles, pour être utile aux autres, ils viendront vers vous, comme ces 5 000 personnes sans bergers dans notre récit, sans bergers, donc sans guide et pourtant elles sont là, elles sont venues écouter Jésus. Il faut comme ces personnes réussir à changer d’état d’esprit et ne pas se dire « je peux gagner » mais « gagnons ». On ne peut y arriver qu’en changeant notre manière de regarder le monde, et quoi de mieux pour cela de s’élever spirituellement un peu plus ; alors : « Il se mit à les enseigner ».
Il est évident que ce n'est pas à nous webmasters de ce site de donner un label ou le titre de « bon chrétien » et encore moi d'excommunier qui que ce soit !
Nous pensons que c'est à chacun de se situer en conscience de ses choix politiques en adéquation avec ses convictions religieuses ou spirituelles. Or, il y a aujourd’hui des populistes qui s'affirment chrétiens. Je ne peux pas mettre en doute la qualité de leur foi religieuse…
Mais je crois aussi justifié de les aider à réfléchir sur la cohérence de leurs choix. Le fait de systématiquement faire des étrangers les boucs émissaires de tous les problèmes et de tous les mots de notre pays, de nos sociétés, me semble par exemple être un raccourci populiste dangereux et qui plus est ne pas être compatible avec la compassion et les valeurs chrétiennes d'universalité et de respect de la personne humaine, indépendamment de son origine. Dans notre miracle de la « multiplication des pains » Jésus à partager les pains et les poissons avec tous, il n’a pas dit : « pour les non juifs débrouillez-vous ». Le côté provocateur des leaders politiques de ces partis dit populistes, devrait aussi poser un problème de conscience aux membres qui se disent « chrétiens » et se réclamant de tels partis ! Enfin, la défense des "valeurs chrétiennes" que ces partis utilisent maintenant comme thème de propagande, notamment pour se positionner contre l'Islam est une tentative de récupération identitaire du christianisme fort dangereuse !
Psaume 26 :
« 3 Car ta grâce est devant mes yeux, Et je marche dans ta vérité. 4 Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, Je ne vais pas avec les gens dissimulés ; 5 Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, Je ne m'assieds pas avec les méchants. »
La multiplication des pains et la Manne dans le désert.
« La Manne » n'apparaît que dans une situation biblique particulière. Et s'il est présent 13 fois dans la Bible hébraïque, c'est toujours en lien avec le même épisode, ou plutôt la même période de l'histoire biblique : celle des quarante années de pérégrinations des Hébreux au désert, après leur sortie d'Égypte, et avant leur entrée en Canaan.
Au chapitre 16 du livre de l'Exode, Moïse et Aaron à leur tête, les Hébreux sont donc dans le désert après avoir quitté l'Égypte et franchi la mer des Roseaux. Avec Matthieu 14:13 : « A cette nouvelle, (la mort de Jean-Baptiste) Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert ; et la foule, l'ayant su, sortit des villes (symbole de l’Égypte) et le suivit à pied. »
Comme le peuple hébreu suivait Moïse pourrait-on dire.
“Alors – nous dit le texte (versets 2 à 4)– toute la communauté des Israélites se mit à maugréer, dans le désert, contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent : « Ah! Si nous étions morts de la main du SEIGNEUR en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! C'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert !»”
Dans notre texte ce n’est pas le peuple qui ce plein mais les disciples Marc 6 : « 35 Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; 36 renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger.… »
« L’heure est déjà avancée » fait penser à ce qu’il était maintenant trop tard pour agir.
Or cette nourriture qui vient quotidiennement du ciel ne peut s'amasser dans des greniers on ne peut la capitaliser. On ne peut pas en prendre plus qu'on en a besoin pour la stocker ou la revendre. C'est un pain quotidien, et il faut avoir confiance qu'il arrivera encore demain... et après-demain. Il faut donc faire confiance à ce Dieu qui conduit le peuple au travers du désert.
D'ailleurs, quand certains cherchent à accumuler plus que leur ration journalière, alors les vers s'y mettent, et ce qui était un don du ciel devient une puanteur...
Dans le Nouveau Testament, un seul passage biblique semble, à première lecture, dévaloriser la manne, au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Après la distribution des pains à une grande foule au bord du lac de Tibériade, une polémique s'engage à la synagogue de Capharnaüm. Jésus vient en effet de produire un signe dans lequel beaucoup ont vu à juste titre un écho du don de la manne au désert. Jésus serait-il donc sur le même plan que Moïse ? Jésus est interpellé (v. 31 à 32) :
« Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur donna à manger du pain venu du ciel. Jésus leur dit : «Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel ; car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde.»
Quelques versets plus loin nous lisons (v. 49 à 51) :
«...Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours ; et le pain que, moi, je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde.»
Dans cette polémique, Jésus se présente donc lui-même comme la nouvelle manne universelle. La manne est donc ici comprise d'un point de vue chrétien comme une préfiguration du Christ (dans un sens proche, on pourra lire 1 Corinthiens 10,1-5).
Mais, depuis le début de cet article, nous utilisons ce mot “manne” sans avoir dit d'où vient ce nom étrange... de notre récit bien sûr (v. 31) :
“La maison d'Israël appela du nom de manne cette nourriture.”
Nous voilà bien avancés !
Pour comprendre, il nous faut revenir quelques versets auparavant, quand les Israélites découvrent cette chose nouvelle et inconnue et qu'ils se disent l'un à l'autre : «Qu'est-ce que c'est ?» En effet, en hébreu “Qu'est-ce que c'est ?” se dit MaN HOu “littéralement "Quoi ça ?".
Les Israélites disent donc «c'est quoi ça ?» MaN HOu “et ils finissent par appeler cela MaN.
Ainsi, le mot manne que nous utilisons en français est la contraction d'une phrase interrogative en hébreu : “Quoi ?”. La manne c'est “quoi ?”. Ce nom étrange ne témoigne-t-il pas de la difficulté des humains à accueillir les dons de Dieu dans la confiance ? Ainsi quand nous lisons ce texte de la multiplication des pains et que nous nous posons cette question : C’est quoi ça ?, c’est quoi cette histoire de pain de vie ?
Dans le second récit, le contexte est tout différent puisque le miracle s'opère après trois jours d'enseignement de Jésus (la nourriture arrivant au bout de trois jours évoque évidemment la résurrection et l'eucharistie). On apprend que ceux qui l'ont suivi pour entendre leur enseignement arrivent pour certains de très loin, nous sommes sur les rives du Lac de Galilée au "carrefour des nations", et on est en droit de supposer que juifs et païens se mêlent parmi ceux qui sont là au moment du miracle. Il suffit par exemple de revenir quelques versets en arrières dans l'évangile de Marc pour remarquer l'épisode de la païenne et des miettes de pain qui tombent de la table pour les chiens. Nous sommes juste avant la seconde multiplication des pains, et on peut largement supposer que cette païenne, comme d'autres, a continué de suivre Jésus ensuite pour partager les 7 pains de la deuxième multiplication. Les 4000 personnes sont une indication d'universalité, là encore, et évoquent la multitude parvenue des 4 coins de la terre (4 * 1000).
Il y a donc de fortes probabilités pour qu'il y ait une impossibilité événementielle à ce que les deux récits ne concernent qu'un seul et même événement. Quant au niveau du sens, si le premier récit fait de la multiplication des pains un midrash sur l'Exode (ancienne alliance), et le second un enseignement sur l'eucharistie (nouvelle alliance) il faut s'interroger sur la possibilité d'un seul événement qui puisse être la source de deux enseignements si distincts. La probabilité est faible, et rassembler les deux récits sous un seul fait historique, m'apparaît un peu comme ces exégètes qui considèrent la vie de Jésus (nouvelle alliance) comme un mythe venu commenter ou développer l'événement fondateur de la religion monothéiste dans l'ancienne alliance. Le Seigneur s'est révélé par étapes, et a bien distingué historiquement dans sa révélation l'ancienne de la nouvelle alliance. La distinction des deux événements est donc signifiante à cet égard.
L'autre hypothèse dont il faut je crois se garder, c'est de penser que le miracle de la multiplication des pains fut juste un événement comportant une quantité indéterminée de nourriture et de personnes, par "charité" pour nourrir les gens, et que les symboles numériques et autres petits détails ont été ajoutés uniquement par les disciples pour "enrichir" le sens de l'événement. La source de la révélation est La Parole, et tout l'enseignement de la tradition prend sa source dans la Parole. Il n'y a pas d'invention ou d'improvisation des disciples. Il y a en revanche de la composition, celle qui permet notamment une pédagogie ou une inculturation, mais rien qui ne vienne "ajouter" du sens : simplement le mettre en lumière. En Jésus la révélation est achevée. Or on le voit, nous avons dans ces deux récits des sens différents liés au contexte même qui est décrit. Il faudrait donc que le sens de cet enseignement ne prenne plus sa source dans le Christ mais dans l'improvisation des disciples, et alors une partie conséquente de ces récits deviendrait de purs mythes.
En passant, je crois que l'erreur (de considérer deux traditions rapportant un seul événement) vient de ce que l'on occulte le caractère signifiant du miracle, d'une part, et d'autre part que l'on confond la tradition de ceux qui rapportent l'événement et la tradition de ceux qui l'ont reçu du Christ. Autant il est bon de noter que le premier récit a un caractère qu'on dira plus tard "judéo-chrétien" et contrairement au second "pagano-chrétien", comme on le dit plus généralement en comparant l'évangile de Mathieu (plus hébraïsant) et l'évangile de Luc (plus hellénisant). Autant il est maladroit de considérer que ce sont les sensibilités distinctes des disciples qui ont donné à un seul événement ces deux couleurs.
Car au niveau rédactionnel, le problème est qu'on considère la transmission comme soumise à tous les aléas. On préfère donc considérer que les différences sont le produit d'un subjectivisme identitaire plutôt que des enseignements différents, peut-être pour des publics différents, donc des pédagogies différentes. Ceci dit, ici nous avons même encore plus que cela, puisque nous avons dans ces deux miracles de Jésus deux "chapitres" bien différents du "grand livre" de la Parole. Non pas un doublon, mais bien deux enseignements différents de Jésus, donc incarnés distinctement l'un de l'autre, puisant leur source dans le Verbe incarné et non dans la subjectivité des rédacteurs.
Ajouter un commentaire