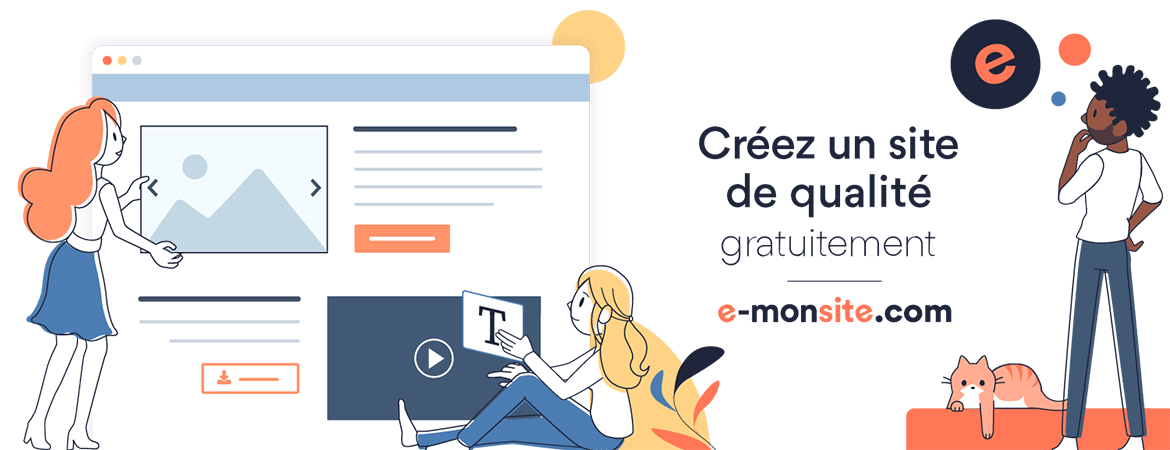- Accueil
- Théologie libérale
- L'expiation les arguments contre cette théologie
L'expiation les arguments contre cette théologie
Deuxième partie ARGUMENTS
Avant d’exposer les arguments que nous avons à faire valoir contre la doctrine de l’expiation, rappelons brièvement les éléments principaux de cette doctrine, telle qu’elle s’est peu à peu formée et formulée depuis Anselme de Cantorbéry jusqu’à nos jours.
D’après cette doctrine, ce qui fait surtout la gravité du péché, c’est qu’il constitue une offense à Dieu, un crime de lèse-majesté divine, parce qu’il est une atteinte aux droits de Dieu, étant une transgression de sa volonté. Pour cette raison, le péché est chose si grave aux yeux de Dieu que, pour être pardonné par lui, le repentir de son auteur ne suffit pas, quelque sincère et profond qu’il soit, quelque changement de conduite qui le suive. Il faut encore — la justice divine, gardienne de l’ordre moral, l’exige — que ce péché soit expié par le châtiment du coupable. Le châtiment, que mérite le pécheur, c’est la perdition, les uns par là la mort absolue et définitive, les autres, des peines éternelles, l’enfer. Si donc Dieu laissait libre cours à sa justice, l’humanité pécheresse serait irrémédiablement perdue. Heureusement pour nous, Dieu n’est pas que justice et sainteté : il est encore et surtout amour, et son amour ne lui permet pas de laisser l’humanité aller à la perdition. Il faut donc, pour sauver l’humanité en même temps que pour sauvegarder les droits de la justice, qu’un être se trouve, qui ait à la fois la volonté et la capacité nécessaires pour expier les fautes de l’humanité. Cette personne ne peut être un pécheur, puisque, comme pécheur, elle aurait à expier elle-même ses propres péchés. Il faut que ce soit un être saint, parfaitement pur. Il faut aussi que l’expiation offerte par lui ait une valeur quasi infinie, puisqu’elle doit être de nature à pouvoir expier tous les péchés passés, présents et futurs de l’humanité. Enfin, il faut pourtant que cet être saint tienne par quelques relations à l’humanité, pour pouvoir être son représentant devant Dieu et expier à sa place. Pour ces diverses raisons, il a fallu qu’un être divin, le Fils unique de Dieu, devînt lui-même homme, se solidarisât volontairement avec l’humanité, pour prendre sur lui toute la coulpe de celle-ci et l’expier, afin qu’à son tour tout homme se solidarisant par la foi avec Jésus-Christ, faisant une même plante avec lui, bénéficiât de cette expiation. Et bénéficier de cette expiation, c’est non seulement n’être plus à la recherche et punissable pour ses propres péchés, échapper ainsi à la perdition, mais être véritablement pardonné, reçu en grâce auprès de Dieu, parce que celui-ci ne considère et ne traite plus le croyant comme un pécheur, mais comme solidaire et participant de la justice parfaite de Christ, par conséquent comme un juste.
Notre première objection à cette doctrine est que la mission de Jésus-Christ dans ce monde est présentée par l’Évangile comme la marque, la preuve par excellence de l’amour infini de Dieu pour nous. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3, 16). Dès lors, il est parfaitement illogique de supposer que cet envoi ait eu, entre autres, comme but, de provoquer en Dieu un changement de disposition à l’égard de l’humanité pécheresse, de le rendre ainsi capable de nous pardonner nos péchés.
Généralement, ceux qui professent la doctrine de l’expiation admettent aussi celle de La Trinité. S’ils ne vont pas jusqu’à signer le symbole d’Athanase, ils considèrent en tout cas Jésus de Nazareth comme l’incarnation d’un être divin préexistant, du Fils unique de Dieu. Comment ne sentent-ils lias dès lors ce qu’il y a d’étrange à penser que La Trinité divine a consenti à ce que l’un de ses membres devienne homme et participe à toutes les infirmités et souffrances de la nature humaine, sauf le péché, pourquoi pour s’offrir à elle-même un sacrifice d’expiation destiné à effacer les péchés du genre humain, et à lui permettre, à elle, Trinité, de pardonner les péchés de quiconque se repent. Comment, nous ayant donné le plus, à savoir le Fils unique et éternel de Dieu, La Trinité ne pouvait-elle pas nous donner le moins, à savoir le pardon gratuit aux pécheurs repentants quel Dieu singulier que ce Dieu qui se fait homme pour s’offrir à lui-même un sacrifice d’expiation en faveur de ses créatures et l’on voudrait que nous admirions la sublimité de l’amour et de la sagesse d’un tel moyen de libérer les hommes de leur coulpe. Mais que dirait-on d’un homme qui, en présence de l’insolvabilité notoire de ses débiteurs et désireux de leur venir en aide, dirait à son fils, avec qui il fait bourse commune, de payer la dette des susdits débiteurs, au lieu d’en faire purement et simplement la remise à ceux qui reconnaîtraient franchement leur dette et leur impossibilité de s’en acquitter et désireraient sincèrement en être libérés on serait unanime à trouver le procédé bizarre et sans avantage aucun pour le créancier. C’est pourtant le procédé que prêtent à Dieu les tenants de la doctrine de l’expiation, à moins toutefois que, distinguant très nettement entre le créancier et son fils, ils admettent que ce dernier ait payé de ses propres deniers et intégralement la dette des malheureux débiteurs. Mais, dans ce dernier cas, ceux-ci ne devraient avoir de reconnaissance qu’à l’égard du Fils, et non à l’égard du Père, c’est-à-dire de Dieu, puisque celui-ci n’aurait eu à exercer aucune compassion à l’égard des pécheurs, la dette de ces derniers ayant été complètement payée par Jésus-Christ. Le sacrifice du Calvaire serait ainsi une preuve magnifique de l’amour de Jésus-Christ pour nous, mais nullement une manifestation de celui de Dieu. On voit déjà par là combien la doctrine que nous combattons est contraire à l’esprit général de l’Évangile.
La notion du péché que présuppose la doctrine de l’expiation sera l’objet de notre seconde critique. Que le péché, la transgression de la loi morale, expression de la volonté divine, soit chose grave, très grave, nous ne songeons certes pas à le nier, nous qui redirions volontiers : « II n’y a qu’une hérésie, la négation du péché ». Mais pourquoi est-il chose si grave. Est-ce parce qu’il constitue une offense à Dieu, comme le prétendent Anselme de Cantorbéry et ses modernes disciples non pas, et cela pour deux raisons. La première, c’est que Dieu est au-dessus de nos offenses, vérité qu’avait déjà aperçue l’auteur du poème de Job, comme le montrent ces paroles d’Elihu : « Si tu pèches, quel tort causes-tu à Dieu Si tes offenses se multiplient, que lui fais-tu ? Ta méchanceté ne peut nuire qu’à tes semblables, ta justice n’est utile qu’au fils de l’homme » (Job 35. 6-8). La seconde raison, c’est que l’immense majorité des hommes, quand ils font le mal, ne songent guère à offenser la divinité. C’est là un cas tout à fait exceptionnel et qui, dans la vie de beaucoup d’entre nous, ne se rencontre pas une seule fois. Dans la grande majorité des cas, les hommes transgressent ou omettent leur devoir, parce que le devoir impose une difficulté, un désagrément, un sacrifice, une souffrance et que leur tempérament naturel les pousse vers ce qui est facile, vers ce qui flatte leurs sens, leurs intérêts ou leur ambition. Dans les autres cas, les hommes font le mal par vengeance ou par méchanceté pure, pour nuire à leurs semblables.
Ce serait d’ailleurs supposer en Dieu un sentiment égoïste et intéressé que d’imputer son aversion et sa condamnation du péché au fait qu’il y verrait une atteinte à son honneur, une sorte de crime de lèse-majesté. Il faut que le chrétien se rappelle toujours que le terme humain qui exprime le mieux ce que Dieu est pour nous, c’est celui de Père céleste, et que, par suite, le meilleur moyen de comprendre ses voies et ses pensées à notre égard, dans la mesure où nous le pouvons, c’est de considérer la manière dont un père terrestre parfaitement sage et parfaitement bon traiterait ses enfants. Représentons-nous donc un instant un tel père, et demandons-nous quels seraient ses sentiments et sa manière d’agir à l’égard de ses enfants, lorsque ceux-ci auraient, à maintes reprises, transgressé ou négligé ses ordres ? Serait-ce vraiment le sentiment d’une offense faite à lui-même, d’une blessure dans son amour-propre de Père et de chef de famille pas le moins du monde. Mais, n’ayant eu en vue, dans les commandements donnés à ses enfants, que leur propre intérêt, leur bien véritable, il souffrirait, dans son amour pour eux et par amour pour eux, à constater l’égarement de ses enfants et à prévoir les fâcheuses conséquences qu’il leur vaudra dans la suite. Et s’il estime nécessaire de les châtier de leurs désobéissances, le seul but qu’il poursuivra dans ses châtiments, ce sera la correction, l’amendement de ses enfants. Ce ne sera pas pour leur faire expier leurs fautes dont il les punira, mais pour les amener à rentrer en eux-mêmes, à regretter leur conduite passée et à en adopter une meilleure à l’avenir. Aussi, plus d’une fois, ne recourra-t-il à aucune punition, soit qu’il ait suffi de sa parole et de son attitude pour produire le changement souhaité dans l’esprit de ses enfants, soit que ceux-ci soient arrivés d’eux-mêmes, par la douloureuse expérience des suites funestes de leurs désobéissances, à regretter sincèrement ces dernières.
Dieu n’agit pas autrement à notre égard. Dans son amour paternel pour ses créatures humaines, il a organisé le monde physique et le monde moral de telle façon que la loi morale — dont nous prenons connaissance par la conscience et la raison pratique — marque précisément à l’homme la ligne de conduite par l’observation de laquelle celui-ci travaille à l’ibis au développement complet et normal de sa personnalité, et à la réalisation du but général de l’univers, le Royaume de Dieu. Il s’ensuit que toute transgression de la loi morale constitue nécessairement une cause de trouble, de désorganisation, de souffrance physique ou spirituelle, soit pour son auteur, soit pour son milieu, si bien que, si l’individu persiste à transgresser la loi morale, il finit par détruire complètement sa personnalité et s’éliminer totalement de la sphère des vivants. On comprend dès lors que le Dieu, qui est amour, déteste le péché, puisque celui-ci empêche son auteur d’arriver à la vie éternelle et de participer au Royaume de Dieu, le souverain bien des êtres doués de raison. On le comprend d’autant plus que l’individu qui fait le mal ne nuit pas seulement à lui-même, en détruisant en lui les sources de la vie, mais aussi à son milieu social soit en entravant ses semblables dans leur ascension vers la vie et le Royaume de Dieu, soit en étant pour eux une cause de souffrances physiques et de pertes matérielles. En d’autres termes, c’est parce que Dieu nous aime infiniment, parce qu’il veut, dans son amour, nous élever à la vie divine et éternelle de l’enfant de Dieu, qu’il condamne le péché qui nous éloigne du but de la vie et nous conduit au néant. C’est là, dans l’amour paternel de Dieu et non pas ailleurs, qu’il faut chercher l’explication de son attitude vis-à-vis du péché.
En se plaçant à ce point de vue, qui est celui de l’Évangile, — preuve en soit entre autres la parabole de l’enfant prodigue, — on ne peut supposer en Dieu qu’un désir par rapport au pécheur : celui qu’a déjà indiqué le Prophète Ezéchiel : « non pas qu’il meure, mais qu’il se convertisse et qu’il vive » (18, 23). Par conséquent, toutes les dispensations de Dieu à son égard, tant par la voie de l’action directe sur son esprit que par celle des circonstances, tendront à amender le pécheur, à le convertir, à faire de lui un enfant de Dieu et un coopérateur de son règne, au lieu d’avoir en lui un indifférent ou même un adversaire. Aussi, vis-à-vis du pécheur qui se repent sincèrement de ses fautes, qui souhaite sérieusement changer de conduite et fait effort dans ce but, le Dieu saint ne peut agir autrement que comme le père de l’enfant prodigue : lui ouvrir tout grands ses bras, c’est-à-dire lui pardonner gratuitement, l’admettre à sa communion, ce qui sera le meilleur moyen de l’encourager dans ses bonnes dispositions et d’affermir ses pas dans la bonne voie.
Parler de la sorte, nous dit-on, c’est oublier les droits imprescriptibles de la justice et de la sainteté divines, lesquels, pour maintenir la majesté, la valeur et l’autorité absolues de l’ordre moral, exigent impérieusement la punition du pécheur qui a violé cet ordre, attendu que seule cette punition, en expiant le péché, sauvegarde l’ordre moral. Ce n’est donc qu’après avoir été préalablement expié que le péché peut être pardonné par Dieu. Voilà pourquoi, pour concilier en Dieu les exigences de Sa Sainteté et de sa justice avec les miséricordieuses revendications de son amour, il a fallu la mort expiatoire du Christ. Nous avouons avoir été toujours étonnés de rencontrer ce dernier argument même chez des dogmaticiens de valeur. Pourquoi considérer ces attributs de la sainteté et de la justice d’une part, et l’amour, d’autre part, comme opposés entre eux, la sainteté, à laquelle se rattache la justice, exigeant la mort du pécheur en tant que transgresseur et rebelle, tandis que son amour veut le régénérer et le vivifier. Dieu est harmonie, unité, et ses attributs divers, bien loin de s’opposer entre eux, s’appellent, se complètent et s’enrichissent mutuellement. C’est précisément parce que Dieu est amour, amour parfait, qu’il est aussi sainteté et justice, car l’amour vrai est saint et juste. L’amour de Dieu pour nous consiste en ce qu’il veut nous rendre participants de la vie divine et éternelle, et, par suite, membre du Royaume de Dieu en vue duquel il a créé et dirige l’univers. La sainteté de Dieu est l’attribut à raison duquel il fixe l’ordre moral en conformité avec le but d’amour qu’il poursuit dans l’univers, de telle sorte que celui qui se soumet à cet ordre parvient à la vie éternelle dans le Royaume de Dieu, tandis que celui qui persiste à ne pas s’y soumettre s’exclut lui-même de la vie et du Royaume. Quant à la justice de Dieu, ou plutôt à son équité — car ce dernier terme correspond mieux à la notion biblique de la justice divine —, elle consiste dans le fait que Dieu conforme toujours ses dispensations envers ses créatures au but d’amour qu’il poursuit à leur égard. Ce n’est pas la justice du juge, qui, tenu d’obtempérer aux prescriptions d’une loi qu’il n’a point faite et qui le domine, doit, sans considération de personnes, infliger au transgresseur de la loi, que celui-ci soit repentant ou non, la peine fixée par la loi. C’est l’équité d’un père qui s’applique, dans l’éducation de ses enfants, à approprier sa conduite à leur caractère, à leur âge, à leurs dispositions, et qui n’est pas lié par les articles d’une loi supérieure à lui-même. Aussi, en cas de faute de ses enfants, n’agit-il pas toujours de la même manière ; mais, suivant les circonstances de la faute et le caractère de son enfant, suivant l’attitude de son enfant après ta faute, il pardonne ou châtie, réprimande ou se tait, et, quand il se voit forcé de punir, vise à corriger son enfant, à l’empêcher de fauter à l’avenir, mais ne le châtie point pour la vaine satisfaction de faire expier la faute commise par une souffrance proportionnelle à celle-ci.
Il n’y a donc pas opposition en Dieu entre son amour, dune part, sa Sainteté et sa justice d’autre part, mais tous ces attributs de Dieu concourent ensemble à une seule fin : la conversion et le salut du pécheur, et, en cas de résistance obstinée de celui-ci, à son élimination définitive du monde des vivants. C’est ainsi que Dieu use tour à tour de longanimité et de sévérité, du pardon et du châtiment, étant aussi saint, aussi équitable quand il pardonne qu’il est aimant et miséricordieux quand il punit, puisque toutes ses voies tendent à un même but : l’amendement du pécheur et l’avancement du Royaume de Dieu. Et, en agissant de la sorte, Dieu reste absolument fidèle à l’ordre moral, puisque cet ordre moral n’est, point constitué par une loi fatale, supérieure à lui-même, mais consiste dans sa propre volonté, toujours égale à elle-même et toujours déterminée par son but d’amour.
Ainsi donc, ce que ce Dieu qui aime saintement et justement veut du pécheur, c’est qu’il se repente de son péché, qu’il s’en détourne, qu’il entre et progresse dans la voie de l’obéissance. On comprend dès lors que, lorsqu’un homme revêt ces dispositions-là, Dieu ne peut faire autrement que de lui pardonner ses manquements, ce qui revient en fait à l’admettre à sa communion, à agir sur lui par son Esprit, puisque c’est dans la communion avec Dieu que le pécheur trouvera son meilleur appui pour marcher selon Dieu.
Ici encore c’est la conduite d’un père terrestre parfaitement sage et bon qui est le plus propre à nous faire comprendre les voies de Dieu. Voici, par exemple, un garçon qui, nonobstant l’ordre formel de son père, n’est pas resté à la maison pour faire ses devoirs scolaires, mais s’en est allé faire une partie de canot avec des camarades. Le lendemain, n’ayant pas fait le travail exigé, il est puni par le maître d’école, et son père est avisé de ladite punition et de sa cause. Que fera le Père tout dépendra de l’attitude de son enfant. Si celui-ci se moque de la punition subie, ne regrette nullement d’avoir enfreint l’ordre paternel et montre par son attitude qu’il est tout prêt à recommencer, le Père ne se bornera pas à une réprimande qui touche fort peu son fils, mais il lui infligera une punition assez forte pour que son fils ne soit plus guère disposé à recommencer. De plus, il tiendra son fils à distance et le privera de marques d’affection jusqu’à ce que son fils soit véritablement venu à résipiscence.
Si, au contraire, le Père constate chez son fils, au retour de l’école, un réel regret de sa conduite, si ce dernier lui en demande sincèrement pardon, s’il y a chez l’enfant un vrai chagrin d’avoir fait de la peine à son père, le Père pardonnera et continuera à traiter son fils avec la même confiance et la même affection que ci-devant. Car c’est ainsi qu’il encouragera et confirmera les bonnes résolutions de son enfant et le détournera le mieux d’une nouvelle désobéissance. Par contre, un père, plus féru du sentiment de son autorité que d’amour vrai pour son enfant, sera volontiers tenté, malgré le repentir de son fils, malgré sa demande de pardon, malgré son sincère désir de mieux faire à l’avenir, d’ajouter encore une punition à celle déjà infligée par le maître d’école, et, pendant plusieurs jours, de traiter son enfant avec froideur et sévérité. Mais que risque-t-il alors d’arriver ? C’est que le fils, laissé à lui-même, avec le sentiment qu’il ne méritait pas un pareil traitement, se rapprochera d’autant plus des camarades qui l’ont déjà entraîné au mal et aura d’autant moins de regret à l’avenir de transgresser les ordres paternels. Bien loin donc d’avoir contribué à
l’amendement de son fils, l’intransigeante sévérité du père, qui considère la faute en elle-même plus que son auteur, aboutira à l’endurcissement du coupable.
Dans la doctrine de l’expiation, ce n’est pas seulement sa notion du péché et sa conception des attributs opposés de Dieu qui prêtent le flanc à la critique, mais c’est la notion même de l’expiation. On entend généralement par expiation l’effacement ou la réparation, par la peine qu’on subit, de la faute commise, de telle sorte qu’une fois fa peine encourue subie, le coupable n’est plus à chercher et punissable pour la même faute. C’est ainsi, nous dit-on, que Jésus, en prenant pour lui la peine méritée par les pécheurs, a expié leurs péchés. Cette peine méritée par les pécheurs, c’était, disent les tenants de la doctrine de l’expiation, la perdition, celle-ci comprit par les uns comme anéantissement absolu du pécheur, par les autres comme peines éternelles infligées à ce dernier. Notons, en passant, l’injustice qu’il y aurait de la part de Dieu, soit à frapper d’une peine identique des hommes coupables à des degrés fort différents, soit à infliger des peines éternelles à des individus dont les fautes, si graves fussent-elles, n’ont été commises que pendant un temps limité, un instant en comparaison de l’éternité. Mais nous passons ici sur ce point spécial pour ne nous arrêter qu’aux critiques particulières que soulève la notion d’expiation.
Pour nous faire admettre que Jésus ait pu expier nos péchés à notre place, il faut justifier préalablement l’idée même d’expiation, c’est-à-dire, dans le cas particulier, l’idée que la perdition éternelle des pécheurs aurait réellement effacé et réparé leurs péchés, car Jésus n’a pu prendre à sa charge qu’une prestation incombant justement à d’autres et se justifiant en elle-même. Or, il suffit d’un minimum de réflexion pour comprendre qu’une peine telle que la perdition éternelle n’efface et ne répare en réalité rien. J’aimerais bien d’ailleurs que l’on m’explique la différence entre une vie éternelle et la damnation éternelle ! Car pour être damné éternellement ne faut-il pas paradoxalement vivre éternellement ? Que devient alors la promesse du don de la vie éternelle comme récompense si tous à chacun peuvent obtenir d’une façon ou d’une autre une vie éternelle après sa mort physique ? Dans ces conditions, les pécheurs seraient tributaires aussi d’une vie éternelle dans la damnation. La promesse de la vie éternelle est non seulement les péchés commis restent commis et les souffrances physiques et morales qu’ils ont causées dans cette vie restent souffertes, mais la « perdition éternelle » n’est qu’un mal de plus ajouté au mal déjà existant. Quel avantage Dieu retirerait-il d’une condamnation à la perdition éternelle de toute l’humanité, si tous ont péché ? Quelle gloire aurait-il de plus ? En quoi l’avènement de son règne serait-il avancé par une telle mesure ? Comment par là serait satisfaite la justice d’un Dieu d’amour ?... Nous ne parvenons pas à le découvrir, mais j’entrevois clairement au contraire qu’en agissant ainsi Dieu agirait en contresens du but qu’il s’est proposé dans la création : l’établissement d’un univers où se réalise pleinement le Royaume de Dieu par la vie éternelle d’une infinité de créatures morales élevées à la dignité de fils de Dieu. Jésus-Christ ne saurait donc nous avoir épargné par sa mort une mesure qui nous paraît inconcevable de la part du Dieu de l’Évangile parce qu’absolument inconciliable avec ce que l’Évangile nous présente comme le but même de Dieu. On ne peut préserver quelqu’un que de ce dont il est menacé.
Méconnaissant cette infirmité de la notion d’expiation, les partisans de cette dernière insistent volontiers sur le fait que c’est justement pour épargner à l’humanité pécheresse la condamnation à une perdition éternelle que Christ a offert à Dieu d’expier le péché des hommes à leur place et que Dieu a accepté ce sacrifice, en imputant cette mort à salut pour tous ceux qui s’uniraient par la foi à Jésus-Christ.
Mais alors, dirons-nous, quelle singulière idée de la justice divine que d’en déduire la nécessité, pour le Dieu qui a l’intention de pardonner à l’homme pécheur, d’exiger préalablement, comme condition de ce pardon, la mort douloureuse d’un innocent, que dis-je ? D’un saint. Comment ce qui, dans les relations humaines, est considéré à bon droit comme une injustice, pourrait-il être, dans les relations de Dieu avec l’humanité, une manifestation de la justice parfaite ? À coup sûr, on se gardera bien d’engager les hommes à imiter Dieu sur ce point. Nous venons d’écrire que la perdition éternelle des hommes ne réparerait et n’effacerait en réalité rien, qu’elle ne serait qu’un mal de plus. On peut dire la même chose de la mort douloureuse de Jésus-Christ envisagée comme expiation. En quoi ce supplice, ce sang versé, cette agonie du saint et du juste, tout cela considéré comme expiation du péché de l’humanité, répare-t-il et efface-t-il le péché ? Cela rend-il la vie à la victime de l’assassin, l’honneur à la jeune fille séduite, l’aisance à la veuve ruinée par un banquier véreux, le bonheur à l’époux trompé, la santé à l’enfant d’un père avarié ? Pas le moins du monde. La mort de Jésus-Christ n’a été qu’une souffrance et un crime ajoutés à d’autres souffrances et à d’autres crimes, mais, par elle-même, elle n’efface ni ne répare le mal commis antérieurement et postérieurement.
Les partisans de l’expiation prétendent qu’en ne se contentant pas de la conversion du pécheur, quelque sincère est-elle, mais en exigeant encore comme condition objective du pardon les souffrances et la mort de Jésus, Dieu a mis plus fortement en lumière la gravité du péché. Je prétends précisément le contraire. Comment, tous les meurtres, les tortures, les adultères, les débauches, les vols, les infamies, les calomnies, les trahisons, les mensonges, les colères, les injures, les haines, les méchancetés de milliards et de milliards de créatures humaines auraient pu être expiées, c’est-à-dire effacées, compensées et réparées par les quelques heures de souffrances physiques et morales endurées par Jésus-Christ entre l’instant de son arrestation et celui de son dernier soupir sur la Croix, mais quelle disproportion énorme, infinie, entre la somme incessamment accrues de ces transgressions de la volonté divine pendant des siècles et des siècles et la quantité finie et relativement petite des souffrances du Christ.
Nous disons « relativement petite », car il y a des êtres humains qui, par le fait de la maladie et de la persécution, sont passés pailles souffrances aussi aiguës, mais plus prolongées, sans posséder la force d’une communion aussi intime avec Dieu. Si c’est la souffrance du juste qui expie la faute du pécheur, les souffrances de Jésus-Christ ne sauraient à elles seules expier les péchés de l’humanité, car il n’y a pas de proportions entre ceux-ci et celles-là, et avec l’apôtre Paul (Col. Il, 24) et avec l’Église catholique, il faudrait alors reconnaître une valeur expiatoire à toute souffrance endurée par fidélité au devoir.
Quant à prétendre que la passion du Christ a une valeur et une portée infinies, parce que ce sont celles d’un être divin et infini, c’est tout simplement se payer de mots. En tant qu’incarné, en tant que Jésus de Nazareth, le Christ était un homme, c’est comme homme qu’il a souffert, et ses souffrances n’ont été infinies ni en durée, ni en intensité. Du reste, le caractère de l’infinité ne saurait être attribué ni aux actes ni à la personne historique de Jésus — même si l’on reconnaît en lui l’incarnation du Fils éternel de Dieu — sans aboutir à faire de lui un personnage absolument fantasmagorique, en dehors de toutes les conditions de l’humanité. Pour s’en rendre compte, il suffit de se poser cette question-ci : quand Jésus prenait un repas avec ses disciples, cet acte revêtait-il une valeur et une portée infinies ?
Il est universellement entendu qu’un coupable qui a, par la peine qu’il a subie, expié sa faute n’est plus à rechercher et punissable pour celle-ci. Si donc Jésus a, par sa passion, expié à notre place les péchés de l’humanité, et que tous les disciples de Jésus-Christ peuvent se mettre au bénéfice de cette expiation, il devrait s’en suivre en bonne logique et selon les règles de la justice, que les chrétiens devraient être dispensés de subir, aussi bien dans cette vie que dans une autre, les conséquences douloureuses de leurs fautes passées, et, à plus forte raison, les suites fâcheuses des fautes d’autrui. Non-bis in idem. Or, l’expérience démontre surabondamment que les chrétiens les plus pieux pâtissent maintes fois dans cette vie des suites funestes de leurs propres manquements et de ceux d’autrui, et que, tout comme les autres hommes, ils sont astreints à la mort physique, dans laquelle les partisans de l’expiation voient généralement une conséquence du péché. Donc le sacrifice de Jésus-Christ n’expie pas complètement le péché de ses disciples ; il ne peut, en tout état de cause, que leur épargner cette perdition éternelle (donc une forme de vie éternelle) qu’on nous dit être le juste châtiment de tout pécheur quelconque.
Mais même cette dernière proposition, lorsqu’on l’examine en face, est tout simplement insoutenable, parce qu’elle est en contradiction absolue avec la foi chrétienne. Remarquons, en effet, que les partisans de l’expiation soutiennent que Jésus a subi à notre place ce châtiment de nos péchés qui s’appelle la perdition éternelle. Or celle-ci, comme nous l’avons déjà dit, est entendue de deux façons. Elle signifie, ou bien l’anéantissement absolu du pécheur, ou bien sa punition éternelle. Dans le premier cas, on affirmerait que Jésus est mort définitivement, dans l’autre, qu’il a accepté, par amour pour nous, de subir à notre place les peines éternelles, deux propositions manifestement contradictoires, pour ne pas dire blasphématoires, à la foi chrétienne.
Il n’y a pas moyen d’échapper à cette réduction à l’absurde. Du moment, en effet, que l’on prétend que Jésus nous a sauvés par sa mort sur la croix en prenant sur lui le châtiment que nous méritons, et que ce châtiment c’était la perdition éternelle, il faut bien admettre que le sort de Jésus, c’est la perdition éternelle. Il faut donc le considérer ou bien comme mort à toujours, ou bien comme souffrant en enfer des peines éternelles avec ceux qui n’ont pas voulu se mettre au bénéfice de sa mort expiatoire. On essaiera peut-être d’échapper à cette monstrueuse conséquence de la notion de l’expiation, en revendiquant pour la mort physique de Jésus une valeur expiatoire suffisant à couvrir tous les péchés de l’humanité, au moyen du raisonnement suivant : la mort physique ou corporelle est la punition du péché ; or Jésus étant sans péché ne devait pas mourir ; s’il a dû passer par la mort corporelle, c’est donc que cette mort expie le péché d’autrui. Mais ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. J’ai déjà relevé la disproportion écrasante qu’il y aurait entre, d’une part, la somme infinie de péchés de toutes sortes qu’il y aurait à expier, et le fait qui les expierait : la mort corporelle d’un être humain, si saint soit-il. Nous n’y revenons pas. Mais voici d’autres arguments à opposer à ce raisonnement. Tel que l’homme est organisé, qu’il soit un saint ou un pécheur, il doit mourir corporellement. Si donc Jésus-Christ a été véritablement homme, comme l’enseigne tout le Nouveau Testament, il était soumis à la loi de la mort. De plus, dans la situation où était Jésus, il lui était impossible de continuer son ministère sans soulever l’hostilité contre lui. Il n’aurait pu échapper à la mort qu’en renonçant à sa mission divine, donc en étant infidèle à Dieu. Sa mort était une conséquence nécessaire de sa fidélité à sa tâche. En l’acceptant, il a fait son devoir, et par conséquent sa mort ne saurait avoir une valeur surérogatoire et expiatoire. Du reste, si elle avait cette valeur-là, elle ne pourrait dispenser le pécheur que d’une peine équivalente, à savoir de la mort physique et non de la perdition éternelle. Comme ce n’est pas le cas, puisque l’homme, croyant ou incroyant, continue à mourir, la mort physique du Christ ne saurait avoir un caractère expiatoire.
Quand on va au fond des choses, on est obligé de constater qu’une véritable expiation du péché, c’est-à-dire une expiation qui efface et répare complètement le mal commis, est rarement possible. En tout cas, ce n’est jamais un châtiment, si juste soit-il, qui peut constituer une véritable réparation, puisqu’il ne fait qu’ajouter au mal accompli un nouveau mal, destiné, il est vrai, à dénoncer le mal déjà commis et à intimider ceux qui seraient tentés de le commettre à nouveau. Or même pour cette dernière croyance l’expérience montre que la « punition » ne peut même pas être exemplaire. Elle n’est en rien dissuasive pour d’autres fauteurs ou des criminelles et ne dissuade nullement l’esprit de celui ou ceux qui se donne au mal. Même la conversion et la sanctification du coupable ne parviennent pas le plus souvent à réparer complètement le péché perpétré. Le meurtre exécuté, la blessure donnée, l’incendie allumé, l’argent volé et dilapidé, l’honneur perdu, le temps gaspillé, tout ce mal commis, avec ses multiples conséquences, ne pourra jamais être complètement effacé et réparé par le bien que ses auteurs, une fois convertis, pourront faire dans la suite. Ici. Une anecdote racontée dans mon enfance me revient en mémoire. Un agriculteur, désespérant de corriger son mauvais garnement de fils, lui dit un jour, en lui montrant un poteau tout neuf planté auprès de la maison : « Toutes les fois que tu agiras mal, je planterai un clou dans ce poteau. Par contre, j’en arracherai un toutes les fois que tu feras bien ». Ainsi fut fait, et deux ans ne s’étaient pas écoulés que le poteau était couvert de clous à tel point qu’un jour le père fut embarrassé d’y trouver place pour un nouveau. Cette fois, à la vue du poteau garni de ces clous accusateurs, le jeune garçon fut saisi de honte et de repentir. Il se promit de faire tous ses efforts pour se corriger et marcher droit. Il tint parole et le jour vint aussi où son père, conduisant son fils devant le poteau, lui dit, en arrachant le dernier clou : « Tu vois, c’est le dernier, il n’y en a plus et je t’en félicite. » — « C’est vrai, répondit l’enfant en fondant en larmes, les clous n’y sont plus, mais les trous restent. »
Oui, les traces, les conséquences du péché ne s’effacent pas par l’amendement du pécheur qui l’a commis. Non seulement, comme je viens de l’écrire, il y a du mal fait qu’avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons plus défaire. Mais le mal, que nous nous sommes fait à nous-mêmes en nous laissant aller aux séductions trompeuses du péché, continue à peser sur nous, parfois longuement et douloureusement, alors même que nous nous sommes sincèrement repentis. C’est ainsi que la conversion la plus sérieuse ne rendra pas la santé compromise ou ruinée par l’alcool ou la débauche. Nous ne retrouverons pas facilement et peut-être jamais la place, la fortune, la considération perdue par notre négligence, par l’amour du jeu, par notre infidélité. Nous aurons parfois beaucoup de peine à faire disparaître les défiances et les hostilités soulevées par notre mauvaise conduite. Et puis, que de luttes, que d’efforts pour déraciner en nous la ou les passions auxquelles nous aurons laissé trop longtemps libre cours ! Et combien douloureux sera souvent le souvenir de nos torts, de nos chutes, de notre dégradation passée ! Oui, les clous peuvent être tous arrachés, mais les trous restent, qui nous rappellent que le mal, la transgression de la loi morale est chose grave et qu’il ne faut pas jouer avec le péché. Il n’en est pas moins vrai que c’est pourtant le repentir, la conversion, la vie engagée dans la bonne voie qui constitue la meilleure des expiations et des réparations, quelque imparfaites qu’elles soient nécessairement. Elles sont la meilleure des expiations parce qu’elles ramènent le pécheur à Dieu, au Dieu qui pardonne et relève, et qu’en le ramenant à Dieu, en faisant de lui un coopérateur de Dieu, elles sont la promesse et la garantie d’un avenir meilleur.
Ainsi, quand on se donne la peine de creuser cette idée du sacrifice expiatoire du Christ, on constate qu’elle est pétrie de contradictions et ne tient pas debout devant un esprit qui raisonne sans parti pris et considère impartialement les faits. On a souvent invoqué, en faveur de la doctrine que nous combattons, l’institution, dans beaucoup de religions, y compris la religion israélite, de sacrifices expiatoires. Je reconnais volontiers ces faits, mais non la conclusion qu’on en tire. Il est certain, en effet, que chez un grand nombre de peuples, là où le sentiment du péché est suffisamment éveillé, on rencontre la croyance à la nécessité de cérémonies expiatoires, consistantes généralement en sacrifices sanglants, pour rentrer en grâce auprès de la divinité dont on a transgressé les commandements. C’est ainsi qu’on est allé jusqu’à sacrifier ses propres enfants pour apaiser le courroux présumé des dieux. Mais cette institution démontre justement le contraire de ce qu’on veut lui faire prouver. Elle montre simplement que ces peuples-là se font de la divinité une idée encore très inférieure, une représentation par trop anthropomorphique. L’homme se fait des dieux à son image. Or l’homme n’est point naturellement enclin au pardon des offenses, même lorsque l’offenseur lui en témoigne ses regrets. Son mouvement instinctif, c’est plutôt de se venger, et, pour apaiser son ressentiment, il réclame quelque chose de plus tangible, de plus profitable que des excuses et du repentir, si sincères soient-ils. Souvent même il ne retient sa vengeance que devant la souffrance de son offenseur. Ce sont ces sentiments trop humains hélas que les hommes ont commencé par prêter à leurs divinités. De là, l’institution des sacrifices d’expiation destinés à apaiser ou diminuer le courroux des dieux, et que l’on rencontre chez presque tous les peuples, dès qu’ils sont arrivés à se sentir pêcheurs et coupables.
Mais Jésus-Christ nous a donné une tout autre idée du Père céleste. Si le Père céleste souffre de voir sa volonté transgressée par les créatures dont il veut faire ses enfants et les héritiers de la vie éternelle, ce n’est point, comme nous le montrions plus haut, parce qu’il y voit un outrage à son honneur de Dieu, mais parce que le péché est un principe de désordre, de souffrance pour la créature humaine, l’obstacle au développement normal de sa personnalité, à son élévation à la dignité d’enfant de Dieu. Aussi, en présence du péché de ses créatures, le sentiment du Père céleste n’est-il pas celui de la vengeance, mais celui de la tristesse, et, avec ce sentiment, le désir d’arracher sa créature au sort fatal qui l’attend, et, accompagnant ce désir, l’activité propre à sauver sa créature, si elle y consent. Si donc le pardon gratuit des péchés est propre à atteindre ce but, à ramener à Dieu le pécheur égaré, rien n’empêchera le Dieu qui aime saintement de recourir à ce moyen. Il est d’ailleurs bien étrange de voir de braves chrétiens s’affliger et s’indigner à la vue des sacrifices humains pratiqués par les adeptes de certaines religions polythéistes pour conquérir le pardon et la faveur des divinités qu’ils adorent, puis considérer le sacrifice de Jésus par son Père céleste comme une manifestation suprême de l’amour et de la justice de Dieu. Au fond, quand on y réfléchit sans parti pris, la conduite de ces polythéistes est beaucoup plus compréhensible et pardonnable que celle attribuée au Père céleste. Notez, en effet, que c’était à ces dieux qu’ils croyaient de bonne foi altérée de sang qu’ils offraient ces sacrifices humains. Par contre, d’après la doctrine de l’expiation, c’est pour lui-même, pour s’offrir la satisfaction qu’exige sa volonté transgressée par le péché des hommes, que Dieu demande à son Fils unique la mort terrible de la croix. Et l’on voudrait que nous admirions l’amour d’un Dieu pareil ? Mais, nous dira-t-on, c’est pour sauver les hommes. — De quoi donc, répliquerons-nous, sinon de sa colère contre les hommes, colère qui demandait à tout prix l’expiation des péchés humains par le sang d’une victime infiniment précieuse. Et l’on arrive ainsi à cette contradiction patente, énorme, que, d’un côté, Dieu aime tant les hommes qu’il est prêt à donner pour eux et leur salut son Fils bien-aimé ; mais, que, d’un autre côté, il est si irrité contre leurs péchés qu’il ne puisse même pas pardonner à ceux qui se repentent, sans exiger au préalable la mort de son Fils, d’un innocent et d’un saint, pour expier ces péchés.
C’est en vain que l’on essaiera d’infirmer cette démonstration en alléguant que l’apôtre Paul, lui, voit dans la croix du Calvaire le sacrifice qui efface tous les péchés de ceux qui s’unissent à Jésus par la foi. J’estime, en effet — et il me paraît superflu de justifier cette assertion — que, sur ce point, le Maître Jésus en savait plus que son disciple et que la pensée de Jésus doit l’emporter sur celle de Paul qui d’ailleurs ne l’a jamais connu de son vivant. Ici, en effet, je ne peux pas envisager la pensée de Paul comme le développement normal de principes posés par Jésus-Christ, mais non encore déployés et appliqués par lui. La doctrine paulinienne de l’expiation a été, au contraire, un emprunt fait à la théologie juive de ce temps-là, laquelle attribuait une valeur expiatoire aux souffrances imméritées des justes. Aussi bien l’apôtre Paul écrivait-il aux Colossiens : « Je me réjouis maintenant dans les souffrances que j’endure pour vous, car, ce qui manque aux souffrances de Christ, je le complète dans ma chair, pour son corps qui est l’Église » (Col. 1, 23). C’est — je le répète — par
l’attribution d’une valeur expiatoire aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ que la proclamation d’un messie supplicié a cessé d’être pour Paul un objet de scandale, comme c’était le cas pour les autres Juifs (Il Cor. 1, 23). Cette conception de la croix, jointe à l’expérience du pardon qu’ils avaient trouvé dans la foi au Christ crucifié, explique pourquoi non seulement l’apôtre Paul, mais aussi les auteurs de l’épître aux Hébreux, de la première épître de Pierre et de l’Apocalypse se sont fait les échos de cette manière d’envisager les souffrances du Saint et du Juste. Plus tard, des pères et des docteurs de l’Église, comme Jean de Damas, ont vu dans cette mort imméritée de Jésus-Christ une rançon payée au diable pour racheter les pécheurs tombés sous sa griffe. Anselme de Cantorbéry, au XXIe siècle, l’a comprise comme une satisfaction donnant à Dieu (comme le Wehrgeld du vieux droit germanique), à la fois une réparation pour le tort matériel causé et un dédommagement pour l’honneur de Dieu lésé par les offenses de ses créatures. De nos jours, où la notion de solidarité est à la mode, c’est à cette notion qu’ont recours les partisans de la doctrine de l’expiation pour justifier celle-ci. Tout cela montre la peine que les hommes ont à accepter ce que l’expérience religieuse du Saint et du Juste avait découvert : l’infinie grandeur de l’amour de Dieu, de ce Père céleste dont les bras, avant comme après la mort de Jésus-Christ, sont toujours prêts à recevoir le pécheur qui vient à lui avec un sincère aveu de ses fautes et un sérieux désir de changer de conduite.
Il est un argument souvent avancé en faveur de la doctrine de l’expiation dont nous n’avons jamais pu saisir la valeur : si Jésus, nous dit-on, n’avait pas expié nos péchés, quelle garantie aurions-nous du pardon de nos péchés — Mais, répondrais-je —, de deux choses l’une : ou bien, nous confiant dans le témoignage de Jésus-Christ, corroboré par l’expérience religieuse de milliers de chrétiens, nous avons foi dans l’amour paternel de Dieu, et, dans ce cas-là, ce n’est pas la croix du Calvaire qui nous garantira notre pardon, puisque celui-ci dépend avant tout de l’amour de Dieu ; ou bien, nous ne croyons pas à un Dieu d’amour et de pardon, et, dans ce cas-là, ce n’est pas l’attribution d’un caractère expiatoire à la passion de Jésus-Christ qui nous y fera croire, comme le montre bien l’état du monde actuel. Une fois d’ailleurs que nous saluons en Jésus l’envoyé du Père céleste, le révélateur du Dieu d’amour, il n’y a plus de raison pour douter du pardon qu’il annonce au pécheur repentant. Guère plus justifiée est l’objection que, si le pardon de nos péchés a pour condition notre repentance, nous ne serons jamais certains de notre pardon, parce que nous ne sommes jamais certains de la suffisance de notre repentir. On peut, en effet, répliquer avec autant de raison que, si la rémission de nos péchés a pour condition notre foi dans la valeur expiatoire de la mort de Jésus-Christ, nous ne serons jamais assurés de notre pardon, parce que nous ne sommes jamais certains de la suffisance de notre foi. L’objection que nous repoussons repose d’ailleurs sur une méconnaissance du rapport existant entre notre repentir et le pardon divin. La volonté de Dieu de pardonner au pécheur est antérieure logiquement et chronologiquement au repentir du pécheur. Elle a sa source dans la bonté sainte et sanctifiante de Dieu, lequel ne désire et n’attend qu’une chose : que le pécheur vienne à lui, son Père céleste, repentant et désireux de mieux faire, parce que c’est par le retour du pécheur à Dieu et dans la communion avec lui que le pécheur trouvera l’esprit qui relève et qui sanctifie. La repentance et la conversion du pécheur ne sont donc que le moyen de l’appropriation personnelle et subjective du pardon dont la cause et le fondement objectifs sont dans la volonté paternelle de Dieu. C’est ce que marque admirablement la parabole de l’enfant prodigue. Nous y voyons le père toujours prêt à accueillir son fils dans la maison paternelle parce qu’il n’a pas cessé de l’attendre et de l’aimer. Mais encore faut-il que le fils revienne à la maison pour bénéficier du pardon et de l’amour paternels.
Il nous reste, en terminant, à examiner un dernier argument avancé par les adeptes de l’expiation. Si, disent-ils, vous éliminez le caractère expiatoire des souffrances et de la mort de Jésus-Christ, quelle valeur et quelle importance reste-t-il à la passion de notre Seigneur pour son œuvre salutaire ? À cette question, ma réponse sera brève, vu que j’ai déjà donné tous les éléments dans notre étude des paroles de Jésus sur sa mort.
Tout d’abord, j’insiste une fois de plus sur ce fait qu’au point de vue purement historique, la mise à mort de Jésus par les chefs religieux de son peuple s’explique naturellement et suffisamment par l’opposition et la haine croissantes que la personne et l’enseignement de Jésus soulevèrent chez les docteurs de la loi et les prêtres (les dirigeants religieux dont le système en place assurait la survie). Pour échapper au sort tragique qui le menaçait, Jésus n’avait qu’un moyen : se taire, abandonner sa tâche, et adopter les croyances ambiantes et donc désobéir à Dieu. C’est dire que pour lui il ne pouvait en être question.
Mais Jésus n’a pas compris et accepté seulement la nécessité historique de sa mort, il en a en plus entrevu la nécessité pour le succès de son œuvre salutaire. D’abord, par Jean 12, 20-24, nous voyons que Jésus s’est rendu compte, par ses observations et sa propre expérience, de cette grande loi du monde physique et moral ce que la vie sort de la mort, que toute vie supérieure a pour condition nécessaire la mort d’une vie inférieure ou à une vie inférieure. Quant à vouloir expliquer le pourquoi de cette loi mystérieuse, dont nous constatons tant d’exemples dans la nature comme dans l’histoire de l’humanité, c’est le secret de Dieu. Disons seulement que nous n’entrevoyons pas comment, sans cette loi, et par conséquent sans la pratique du renoncement à soi-même, l’homme arriverait à cette pleine maîtrise de soi, par laquelle l’enfant de Dieu doit ressembler à son créateur.
Remarquons ensuite combien il aurait manqué à l’ascendant moral et à l’autorité religieuse de Jésus-Christ s’il n’avait pas donné aux hommes l’exemple d’une obéissance à Dieu allant jusqu’à la mort de la croix, et d’un amour pour l’humanité n’ayant pas reculé devant le sacrifice de sa vie. Par là, il a pu conquérir les consciences et les cœurs dans une mesure que n’a atteinte aucun autre fondateur de religion, parce qu’aucun autre n’est allé jusqu’à sceller de sa mort le témoignage de sa vie et de sa parole. Mais gardons-nous bien de séparer la passion de Jésus de sa vie antérieure. Celle-là n’a pas une signification et une valeur différentes de celle-ci. Agissant ou souffrant, vivant ou mourant, Jésus ne faisait qu’accomplir l’œuvre salutaire que lui avait confiée son Père céleste, renonçant à lui-même par amour pour ces êtres humains qu’il voulait arracher à l’empire du péché pour en faire des enfants de Dieu et des héritiers de la vie éternelle. Qu’il parle sur les collines de la Galilée ou dans le temple de Jérusalem, qu’il prie pour ses disciples, ou qu’il guérisse moralement ou physiquement un de ses auditeurs, qu’il soit angoissé en Gethsémané ou agonise sur la croix, ce sont toujours les mêmes sentiments qui l’inspirent et la même œuvre qu’il poursuit. La croix est un sommet sans doute, mais un sommet qui ne fait que couronner une ascension qui a duré la vie entière de Jésus depuis le jour où il sut distinguer le bien du mal, la voix de Dieu des voix du monde.
La seule chose que, dans la carrière de Jésus, marque spécifiquement la croix du Christ, plus que tout autre fait de l’histoire, c’est la profondeur de l’état de péché du genre humain, en nous montrant le Saint et le Juste, le Maître doux et humble de cœur, haï jusqu’à la mort par ceux qui passaient, au sein du peuple juif, pour les honnêtes gens, les gens pieux. Et c’est précisément aussi parce qu’elle fait ainsi toucher du doigt la gravité tragique du péché que la vision de la croix du Calvaire a remué tant de consciences et provoqué tant de repentirs. Enfin, si mon but était ici de traiter dans son ensemble le grand sujet de la rédemption, je ferais encore remarquer que le développement du genre humain ne peut s’effectuer que sous l’empire de la loi de la solidarité. Nous pâtissons des fautes d’autrui comme nous bénéficions de leurs bonnes actions. C’est en acceptant les souffrances physiques et morales qu’entraîne souvent, dans un monde pécheur, la fidélité au devoir que les justes font briller le plus la majesté de celui-ci et qu’ils font avancer le règne du bien. C’est en vivant au milieu des pécheurs et en acceptant les douloureuses conséquences de cette situation que Jésus a jeté dans l’humanité la semence d’une vie nouvelle, d’une autre façon de vivre et de penser. Dans ce sens-là, on peut dire que Jésus — et avec lui tous ceux qui souffrent dans le même esprit, par fidélité au devoir — expier les fautes de l’humanité, tandis que celle-ci bénéficie de son œuvre, comme elle bénéficie aussi des efforts et des souffrances de tous tes hommes de bien. Entre ceux-ci et lui, la différence est non de genre, mais de mesure. Je ne fais qu’indiquer ces différents points en laissant à mes lecteurs le soin d’y réfléchir. Les personnes qui ont eu la patience de me lire jusqu’au bout, sans parti pris, comprendront pourquoi nous ne pouvons tenir pour évangélique une doctrine qui va à l’encontre de l’enseignement de Jésus-Christ et heurte de front la conscience et la raison de tant de chrétiens. Comme si l’Évangile de Paul avait précédé celui de Jésus-Christ. Je n’aurais cure de combattre leurs idées, puisqu’ils y trouvent leur édification, si plusieurs de ces gens-là ne revendiquaient pas pour leur théologie le monopole de la vérité chrétienne et ne jetaient pas la suspicion sur les convictions de ceux qui ne peuvent imputer au Père céleste les sentiments sanguinaires d’un dieu Moloch. Pour ma part, je proteste contre ce procédé aussi peu charitable que dénotant une grande ignorance du développement de la pensée chrétienne à travers les âges. Que ces évangélistes-là en restent à la théologie du Réveil, c’est leur droit, et je ne songe pas à le leur contester, mais qu’ils ne s’arrogent pas celui d’identifier leur théologie avec l’Évangile, comme si Dieu leur avait confié le privilège d’en être seuls les fidèles interprètes. Qu’ils prêchent et exposent leur foi en se servant des formules de nos grands-pères et arrière-grands-pères, je n’en ai rien à y redire, puisque ce sont celles qui cadrent le mieux avec leur mentalité. Mais qu’ils laissent aux protestants que ces formules offusquent, le droit de traduire en des formes nouvelles, mieux adaptées à l’esprit de notre temps, le trésor de grâce qu’est l’Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n’est ni la théologie ni l’absence de théologie qui sauve, c’est la foi agissante par la charité. Que les prédicateurs de l’Évangile, à quelques églises ou écoles théologiques qu’ils se rattachent, s’en souviennent et s’en inspirent. La cause du règne de Dieu aura tout à y gagner.
Ajouter un commentaire