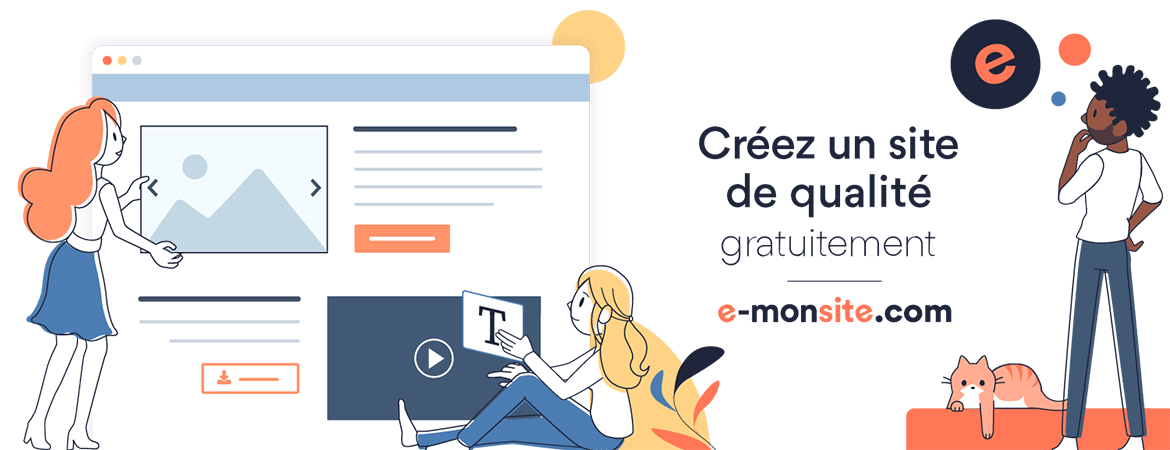- Accueil
- L'origine de l'Église
- L'histoire de l'Église
- symbol du pain
- Multiplication des pains, Jésu
Multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux,
Chapitre 6, de l’Évangile de Jean (version Nelson Darby)
1 Après ces choses Jésus s’en alla de l’autre côté de la mer de Galilée, [qui est la mer] de Tibérias.
2 Et une grande foule le suivit, parce qu’ils voyaient les miracles qu’il faisait sur ceux qui étaient malades.
3 Et Jésus monta sur la montagne, et s’assit là avec ses disciples.
4 Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
5 Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant qu’une grande foule venait à lui, dit à Philippe : D’où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci mangent ?
6 Mais il disait cela pour l’éprouver, car lui savait ce qu’il allait faire.
7 Philippe lui répondit : Pour deux cents deniers* de pain ne leur suffirait pas, pour que chacun en reçût quelque peu.
8 L’un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit :
9 Il y a ici un petit garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ?
10 Et Jésus dit : Faites asseoir les gens (or il y avait beaucoup d’herbe en ce lieu-là). Les hommes donc s’assirent, au nombre d’environ cinq mille.
11 Et Jésus prit les pains ; et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis ; de même aussi des poissons, autant qu’ils en voulaient.
12 Et après qu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu.
13 Ils les amassèrent donc et remplirent douze paniers des morceaux qui étaient de reste des cinq pains d’orge, lorsqu’ils eurent mangé.
14 Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde.
15 Jésus donc, sachant qu’ils allaient venir et l’enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul.
— v. 7 : “voir note à » Marc 6:37.
16 Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer.
17 Et étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l’autre côté de la mer, à Capernaüm. Et il faisait déjà nuit, et Jésus n’était pas venu à eux.
Le midrash sur l’Exode et donc la libération et le prophète Elisée continu avec ce périscope de Jean.
Deuxième Livre des Rois, 4, 42 - 44
42 Il y avait alors une famine dans le pays. Sur la récolte nouvelle, quelqu’un offrit à Elisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac.
Elisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. »
43 Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? »
Elisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le SEIGNEUR : On mangera et il en restera. »
44 Alors il les servit, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du SEIGNEUR.
Elisée est un prophète du Royaume du Nord, entre -850 et -800 av.J.C qui deviendra plus tard la Samarie. Son histoire se lit comme un roman : on la trouve pour la plus grande part dans le deuxième livre des Rois ; Elisée est le successeur du prophète Elie, (dont j’ai déjà parlé). Ce que nous enseigne Jean c’est que comme Jean-Baptiste était considéré comme le retour d’Elie, Jésus peut être comparé à celui d’Elisée celui qui vient après Jean-Baptiste, bien que Jean Baptiste ne fît pas de miracles contrairement à Elie.
Elisée est un prophète qui n’a pourtant pas laissé d’écrits mais ses miracles et ses paroles ont visiblement marqué la mémoire d’Israël ; familier des rois, il ne mâchait pas ses mots : apparemment, sa liberté de parole était totale parce qu’il était reconnu comme "un homme de Dieu" (2 R 3, 12), et malheureusement, à en croire les auteurs de l’Ancien Testament de son vivant, l’idolâtrie n’a jamais cessé dans le Royaume du Nord. Il lui est arrivé, plus d’une fois, de se mêler de politique, d’ailleurs, quand il s’agissait de favoriser un roi disposé à respecter l’Alliance. C’est ainsi, qu’un jour, il a profité du déplacement du roi Achazias pour faire sacrer Jéhu à sa place ! C’est ce que beaucoup attendaient de Jésus qu’il détrône Hérode et se désigner roi à sa place.
Mais ce Prophète doit principalement sa célébrité dans le peuple à ses nombreux miracles de guérisons comme : la naissance du fils de la Shunamite (2 R 4, 8-16) et celle du général syrien lépreux, Naaman (2 R 5), mais aussi bien d’autres, à commencer par son premier, celui qui fit en ouvrant les eaux du Jourdain et traversa à pied sec (2 R 2, 14), répétant le miracle de Josué, lors de l’entrée dans la terre Promise (Jos 3), et comme Elie lui-même en (2 R 2, 8). Voici brièvement quelques autres miracles d’Elisée dans l’ordre du récit du livre des Rois : quand les eaux de Jéricho devinrent mauvaises et frappèrent le peuple et les troupeaux de stérilité, c’est lui qu’on appela, et il les assainit (2 R 2, 19) ; il intervint à plusieurs reprises en faveur de la famille de Shunam qui l’avait hébergé, en particulier il ressuscita l’enfant (2 R 4 et 8). Pour finir, le miracle de l’huile, où une veuve pauvre, poursuivie par des créanciers, était sur le point de se faire enlever ses deux fils pour en faire des esclaves ; elle appela Elisée au secours ; celui-ci lui dit : "Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi ?" Elle répondit : "Je n’ai plus rien chez moi, si ce n’est un peu d’huile pour me parfumer." C’était dire son extrême pauvreté : étant en deuil, elle ne se parfumait plus et avait rangé l’huile dans son placard, c’était la seule chose qui lui restait. Il n’en fallait pas davantage : il lui dit : "Va emprunter des vases chez tous tes voisins, des vases vides, le plus que tu pourras… Puis verse ton huile à parfumer dedans." : elle remplit autant de vases qu’elle put en trouver, l’huile coulait toujours. Elle n’avait plus qu’à vendre son huile pour payer ses dettes (2 R 4, 1-7).
Venons-en à la multiplication des pains qui est notre sujet dans ce chapitre. Elisée agit dans un contexte de pauvreté : grâce aux historiens, on sait que le royaume d’Israël a connu plusieurs fois la famine après une période de sécheresse. Ceci dit, on ne sait pas très bien quelle poids faisaient les vingt pains d’orge, mais il faut croire qu’ils étaient notoirement insuffisants, puisque, son serviteur a cherché à le dissuader : "Comment donner cela à cent personnes ?". Sans se désemparer, et sans changer un seul, Elisée répète "Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent "; et il s’explique : "car ainsi parle le SEIGNEUR : On mangera, et il en restera." Le serviteur n’a plus qu’à obéir.
Quelques remarques, pour terminer, sur le miracle lui-même :
Dans tous les récits de miracles, qu’ils soient de l’Ancien ou du Nouveau Testament, on retrouve quatre éléments, toujours les mêmes : premièrement, un vrai besoin : la maladie, le handicap, la mort, ou encore la famine
Deuxièmement, un geste libre : ici, quelqu’un a pris du pain sur sa récolte, en temps de famine, justement.
Troisièmement, le recours à celui qui est considéré comme l’envoyé de Dieu : ici, Elisée ; les pains lui sont offerts, parce qu’il est reconnu comme l’homme de Dieu : on nous précise que ce sont des pains de prémices, (littéralement, de la récolte nouvelle) c’est-à-dire l’offrande liturgique.
Enfin, quatrièmement, la foi dans l’intervention du Seigneur : contre l’avis de son serviteur, Elisée maintient sa décision. La sollicitude de Dieu lui a donné raison !
PSAUME 144 (145), 10-11, 15-16, 17-18
"10 Que tes Œuvres, SEIGNEUR, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
11 Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
15 Les yeux sur toi, tous ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
16 Tu ouvres ta main ; tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
17 Le SEIGNEUR est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.
18 Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité."
On ne peut pas trouver mieux que ce psaume 144/145 pour être mis en écho au miracle du prophète Elisée multipliant les pains en période de famine avait été l’instrument de la bonté de Dieu : "Les yeux sur toi, tous ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; Tu ouvres ta main ; tu rassasies avec bonté tout ce qui vit." Ce psaume est le cri de la reconnaissance et de l’action de grâce : "Que tes Œuvres, SEIGNEUR, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !"
La composition de ce psaume est donc très soignée ; une remarque d’ordre littéraire : il est ce qu’on appelle un psaume "alphabétique " : c’est-à-dire qu’il comprend vingt-deux versets dont chacun commence par l’une des lettres de l’alphabet hébreu selon leur ordre alphabétique. En littérature, c’est ce qu’on appelle un acrostiche. Ici il ne s’agit pas d’une prouesse de style. Utilisé dans la Bible, ce procédé indique toujours que l’objectif principal du psaume est de rendre grâce pour l’Alliance : manière de dire écoute notre vie, de A à Z, (en hébreu de Aleph à Tav).
Ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin : pour le Juif croyant, le matin (l’aube du jour neuf) évoque irrésistiblement l’aube du JOUR définitif, celui du monde à venir, celui de l’Alliance renouvelée… Si nous allons un peu plus loin dans la spiritualité juive, le Talmud (l’enseignement des rabbins des premiers siècles après J.C.) affirme que celui qui récite ce psaume trois fois par jour "peut être assuré d’être un fils du monde à venir".
Sur les vingt-deux versets que comporte donc ce psaume, j’en ai repris que six, mais toute la découverte biblique de Dieu est dite dans ces quelques lignes. Par exemple, il y a à la fois la grandeur, la gloire, la royauté de Dieu "que tes fidèles te bénissent ! Ils diront la gloire de ton règne // ils parleront de tes exploits. ") ET sa bonté pour nous, sa proximité : "Il est proche de ceux qui l’invoquent // de tous ceux qui l’invoquent en vérité."
Si l’on se rapporte au texte complet de ce psaume, on lui découvre une parenté très grande avec le Notre Père que Jésus-Christ nous enseigne : par exemple, le Notre Père s’adresse à Dieu à la fois comme à un Père ET comme à un roi : un père qui est le Dieu de tendresse et de pitié dont parle ce psaume… Un roi dont le seul objectif est le bonheur de tous les hommes. "Notre Père… Donne-nous… Pardonne-nous… Délivre-nous du mal… Que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel… " parce que l’on sait que sa volonté est, comme dit l’Apôtre Paul, "que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité". (1 Tm 2, 4).
On comprend que ce psaume 144/145 soit devenu la prière du matin du peuple Juifs.
La réaction de la foule après la multiplication des pains par le Christ dit bien l’effervescence qui régnait en Palestine à l’époque de Jésus ; car on attendait le Messie avec impatience : alors, quand on a vu Jésus guérir les malades, on s’est mis à le suivre ; Jean raconte : "Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait en guérissant les malades."
L’effervescence était particulièrement grande, certainement, dans les jours qui précédaient la Pâque ; cette fête de la libération passée (de l’esclavage en Égypte) préfigurait aux yeux de tous la libération définitive qu’apporterait le Messie. Et si Jean prend la peine de préciser : "C’était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs", c’est qu’il y a là un élément important de compréhension du récit de la multiplication des pains, nous aurons l’occasion de mesurer plus loin à quel point le mystère pascal est sous-jacent à tout le discours de Jésus sur le pain de vie.
Pour l’instant, Jésus entraîne la foule vers la montagne : "Jésus gagna la montagne, et là, il s’assit avec ses disciples." Le mot "montagne", en Galilée, près du lac, ne peut être que symbolique (les collines culminent à quelques centaines de mètres) ; sans doute Jean veut-il nous faire entendre que l’heure du banquet messianique annoncé par le prophète Isaïe a sonné : "Le SEIGNEUR, le tout-puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viandes grasses et de vins vieux, de viandes grasses succulentes et de vins vieux décantés" (Is 25, 6). À cette foule affamée du festin de Dieu, Jésus va offrir le signe que ce jour tant attendu est vraiment là. Car c’est bien lui qui prend l’initiative.
Il commence par questionner Philippe, l’un des Douze : "Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ?" Et Jean commente : "Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car lui-même savait bien ce qu’il allait faire." Sans doute, ici comme ailleurs, l’évangéliste veut-il insister sur la prescience de Jésus ; mais en quoi consiste cette "mise à l’épreuve" des apôtres ? Pour un Juif comme Jean, cette expression est un rappel de l’expérience de l’Exode : car la longue pérégrination dans le Sinaï avait été comprise par la suite comme un temps de "mise à l’épreuve" ; le livre du Deutéronome explique : "Le SEIGNEUR ton Dieu t’éprouvait pour connaître ce qu’il y avait dans ton cœur" (Dt 8, 2). Philippe, lui, n’a peut-être pas compris tout de suite que Jésus en appelait à sa foi, il répond de manière tout humaine, pleine de bon sens comme le serviteur d’Elisée : "Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain." Et André ajoute : "Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde !"
D’un point de vue humain, on ne peut pas leur donner tort ! Mais ont-ils donc oublié, Philippe et André, l’histoire du prophète Elisée vu plus haut ? Bien intentionné, le serviteur du prophète avait, dans un cas tout à fait semblable, tenu les mêmes propos : un tout petit peu de pain pour cent personnes, ce n’était même pas la peine d’y penser ! Mais Elisée avait passé outre… Jésus fait la même chose, il se contente de dire "Faites-les asseoir." Pourquoi Jean précise-t-il "qu’il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit." ? Sinon pour faire entendre qu’un "bon pasteur " (encore une image messianique ; cf Jn 10) prend toujours soin d’emmener ses brebis sur un bon pâturage ? (Psaume 23) "Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes." Les quatre évangiles notent la disproportion entre les cinq pains et les cinq mille hommes (disproportion beaucoup moins accentuée dans la multiplication des pains par Elisée) ; histoire de noter la surabondance des dons messianiques.
Arrivé là, Jean change de ton : "Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les leur distribua." On y reconnaît sans peine les mots de la Cène ; Jean, il est vrai, ne relate nulle part cette scène du dernier repas (il la remplace par le lavement des pieds, Jn 13) ; mais ici, visiblement, il y fait référence : les chrétiens auxquels il s’adresse comprennent aussitôt que le miracle des pains sur la petite montagne de Galilée est le signe du banquet de la sainte cène qu’ils célèbrent chaque dimanche depuis la Résurrection du Christ.
Il s’agit donc bien dans ce récit de Jean d’un midrash encore une fois.
Nous sommes donc ici encore dans cet Évangile de Jean en présence d’un récit qui est curieux à plus d’un titre, il comprend deux miracles incroyables et personnellement j’en retire de ce midrash un enseignement surprenant : Jésus ne veut pas régner sur nos vies ! Il s’y refuse ! Voilà de quoi me fâcher avec les théologiens, (les prêtres, les pasteurs, et aussi les fidèles). Un scandale pour de nombreux chrétiens qui demandent à Jésus "règne sur nous". Je les rassure tout de suite pour qu’ils aient la patience de continuer à me lire il y a une grande différence entre "régner sur nous" et "régner en nous". Pour les scientifiques, je peux les rassurer tout de suite, je ne pense pas personnellement qu’il faille absolument lire ces récits comme des miracles au sens physique classique du terme quoi que !
Pourtant, vous allez l’entendre dans ce texte, Jésus-Christ refuse à ce moment-là de régner sur les personnes qui l’entourent même quand elles le lui demandent avec enthousiasme. Ce texte peut nourrir notre réflexion sur notre place dans la société, en tant qu’église mais aussi en tant que simple croyant.
Jésus-Christ, hier comme aujourd’hui, ne fait pas l’unanimité ou du moins ne fait courir les foules, tant s’en faut. Mais dans ce texte, il enthousiasme une foule de partisans qui reconnaissent en lui un prophète, un vrai, une personne qui porte quelque chose de cette dynamique extraordinairement positive qu’est Dieu, il voit Elisée et ils veulent le faire roi.
Cela peut sembler a priori une bonne idée. Ils veulent, sincèrement et de bonne foi, que Dieu au travers Jésus règne ainsi sur leur vie, que sa Parole les dirige et que ses actions créatrices puissent ainsi être pleinement à l’œuvre dans leur vie et dans le monde. Une très bonne idée ?
Eh bien non ! Aussi étrange que cela puise paraître, Jésus refuse de régner ni sur notre société ni sur nous, ce qu’il veut, nous enseigne ici ce midrash, c’est plutôt nous offrir de faire pour nous les deux miracles racontés ici :
En premier lieu, celui de nourrir notre être, comme dans le premier miracle, et de nous rendre capable de nourrir un peu les autres.
Et c’est aussi selon le second miracle nous aider à atteindre Capernaüm, (?????? ??????) c’est-à-dire littéralement le "village de Nachuwm (??????) » « Nahum, » en Français, c’est-à-dire celui de la consolation, qui a compassion, car ce lieu est celui de la consolation, ce qui est précieux et important quand, comme ces disciples nous ramons seul dans la nuit, ; mais d’une façon plus large nahum en hébreu c’est la consolation mais c’est aussi l’accomplissement de notre être avec Dieu puisque l’Esprit étant appelé aussi dans l’Évangile de Jean, le Consolateur.
Jésus refuse d’être roi, d’ailleurs Dieu lui-même ne veut pas régner sur notre vie, et c’est normal. Que penserait-on d’un père qui voudrait régner sur ses enfants, et cela à vie ? Le royaume de Dieu n’est pas une dynastie ! Dieu ne s’impose pas en nous comme un dictateur. J’entends souvent hélas des prédications où il est crié haut et fort que Dieu, où que le Seigneur, doit régner sur notre vie, que le Seigneur doit régner sur nous, que nous ne devons pas regarder aux choses de ce monde etc. etc.. Ces prédicateurs non pas compris ce que Dieu veut, ce que Jésus veut en un sens, ils se considèrent encore comme des enfants qui doivent être dirigés, ils ne se considèrent pas comme des adultes en Jésus-Christ, car régner sur nous ce n’est pas la volonté de Dieu. Dieu comme tous les parents responsables, veut que ces enfants soient émancipés, et qu’ils soient libres.
C’est pour une grande partie parce que Jésus refuse d’être roi que la foule, mais aussi une grande partie de ses disciples vont l’abandonner, et c’est certainement ce qui pousse Juda l’Iscariot qui était un zélote à le trahir. Pourtant ce serait extrêmement confortable et rassurant d’avoir Jésus pour roi, et c’est ce que demandent ces prédicateurs, il demande à Dieu en quelque sorte de réfléchir et penser pour nous, qu’en cela ne s’adresse pas à Jésus lui-même. Il distribuerait du pain à ceux qui ont faim, il imposerait une juste paix entre nous, il calmerait les tempêtes. Il nous dirait ce que nous devons penser, ce que nous devons faire… Eh bien non. Jésus le fils de l’Homme, « la parole incarnée » n’est pas fait pour régner sur nous ce n’est pas sa mission si j’ose dire.
Jésus refuse d’être fait roi, mais cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas y avoir de capitaine sur les bateaux. Heureusement qu’il y a des chefs de service dans les hôpitaux, des maires, des généraux, des cordonniers, des éboueurs, des professeurs, des dirigeants d’entreprises, des cadres, des employés et des ouvriers. Si Jésus se refuse d’être roi, cela veut dire que nous ne devrions pas régner spirituellement sur les autres, c’est-à-dire dominer la pensée d’un autre, régner sur son génie propre et sur son estime de soi, sur sa personne et sa façon de vivre et de penser. Que nous soyons président de la République, dirigeant d’une grande ou petite société, ou enfant à l’école nous sommes appelés par ce texte à nourrir notre prochain et à l’aider à avancer de différentes façons.
Si Jésus a refusé de régner, alors ni l’Église, ni les pasteurs, ni les anciens, ni les ecclésiastiques, ni la Bible, ne doivent penser à la place des gens. C’est à la base de la réforme, comme celles de Pierre Valdo au XIIe siècle à Lyon qui offrit la connaissance du texte de l’Évangile à ses ouvriers tisserands. C’est à la base de ce projet de Luther et de Calvin d’apprendre à lire aux hommes, aux femmes et aux enfants, même les plus modestes, pour qu’ils puissent lire la Bible par eux-mêmes, qu’ils puissent réfléchir par eux-mêmes, et qu’ils puissent prier Dieu par eux-mêmes et directement. C’est le rôle du travail d’interprétation de la Bible de nous aider à lui donner sa juste place. Cela devrait donner à réfléchir à certaines hiérarchies religieuses.
5 Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant qu’une grande foule venait à lui,
Ce texte commence en disant que Jésus "lève les yeux" pour voir les personnes qui s’avancent vers lui. Il ne les regarde pas de haut en bas, mais de bas en haut, comme un serviteur, ou plutôt comme quelqu’un qui veille sur les besoins d’un autre qu’il aime. Un regard de bas en haut, vous savez, ça se sent. Ça se reçoit comme un geste qui nous met debout, qui révèle notre dignité.
"D’où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci mangent ?"
Après ce regard, Jésus pose une question à ses disciples : comment faire pour nourrir les gens qui sont autour d’eux. Un des grands services de la Bible doit être celui de nous aider à nous poser des questions. Et là il est vrai que nous adorons apporter nos réponses et nos vérités aux autres. Et cela est d’autant plus naturel que nous avons tous des convictions fortes qui nous font vivre, des convictions que nous nous sommes faites en réfléchissant par nous-mêmes du moins je l’espère (comme nous y encourage Jésus, Mt 22:37). "Et il lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée « [Deutéronome 6:5] ». Mais imposer nos vérités est un comportement de roi ou de dictateur, il n’en est pas question. Jésus préfère qu’en a lui, aider les gens à se poser des questions. Bien entendu il a cependant des convictions bien affirmées qui transparaissent mais il les dit souvent d’une façon qui pose question, soit avec une parole visiblement exagérée, soit par une énigme, soit par des gestes symboliques. Ici, Jésus élargit le questionnement de ses disciples à la foule des personnes qui les entourent, il présente comme une évidence qu’ils sont concernés par la faim de ces gens, et les invites à se demander comment faire.
7 Philippe lui répondit : Pour deux cents deniers de pain ne leur suffirait pas, pour que chacun en reçût quelque peu.
8 L’un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit :
9 Il y a ici un petit garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ?
Bien sûr, comme Philippe et André ici, il n’est pas difficile de se rendre compte de l’immensité des besoins de l’humanité, mais ils découvrent aussi que nous ne sommes pas sans avoir une certaine richesse, même si elle semble ridiculement petite, comme celle d’un enfant qui aurait 5 pains d’orge et 2 poissons. Comment cela va-t-il suffire ? On notera aussi que cette "richesse" appartient à un enfant ; parallèle à (Matthieu ch 18 v 4 et 5) "4 Quiconque donc s’abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux ; 5 et quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon nom, me reçoit."
Jésus va multiplier les pains et les poissons venant de cette enfant.
Bien sûr au sens de notre physique, classique c’est impossible et un rapide calcul de physique nucléaire (E = MC2) montre que si Jésus avait physiquement créé une telle quantité de pain (de matière) à partir du vide quantique, il aurait dû utiliser une énergie équivalente à celle développée par plusieurs milliers de centrales nucléaires. Est-ce possible ? Somme-nous en présence d’une utilisation de la pensée en termes de physique quantique ? Je ne peux répondre avec certitude, mais ce serait la seule explication logique pour prendre ce signe (pour employer les termes de Jean) de façon textuelle ! Mais devons nous l’interpréter ainsi et chercher une logique et un comment ? Plus qu’un pourquoi ? Cherchons donc plutôt le symbole, que veut ici nous enseigner Jean sur Jésus, là est la vraie interrogation, qui peut nous apporter une signification à ce texte.
Selon moi, ce récit n’est pas celui d’un reportage sur le formidable développement d’énergie fait par un illusionniste ou un magicien, ni celui d’un reportage sur les possibilités de la physique quantique, tout le monde sera d’accord avec moi ! Mais c’est une mise en récit d’une vérité théologique et existentielle qui nous concerne tous profondément. Ce midrash de Jean nous enseigne qu’il existe des nourritures qui se multiplient miraculeusement si l’on s’y prend bien et avec l’aide de Dieu, ce sont les nourritures spirituelles et cela n’est pas sans conséquences non plus sur les nourritures terrestres.
Ce texte est un midrash et il faut donc l’aborder comme tel pour le comprendre et en tirer un enseignement. La qualité de la nourriture qu’offre cet enfant évoque des richesses spirituelles :
Cinq pains d’orge : ce chiffre cinq évoque la Torah, la Bible, les cinq livres du Pentateuque. Et la Bible est souvent comparée à un pain dans la Bible elle-même. C’est vrai qu’elle a fait ses preuves comme nourriture pour la réflexion et la prière de chacun, de génération en génération et sous toutes les latitudes. La Bible a été multipliée et diffusé dans le monde presque à l’infini.
L’orge : (hébreu sehôrâh). Cette céréale est mentionnée dans la Bible presque aussi souvent que le blé : 36 fois, dont 3 dans le N.T. ; il y est question soit de la plante sur pied (2Sa 14:30, Joe 1:11, Job 31 : 40 etc.), soit de ses semailles (Esa 28 : 25, Lev 27 : 16 etc.) ou de sa moisson (2Sa 21:9 etc.), soit du grain récolté, vanné (Ru 3:2), mesuré (Ru 3:15), préparé pour l’alimentation (Eze 4:9-13), etc.
Au départ on retrouve l’orge dans deux fêtes différentes chez les Hébreux :
- La fête du printemps des nomades :
Le pain sans levain est un pain d’orge (sans gluten) il est consommé à la pleine lune de printemps, pour célébrer l’agnelage et les nouvelles pâtures. L’orge étant une céréale consommée par les animaux. Après la sortie d’Égypte, cette fête rappelle la libération du peuple d’Israël. Elle est célébrée le 14 Nisan (début avril). Accompagnée du sacrifice de l’agneau, elle s’appelle la Pâque.
- La fête du printemps des sédentaires :
Avec le premier coup de faucille est célébrée l’offrande de la première gerbe. Pendant sept jours on mange du pain neuf, du pain d’orge sans levain. Cinquante jours plus tard (soit 5 fois dix et l’enfant avait cinq pains et deux poissons.) avait lieu la fête de la moisson qui deviendra la Pentecôte.
- Les deux fêtes vont se mêler en 622 avant Jésus-Christ et c’est cela que Jésus va connaître : on fête Pâques et commence tout de suite la fête des Azymes, (des pains d’orge sans levain). De là ces paroles de Jésus : « Méfiez-vous du levain des Pharisiens, qui est l’hypocrisie. » (Luc 12:1). Il ressort d’un récit parallèle que Jésus condamnait par là « l’enseignement » des Pharisiens. — Mat. 16:12.
La Bible emploie parfois le mot « levain » comme symbole de corruption.
Ainsi l’orge est au travers le pain sans levain une nourriture spirituelle non corrompue, l’orge étant ici le symbole de la Pentecôte c’est-à-dire de « l’Esprit saint » donc non corrompu.
Les poissons :
D’après Ge ch12v1, ils sont l’œuvre du cinquième jour, comme les grands monstres de la mer et les oiseaux du ciel (voir Création). Ils forment un groupe spécial dans diverses énumérations (Ge 9:2,1Ro 4:33) ; mais nulle part la Bible ne fait un essai de classification, ni de distinction d’espèces ou de genres : elle n’a conservé aucun nom de poisson. La seule division indiquée est d’ordre rituel : entre les poissons purs, qui sont pourvus de nageoires et d’écailles, et les impurs, qui en sont dépourvus (Le 11:9 s). Cette condition devait caractériser les poissons proprement dits, et prohiber les animaux aquatiques, cétacés, amphibies, reptiles d’eau, etc., ou même l’anguille, qui ressemblait à un serpent.
Deux poissons :
En hébreu, le nombre 2 est représenté par la lettre Beth, qui signifie un rayon de lumière sur deux horizons, ou la maison de Dieu et de l’homme entre les deux colonnes du temple de la nature. D’après la Tradition de Moïse, Dieu fit de cette lettre le fondement du monde. Si 1 est l’essence, 2 est lumière vivante, contemplation, face à face.
Ce chiffre de deux évoque la parole et le poisson évoque la vie spirituelle, grandissant sans cesse, gardant toujours l’œil ouvert, évoluant sans cesse dans l’eau de la bénédiction.
En tant qu’Église, ou en tant que chrétien, nous avons été nourris par ces pains et ces poissons, ce n’est pas l’expérience de tout le monde mais c’est notre expérience. Nous avons cela dans notre panier. Cette histoire nous dit que ce n’est pas peu de chose pour nourrir le monde.
Quelle idée a eu cet enfant d’offrir ses pauvres cinq pains et deux poissons ? Quelle idée a eu André de relayer cette offre minuscule ? C’est le miracle du regard de bas en haut comme celui que porte ici Jésus au début, c’est le fait de se poser des questions et de se sentir concerné par les autres, comme Jésus nous y invite.
Ce petit garçon, cet enfant fait un geste, ce geste touche André et éveille en lui un minuscule début d’espérance possible. Jésus partira de ça pour nourrir la foule et en faire un peuple. Comme quoi, les richesses spirituelles peuvent être ainsi, communicatives, contagieuses. Le geste de solidarité du petit garçon apporte une nourriture matérielle modeste mais ce geste est également porteur d’une richesse spirituelle qui, elle, peut se multiplier à l’extrême et faire avancer la situation non seulement sur le plan spirituel mais aussi matériel.
Bien sûr la nourriture spirituelle n’est pas tout, nous avons besoin de nourritures de toutes sortes pour vivre et pour nous épanouir. Mais tous les domaines qui concernent l’être humain sont profondément liés. Adam et Ève dans le Jardin avaient à leur disposition tous les fruits bons à manger pour leurs besoins physiques, et un arbre aux fruits spirituels, c’était l’arbre de vie, et il faut comprendre "comment vivre," la nourriture "physique" mis à leur disposition ne suffisait pas, et Dieu en est conscient, "qu’est-ce que c’est que vivre" pour Dieu, ce qui nous fait penser tout de suite au "pain de vie". Un seul fruit spirituel leur était encore interdit celui de la connaissance du bien et du mal dans sa forme hébraïque il est dit "la connaissance de tous" parce que ce fruit ne se prend pas, il se donne, Dieu devait leur donner en temps voulu. Ce fruit ne se multiplie pas il est donné, il est offert par Dieu lui-même, ce fruit je pense est le Saint-Esprit de Dieu, symbolisé ici dans l’orge des pains. En ce qui concerne les pains matériels, pour que tout le monde ait à manger, c’est une question de ressources, certes, et c’est aussi une question de cœur, d’intelligence, d’enthousiasme. C’est donc une question en grande partie spirituelle.
Jésus nous apprend ici à travailler comme il le voit faire par son Père, multiplier, à démultiplier les dons spirituels, la spiritualité, la nôtre et celle des autres, dans l’Amour des autres.
C’est la seule façon pour que Dieu puise nous donner du fruit de la connaissance de tous, ou "du tout".
11 Et Jésus prit les pains ; et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis ; de même aussi des poissons, autant qu’ils en voulaient.
Jésus commence par rendre grâce c’est-à-dire prier. Il ne prie pas pour "demander à Dieu" de faire pleuvoir des pains. Non, mais la prière de Jésus est en l’occurrence de rendre grâce.
Cette prière est en premier lieu une humilité devant Dieu, humilité de nos forces et de notre sagesse devant un élan et une grâce qui nous dépasse complètement. C’est toujours un regard de bas en haut, il donne à Dieu de nous apporter ce qu’il a à nous apporter, et c’est toujours une bonne surprise, et cela vaut mieux que de penser devoir expliquer à Dieu ce qu’il devrait faire !
La prière de gratitude nous aide aussi à méditer et nous réjouir sur ce qu’il y a de bon en nous et dans notre vie, et celle des autres, ce qu’il y a de merveilleux dans ceux qui nous entourent. Oui, même quand nous sommes sans travail, abandonnés, malades, trop jeunes ou trop vieux, même quand nous sommes coupables d’horribles choses, nous avons de vraies richesses de toutes sortes en nous.
La prière de gratitude change aussi notre façon de concevoir la propriété personnelle. Que serions-nous, qu’aurions-nous si nous n’avions rien reçu par grâce ? Si nous n’avions jamais été aimés, si nous n’avions pas été nourris dès notre enfance, accueillis dans une culture, une société ? Cette prière nous apprend à recevoir mais aussi à donner.
Bref, cette prière de gratitude replace l’ensemble dans une vision non seulement de bas en haut, mais aussi de haut en bas, de très haut pour voir qu’un petit geste serait un beau prolongement à cette gratitude, qu’un petit geste de bas en haut changerait le monde et nous donnerait de la joie.
Le regard qui fait se sentir digne, le questionnement qui fait se sentir responsable, la prière, le geste d’un petit, l’encouragement d’un autre… Tout cela ce multiple tranquillement sous les mains et la prière du Fils de l’Homme.
14 Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde.
15 Jésus donc, sachant qu’ils allaient venir et l’enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul.
16 Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer.
17 Et étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l’autre côté de la mer, à Capernaüm. Et il faisait déjà nuit, et Jésus n’était pas venu à eux.
Les disciples sont épatés par Jésus. Ils reconnaissent en lui quelque chose qui vient de Dieu et veulent le faire roi, mais aussitôt, Jésus disparaît à leurs yeux. Et en une phrase, le texte nous montre le résultat de cette espérance déplacée : les ténèbres tombent sur eux et ils descendent vers la mer, comme si leur être s’enfonçait dans le chaos originel.
Vouloir prendre Jésus pour le faire roi et régner sur nous, est donc source de régression, combien bien plus encore quand c’est notre religion, notre Bible, notre Église ou notre catéchisme, quand c’est sur l’état la politique, ou les pouvoirs sociaux que l’on compte pour penser et pour agir à notre place, pour être prophète à notre place, pour aider notre voisin à notre place, pour aider nos frères et sœurs à notre place…
Les disciples comme la plupart des chrétiens rament dans le noir, Jésus a refusé d’être roi, Jésus a refusé de régner sur eux ; il va falloir regarder et penser par nous-même (ne vais-je pas me tromper ?), il va falloir agir, donner soi-même de sa propre richesse (est-ce que c’est bien utile, et ne va-t-on pas manquer ?), et puis l’abîme est trop profond… Pourtant Dieu est présent comme un souffle sur leur visage, mais même de ce souffle, ils en ont peur. Alors Dieu se rend encore plus présent, encore plus visible, encore plus audible en Jésus-Christ. Il est un acte visible de Dieu pour créer l’humain. Il ne vient pas pour régner à notre place, mais pour nous élever comme on élève un enfant.
Et finalement le bon rapport, le bon usage que l’on peut faire de Dieu, c’est tout simplement de "vouloir le prendre dans notre barque". Jésus n’est pas fait pour régner sur nous, mais pour nous accompagner, pour nous donner ce réconfort qui nous manque afin de monter plus haut, et de savoir regarder d’en bas.
16 Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer.
17 Et étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l’autre côté de la mer, à Capernaüm. Et il faisait déjà nuit, et Jésus n’était pas venu à eux.
18 Et la mer s’élevait par un grand vent qui soufflait.
19 Ayant donc ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils voient Jésus marchant sur la mer et s’approchant de la nacelle ; et ils furent saisis de peur.
20 Mais il leur dit : C’est moi, n’ayez point de peur.
21 Ils étaient donc tout disposés à le recevoir dans la nacelle ; et aussitôt la nacelle prit terre au lieu où ils allaient.
Après la multiplication des pains, les disciples semblent avoir attendu longtemps Jésus, parti seul dans la montagne quand ils voulurent le faire roi, quand ils voulurent qu’il dirige pour eux leur vie, leur société, leur État. Laissés à eux-mêmes, sans consigne particulière, ils vivent ensemble l’absence de Jésus, si bien symbolisée par la pénombre où ils se trouvent : "Et il faisait déjà nuit, et Jésus n’était pas venu à eux." l’obscurité, la nuit est tombée, les ténèbres autour les disciples, et Jésus n’était pas encore venu à eux. Ils sont seuls, dans une barque au milieu des eaux du lac de Tibériade, (l’eau qui symbolise ici le chaos) et Jésus semble ne plus pouvoir les rejoindre maintenant, ils sont seuls, comme ils seront seuls durant trois jours après la mort de Jésus. Ténèbres extérieures, ténèbres intérieures : ils sont entrés en semble dans l’épreuve, et ils rament, ils rament pendant cinq ou six kilomètres ils ne savent pas, ils ne savent plus rien, une seule chose ils rament en direction de Capharnaüm, "la consolation" luttant contre la mer "qui s’est réveillée au souffle d’un grand vent".
La mer a toujours été, pour les Hébreux, l’élément redoutable par excellence. Bien que le Créateur lui ait fixé une limite à ne pas franchir (Jb 38,10), elle est, pour les croyants d’Israël, le symbole des forces mauvaises dont Dieu seul peut triompher : "Lui seul a foulé les hauteurs de la mer", dit Job (Jb 9,8), et un Psaume évoque le Seigneur Dieu marchant sur les eaux démontées : "Sur la mer fut ton chemin, ton sentier sur les eaux innombrables ; et tes traces, nul ne les connut" (Ps 77,20). Nous sommes toujours dans ce midrash de Jean.
Dès les premières lignes de la Bible, la vie naît comme "au travers des eaux », les eaux de l’abîme, des eaux potentiellement menaçantes qu’il convient de séparer entre celles « d’en-haut » et celles « d’en-bas », puis de séparer de la terre ferme (lire Genèse 1,1-10), pour permettre la vie. En écho, on trouve aussi le Dieu libérateur qui ouvre pour son peuple un passage au travers de la mer (Exode 14,15-31).
Dans le Nouveau Testament, pensons à la tempête apaisée par Jésus (Marc 4,35-41) qui, à l’image du Dieu créateur impose son autorité contre les puissances du chaos figurées par la mer démontée. Pensons encore aux esprits impurs de Guérasa entrés dans les cochons et qui les précipitent pour se noyer dans la mer (Marc 5,13) ; la version lucanienne parle de « l’abîme » indiquant par là le sens symbolique de cette eau qui engloutie les porcs.
Mais à côté de cela l’eau peut être vivifiante.
À côté de ces eaux inquiétantes, de très nombreux passages de la Bible Hébraïque présentent l’eau comme indispensable à la vie (Genèse 2,5 ; 21,14-21), et la sécheresse comme l’une des pires calamités (1Rois 17 — 18). Sources et puits sont donc des lieux de conflit pour la maîtrise de cet élément vital qu’est l’eau (Genèse 21,25s ; 26,15-33), mais ils sont aussi des lieux de rencontres obligés pour le meilleur de ce que la vie peut donner (Genèse 29,10 ; Cantique des cantiques 4,15).
De façon plus symbolique, l’eau, et en particulier « l’eau vive » est aussi l’un des éléments essentiels des rites de purification (Lévitique 14,5-6.50-52 ; Nombres 19,17) et donc de restauration de la vie.
Quelle eau pour le baptême ?
Si dans son apparence le rite baptismal chrétien prolonge les ablutions juives de purification (comme semble le faire Jean Baptiste ; Matthieu 3,1-5), Paul semble en abandonner la signification purificatrice. Le baptême est en effet pour Paul une assimilation symbolique à la mort de Jésus Christ sur la Croix (Romains 6,1-11). Ainsi, pour Paul, ce n’est pas dans l’eau qu’on est baptisé, mais « dans la mort de Jésus Christ » ! Ce n’est que sont point de vue. Pour Jean il s’agit plus de mourir à sa vie ancienne («noyer le vieil homme ») pour « naître d’en haut d’eau et d’Esprit » plus que de la mort de Jésus-Christ réinvestissant ainsi la dimension vivifiante de l’eau (3,5).
Cependant, la symbolique purificatrice de l’eau est si forte qu’elle sera rapidement réintroduite dans la compréhension du baptême : typiquement la lettre aux Ephésiens et celle aux Hébreux (qui ne sont donc peut-être pas attribuables à Paul pour cette raison) renouent avec la symbolique purificatrice de l’eau (Ephésiens 5,26 ; Hébreux 10,22).
Ainsi, on retrouve dans ces symboliques différentes de l’eau du baptême l’ambivalence fondamentale de l’eau qui traverse toute la Bible.
Donc Jésus, sur la mer, vient au-devant de sa communauté la barque est image de l’Église. D’ailleurs qu’en ses disciples veulent le faire venir dedans ce n’est plus possible ils ont atteint leur but. L’on peut comprendre que Jésus n’appartient pas à une église terrestre en particulier il n’est pas dans les murs d’un bâtiment appelé église, mais quand on l’invite à venir dans notre communauté "église" nous sommes arrivés sur le rivage de la consolation.
De cet épisode saisissant Jean nous donne le récit le plus court, et sous la forme probablement la plus primitive. Il résume le miracle et ne s’attarde pas à décrire l’apaisement de la mer : dans cette marche de Jésus sur le lac il voit avant tout une épiphanie, une manifestation de la majesté divine qui habite Jésus. "Lui seul a foulé les hauteurs de la mer", Job (Jb 9,8), ainsi que "Sur la mer fut ton chemin, ton sentier sur les eaux innombrables ; et tes traces, nul ne les connut" (Ps 77,20).
D’où la crainte sacrée qui saisit les disciples, crainte que Jésus immédiatement veut écarter : "C’est moi ! cessez d’avoir peur !"
La veille, la foule, impressionnée par le miracle des pains, a voulu acclamer Jésus comme le Prophète, comme un Messie politique ; mais aucun de ces titres traditionnels ne rend vraiment compte de la mission et de la majesté de Jésus. Le nom qui lui convient, c’est le nom de fils de Dieu, Fils de l’Homme, ce Dieu qui a nourri son peuple au désert, et qui auparavant lui avait frayé un chemin dans les eaux. Jésus dit : "C’est moi", comme Dieu si souvent l’a dit à son peuple. Jésus vient sur les eaux comme Dieu seul l’a fait, et n’oublions pas ces paroles de Jésus au chapitre précédent "Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu’il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de même le fait."
Et il réalise pour ses disciples ce que Dieu promettait à son peuple par le prophète Isaïe : "Quand tu traverseras les eaux, ne crains pas ! Je serai avec toi, car je suis le Seigneur ton Dieu. "Ne crains pas" les disciples veulent accueillir Jésus dans la barque, mais celle-ci accoste à l’instant même, sans même que Jésus soit monté à bord. Au moment même où les disciples reconnaissent Jésus et veulent lui faire place parmi eux, "la barque touche terre au lieu où ils se rendaient". La confiance en Jésus les a donc fait passer de la mer menaçante à la terre ferme, du combat impuissant à la sécurité. Arrachés au domaine de la mort, les voilà parvenus "au port de leur désir" (Ps 107,30).
Jésus les a nourris, puis il leur a donné de traverser la mer. Un double symbolisme pascal sous-tend ici le texte évangélique, en référence au don de la manne et au passage de la Mer Rouge.
Ajouter un commentaire