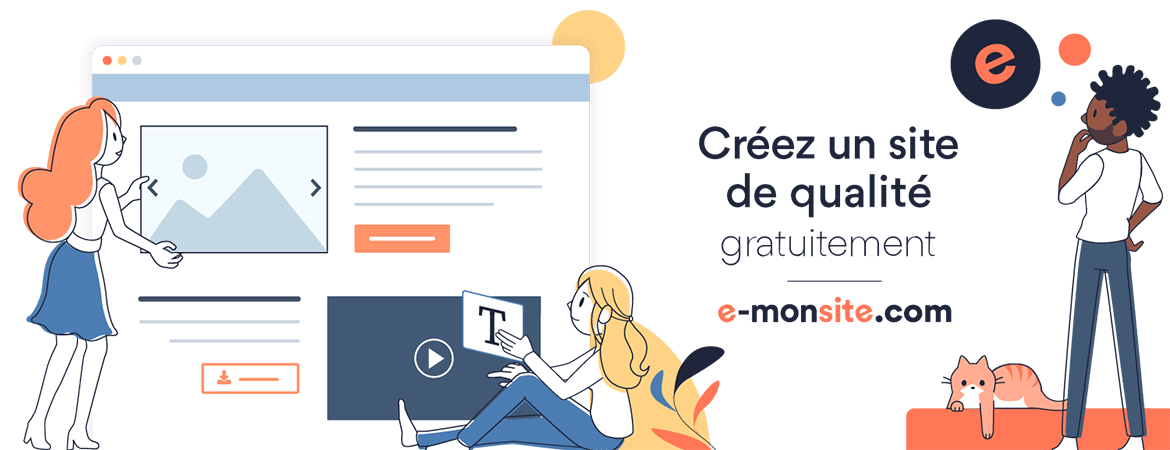- Accueil
- Théologie libérale
- La doctrine du péché originel
La doctrine du péché originel
La doctrine du péché originel (avec la promesse du rachat qu’elle entraîne) est non seulement un des enseignements essentiels du christianisme historique que j’appellerais classique, mais aussi une doctrine incontournable de celui-ci, qui sans cela perdrait sa cohérence et son intégrité. Pour le philosophe Arthur Schopenhauer, c’est une évidence : « En définitive, la doctrine du péché originel (affirmation de la volonté) et de la rédemption (négation de la volonté) est la vérité capitale qui forme, pour ainsi dire, le noyau du christianisme ; tout le reste n’est le plus souvent que figure, enveloppe ou hors-d’œuvre (“Le Monde comme volonté et représentation, t. 1, livre 4,”) Dans Parerga et paralipomena il répète sa définition du christianisme : “L’augustinisme avec sa doctrine du péché originel et tout ce qui s’y rapporte […] voilà le véritable christianisme, pour peu qu’on le comprenne bien.”
Comme Schopenhauer, mais plus proche de nous, le philosophe, poète et écrivain roumain Emil Cioran, désigne lui aussi le péché originel comme l’élément essentiel du christianisme :
L’éminent ecclésiastique se gaussait du péché originel. “Ce péché est votre gagne-pain. Sans lui, vous mourriez de faim, car votre ministère n’aurait plus aucun sens. Si l’homme n’est pas déchu dès l’origine, pourquoi le Christ est-il venu ? Pour racheter qui et quoi ?” À mes objections, il n’eut, pour toute réponse, qu’un sourire condescendant. Une religion est finie quand seuls ses adversaires s’efforcent d’en préserver l’intégrité » (Aveux et anathèmes, Paris, Gallimard).
Nietzsche lui aussi a su, avec la plus grande violence, en démasquer la source perverse dans la généalogie de la morale : « Avec la moralisation des concepts de dette et de devoir […] les hommes devront se retourner contre le “créancier”, le principe de l’espèce humaine, l’ancêtre, dorénavant affligé d’anathème (“Adam”, “péché originel”, “privation du libre arbitre”) […] jusqu’à ce que nous nous trouvions tout d’un coup devant le paradoxal, le terrible expédient grâce auquel l’humanité martyrisée a trouvé un soulagement temporaire, coup de génie du christianisme : Dieu lui-même s’offrant en sacrifice pour payer la dette de l’homme ! »
Autant dire que le péché originel apparaît à beaucoup comme une scène primitive, fantasmatique et obsédante, destinée à rendre indispensable le recours à la grâce divine, voire aux pénitences infligées par des prêtres et aux sacrements administrés par eux. On conçoit que, dans ces conditions, cette doctrine théologique apparaisse comme étant le fardeau héréditaire dont il faut libérer l’humanité pour la rendre libre et heureuse, à tout le moins émancipée et responsable devant elle-même. Depuis au moins trois siècles, la culture moderne s’emploie à reléguer le péché originel parmi les archaïsmes encombrants et malfaisants.
Il convient alors d’observer ce que devient l’humanité purgée de la confession du péché originel, si « originel » ne veut pas dire chronologiquement archaïque, mais ontologiquement universel, selon le passage du Psaume 14 repris par l’apôtre Paul dans l’Épître aux Romains : « Il n’y a pas de juste, pas même un seul. Il n’y a pas d’homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble perverti, pas un qui fasse le bien, pas même un seul ».
Le péché originel est affaire du Christianisme le Judaïsme quant à lui et donc pour Jésus lui-même dont la pensée baigne dans cette culture, ignore la notion de péché originel (c’est Augustin qui l’a systématisée au IV siècle). L’histoire d’Adam et Ève, dans la perspective juive, est une préfiguration de la vie humaine : la faillibilité est la condition du dialogue avec Dieu.
Le récit de la faute originelle n’est jamais repris dans la Bible hébraïque. Les textes, loin d’admettre une fatalité héréditaire et universelle, liée à la faillibilité d’Adam, soulignent au contraire la possibilité sans cesse offerte à l’homme, du choix (en l’informant des conséquences). L’engrenage du mal n’est pas inévitable, la faute n’est pas une chute, mais un levier : si Adam a échoué, les actes de ses descendants ne sont pas pour autant entachés de nullité : ces actes, magnifiés sous la forme de la Mitsva, ont même une fonction rédemptrice.
Comme référence originelle, la prière juive préfère rappeler le « mérite des pères (fondateurs du peuple d’Israël) » pour implorer la miséricorde divine. Quant au verset « Il poursuit la faute des pères sur les enfants (…) » (Ex. XXXIV, 7), il ne signifie pas que les descendants sont punis pour expier les méfaits de leurs ancêtres ; il met en évidence le fait que toute action a des conséquences, que tout comportement affecte les générations à venir, en bien (cf. début du verset 7) ou en mal.
On sait que le récit de la désobéissance d’Adam, origine de la mort, forme un épisode isolé dans l’Écriture ; jamais dans les autres parties de la Bible il n’y est fait allusion, non plus qu’à la doctrine qui s’en dégage. Même les Psaumes, qui trahissent une préoccupation inquiète du péché, ne rappellent jamais la faute du premier homme.
Il est vrai qu’on a prétendu y trouver la conception de la coulpe, se transmettant d’Adam à ses descendants et entachant fatalement l’âme. Celte idée aurait trouvé sa pleine expression dans le verset suivant : « En vérité, j’ai été enfanté dans l’iniquité, et c’est dans le péché que ma mère m’a conçu » (Ps. 51, 5). Mais est-il nécessaire de montrer la fragilité d’une pareille exégèse, qui n’est plus admise par aucun critique sérieux ?
Moins heureuse encore est l’opinion d’après laquelle Isaïe, 13, 27, citerait la vieille tradition : « Déjà, ton premier père a péché, et tes intercesseurs m’ont été infidèles ». Il n’y a même pas ici réminiscence de la chute d’Adam : le prophète, comme l’atteste suffisamment le second membre de phrase, invoque l’histoire d’Israël.
Ainsi, si l’on écarte le chapitre 3 de la Genèse, la théologie biblique est muette sur l’origine de la mort due à la faute d’Adam ; à plus forte raison ignore-t-elle les conséquences psychologiques et eschatologiques de cette déchéance.
Il faut attendre le IIe siècle avant J.-C pour que Ben Sira écrive dans son « Séracide ou Ecclésiastique » le premier écho du récit de la Genèse, et quel écho ! Parlant de la méchanceté féminine, il termine le couplet par cette pointe : « C’est avec la femme qu’a commencée le péché, et c’est à cause d’elle que tous nous mourons » (25, a 3). C’est le mot de la fin, un dernier trait satirique. Il n’est pas étonnant que l’Ecclésiastique de Jésus, fils de Sirach, ait été le manuel de morale favori du Moyen Âge chrétien. Admise aux honneurs de la canonicité cette œuvre juive fut citée avec prédilection par les prédicateurs de l’Église et ses préventions à l’égard des femmes étaient bien faites pour la rendre populaire auprès des ecclésiastiques, y cherchant matière à leur inspiration et il n’est pas étonnant qui mirent à profit un récit qui fournissait si bien des armes à leur misogynie. Aussi rien de plus plaisant que le sérieux avec lequel un ancien commentateur de l’Ecclésiastique, Bretschneider dénonce la contradiction de cette sentence avec l’opinion exprimée au chapitre 14 17, dans un paragraphe d’ailleurs singulièrement épicurien : « Toute chair s’use comme un vêtement, et c’est une loi éternelle qu’il faut mourir ».
Saint-Augustin avait une conception corrompue du péché originel. Pour lui, en naissant, l’enfant était couvert de boue et il fallait le laver par le baptême, pour le rendre digne de Dieu. Sous l’influence de la pensée de Saint-Augustin, en 418, le concile de Carthage approuve cette doctrine.
Cependant, dix-huit évêques n’étaient pas d’accord et le Pape lui-même présent n’était pas plus enthousiasme face à cette nouvelle doctrine sur le péché originel.
Certes, Saint-Augustin n’a pas inventé la notion de péché, que l’on trouve dans la Bible, mais l’invention de Saint-Augustin fut son interprétation négative culpabilisante de celui-ci.
Quitte à me répéter, je le redis, on ne trouve pas dans la Bible, cette vision négative de l’être humain, proclamé par Saint-Augustin.
D’après les textes bibliques, le péché est un enfermement sur soi, un état de non-relation à l’autre.
Quand Jésus s’adresse à la femme adultère, l’expression française donne ceci : « Va, et ne pèche plus ». Or le verbe grec donne l’invitation suivante à la femme condamnée : « ne manque plus ta cible ; si tu te trompes de chemin, tu vas te perdre. » Puis Jésus se tourne vers les accusateurs et leur dit, selon le verbe grec : « Que celui qui n’a jamais dévié de son chemin, que celui qui n’a jamais rompu une relation lui lance la première pierre ! En commençant par les plus vieux, les accusateurs se retirèrent. » Présentement, qui sommes-nous pour lancer la première pierre à celui ou celle qui ne pense pas ou ne croit pas comme nous ?
Malheureusement, cette vision pessimiste de l’être humain, inventée pas Saint-Augustin fut transmise de génération en génération. Encore aujourd’hui, pour de nombreux chrétiens le rituel baptismal présente l’enfant comme habité par le péché et coupé de Dieu. Si l’enfant n’est pas lavé par le baptême, et qu’il va aux limbes, il n’est pas digne du Ciel.
Et justement, la désaffection de l’Église vient certainement, d’avoir lancé des pierres à tous et à chacun.
Le péché, acte qui a pour effet la transgression d’un commandement négatif ou la non-observance d’un commandement positif, trouve le début de ses diverses spéculations religieuses dans le judaïsme. Nulle part ailleurs dans l’Antiquité, on ne trouve cette élaboration sur le péché, non pas tant au point de vue théologique qu’au point de vue de l’action (ou de l’omission) en infraction à la Loi divine. Dans tous les cas, dans le judaïsme, la responsabilité du pêcheur est engagée devant Dieu, que ce soit pour des fautes commises envers son prochain, ou pour des manquements aux devoirs envers le Créateur.
Les textes bibliques comptent une trentaine de termes différents pour désigner les péchés, mais ils peuvent être classés dans trois grandes catégories. Le terme le plus important est חֵטְא (« het) qui apparaît plus de six cents fois dans la Bible hébraïque ; la racine sur laquelle il est formé signifie « manquer le (passer à côté du) bien ». Ce terme lui-même, ainsi que tous ceux qui en dérivent, est appliqué à tous les types de péchés (social ou rituel, volontaire ou involontaire). C’est toutefois le seul qui désigne la catégorie la moins grave de péché : la transgression involontaire d’une loi rituelle.
Le second terme, par ordre ascendant de gravité, est עָוֺן (« avon ou `avown.) Traduit généralement par « iniquité », il fait intervenir l’idée d’acte délibéré, et est donc beaucoup plus grave que le חֵטְא het. Bien qu’il puisse correspondre parfois à la transgression d’une loi rituelle, il désigne généralement la faute commise envers son prochain, en infraction aux lois étiques sociales, par exemple : les actes impliquant l’injustice, le dérèglement ou la perversion.
Le troisième terme qui désigne le péché est פֶּשַׁע (pesha). Traduit généralement par « transgression », il renvoie, plus exactement, à l’idée de « rébellion ». C’est le type de péché affecté du plus fort coefficient de gravité. (...). Le פֶּשַׁע (pesha) ne fait jamais explicitement référence à la transgression de la loi rituelle. Rabbi David « Qimhi » (Radaq) note que le concept de פֶּשַׁע (pesha) implique « un refus conscient et délibéré de reconnaître l’autorité du Maître, ou d’obéir à celui de qui émane un commandement ». En terme religieux, le פֶּשַׁע (pesha) est un acte délibéré de rébellion contre Dieu par la transgression de Sa Loi.
Dans la littérature rabbinique, les trois concepts ainsi distingués interviennent dans la définition unique du péché, dont ils sont, en quelque sorte, la triple dimension. C’est ainsi que dans l’acte répréhensible apparaît la dimension du חֵטְא (« het), par lequel « l’on manque le but », échec par rapport à l’idéal le plus haut ; la dimension du עָוֺן (« avon ou `avown.), par lequel on quitte le « sentier de rectitude », de la justice et du droit ; la dimension du פֶּשַׁע (pesha), par lequel on se rebelle, en pleine connaissance de cause, contre la Loi et le divin législateur. Dans la théologie rabbinique, certains péchés sont toutefois plus réprouvés que d’autres. Par exemple, un acte positif de transgression est plus répréhensible que l’acte négatif d’abstention d’un acte prescrite. De même, un péché commis en infraction d’une loi de la Torah est plus grave qu’un péché commis en infraction à une règle d’origine rabbinique. Les trois péchés les plus graves sont l’idolâtrie, le meurtre, l’inceste ; la mort doit être préférée, et acceptée, plutôt que de commettre l’un de ces trois péchés (nonobstant, par conséquent le principe de, פיקוח נפש, [Pikuach nefesh] selon lequel toute obligation religieuse s’annule devant un danger même indirect d’atteinte à l’intégrité de la personne).
La littérature rabbinique connaît également le terme עֲבֵרָה avérah pour désigner le péché. Au sens étymologique, il signifie « transgression », et correspond à tout acte positif de transgression d’une loi rituelle médico-sociale.
La réparation du péché ou d’une infraction à la Loi consiste en l’offrande d’un sacrifice expiatoire, la restitution, ou le retour au statu quo ante, et souvent le repentir, ce qui dénote l’attitude pragmatique du judaïsme face aux faiblesses et manquements de l’être humain. La morale religieuse pratique s’étend peu sur les questions de l’origine du péché et sur la condition humaine d’avant ou d’après le péché d’Adam ; rares sont aussi les considérations sur les conséquences du péché du premier homme sur ses descendants. Sauf quelques références, formulées de manière plus ou moins ambiguë, dans la littérature hassidique et dans la kabbale, le judaïsme normatif rejette résolument l’idée d’une nature humaine irrémédiablement corrompue depuis le « péché originel » adamique. C’est ainsi que le verset biblique selon lequel Dieu fait retomber « le crime des pères sur les enfants » ne doit pas s’entendre au sens théologique de l’inévitable transmission du statut de pécheur de génération en génération. Le verset ne signifie pas que les enfants seront châtiés pour le crime commis par leurs pères ; il ne concerne que ceux qui, libres de leur choix, sont « ceux qui m’offensent » en suivant leurs pères sur la voie du péché. La doctrine de la responsabilité individuelle, tel que l’expose la Bible, est au cœur de toute la pensée religieuse juive.
Sur le plan psychologique, les rabbins rapportent le péché au יֶצר הר yètser ha-ra, le « mauvais penchant » qui fait partie de la nature humaine. Cette approche psychologique du péché constitue un des thèmes importants de la tradition de la kabbale et de la littérature hassidisme. Elle est clairement formulée dans le livre de l’Ecclésiaste : « Car il n’est pas homme juste sur terre qui fasse le bien sans jamais faillir ». Les rabbins opposent au יֶצר הר yètser ha-ra, le יצר הטוב yètser ha tov, le « bon penchant ». L’homme est surtout un être doué de libre arbitre.
L’homme peut être dominé, fût-ce momentanément, par son mauvais penchant ; il peut toujours choisir d’en maîtriser le cours. Il est libre d’obéir et de désobéir, d’agir conformément aux prescriptions divines ou de les rejeter ; c’est cette liberté qui, au regard du judaïsme, constitue la grandeur de l’être humain, et le rend capable d’un choix moral.
Le concept juif du péché apparaît souvent sous son aspect purement légaliste. Cependant, le judaïsme n’ignore pas, la dimension métaphysique et spirituelle de la faute et du sentiment de culpabilité qui affecte la conscience morale de l’homme. Cet aspect apparaît dans le livre du prophète Habacuc ; il décrit le péché comme une « blessure de l’âme », comme une atteinte à l’équilibre spirituel de la personne, qui brise sa relation à Dieu. (…) Le péché atteint ce que la créature recèle de sainteté, la détache et l’éloigne de son Créateur.
Les philosophes juifs du Moyen Âge ou de l’époque moderne tentèrent eux aussi de rendre compte des conceptions bibliques et rabbiniques du péché, mais leur réflexion vise moins le concept rabbinique de עֲבֵרָה avérah qu’à montrer que l’homme qui pèche dérobe à son idéal le plus noble en se refusant, consciemment ou non, à l’actualisation pleine et entière de ses plus hautes potentialités. L’idée de réparation de la faute, qui rétablit la relation de l’homme à Dieu et qui parcourt toute la littérature religieuse juive, a son fondement dans le pouvoir et le devoir de sincère repentir qui seul restaure l’être humain dans la plénitude de son être. «
Thomas RÖMER, professeur d’Ancien Testament à l’Université de Lausanne et titulaire de la chaire “Milieux bibliques” du Collège de France depuis 2007, nous explique que la Bible est déjà la “synthèse” de nombreuses influences de plusieurs groupes religieux. Le texte même de la Bible relate les pérégrinations d’un peuple confronté à de nombreuses influences et s’il semble vouloir faire des croyances de ce peuple quelque chose de très original (un monothéisme sourcilleux) venant directement de Dieu, reprend un certain nombre de thèmes très répandus dans l’Antiquité. C’est le traitement original de ces thèmes qui donne au peuple “juif” sa cohésion et sa culture propre.
Par ailleurs, la pratique religieuse est beaucoup plus révélatrice de la morale que les textes. Chaque variante du judaïsme édicte et surveille l’application d’un réseau plus ou moins serré de prescriptions sexuelles, alimentaires, vestimentaires, relationnelles (dominants/dominés) qui insère le fidèle quotidiennement. Est pêche toute transgression de la loi, et ce péché s’intègre dans la nature du pécheur.
Pour revenir à ce que nous dit Thomas RÖMER de la Bible qui est aussi un récit des origines de l’humanité, même si le thème du péché originel apparaît peu comme tel dans le judaïsme, “la question des origines préoccupe les religions, les systèmes philosophiques et bien sûr la science. Le Proche-Orient connaît un certain nombre de récits de création qui combinent la question de l’origine du monde et celle de l’homme, d’autres textes sont davantage centrés sur l’homme et la question de sa relation avec les dieux, mais aussi avec les animaux.” L’auteur explique qu’ » il y a plusieurs modèles pour décrire les origines. En Égypte, on trouve souvent l’idée que les dieux enfantent le monde, ce qui est aussi le cas dans le psaume 90 (de la Bible) (…). Dans ce psaume, Yhwh est décrit à la manière d’Atoum, un dieu préexistant, qui donne naissance à la Terre, mais à la manière d’une femme, en l’enfantant.
L’idée que l’univers est le résultat de la victoire contre le chaos est largement répandue, en Égypte, en Mésopotamie et dans le Levant. Dans la Bible, on trouve un certain nombre de psaumes, où le dieu d’Israël combat la Mer pour ensuite mettre en place le monde créé. Dans les épopées d’Enuma-Elish et d’Anthra-Hasis, la création des hommes se fait par le mélange de l’argile et du sang d’un dieu mis à mort. L’insistance est mise sur un lien étroit entre les humains et le monde des dieux, les hommes ont en eux quelque chose de l’« essence divine ».
Qu’en est-il dans la Bible hébraïque ?
On trouve deux idées assez différentes dans les récits (de la Genèse). Le récit de Genèse 1 présente ainsi l’œuvre créatrice d’une manière très ordonnée et harmonieuse. Le langage, la vision du monde et les préoccupations exprimées par le texte de Genèse 1 indiquent qu’il provient de prêtres judéens exilés à Babylone à la suite de la destruction de Jérusalem en 587 avant notre ère ou revenus de Babylone, probablement vers la fin du VI siècle ou le début du V siècle (…). Ces prêtres ont eu connaissance, lors de leur séjour à Babylone, des cosmogonies babyloniennes ainsi que de leurs réflexions mathématiques et astrologiques. Ils ont donc repris le savoir et les concepts de la civilisation babylonienne tout en les adaptant à la théologie du judaïsme naissant. Gn 1 relate, tout comme Enuma Elish, la création comme une « victoire » du bien créateur sur le chaos aquatique. Mais contrairement au mythe babylonien, en Gn 1, il n’y a plus trace de combat. Lors de la création du premier couple humain, Dieu (Elohim) dit : « Faisons l’homme à notre image ». Pourquoi ce pluriel ? On a parfois postulé qu’il s’agit d’un plusieurs de majesté, mais une telle figure de style n’est pas plausible. On a par conséquent pensé que nous avons ici un résidu de l’idée d’une cour céleste au milieu de laquelle Dieu trône entouré de ses conseillers.
Peut-être pouvons-nous aller un pas plus loin : comment Dieu crée-t-il l’être humain « à son image » : mâle et femelle. Donc, il peut s’agir d’un résidu du couple divin (le dieu créateur avec sa parèdre) qui crée le couple humain à son image, comme le dit aussi Enuma Elish. (…) L’idée que tout être humain soit image de dieu peut se comprendre comme une démocratisation de l’idéologie royale.
Les chapitres 2-3 de la Genèse présentent une version très différente de la création des hommes et de leur séparation avec dieu.le récit ouvre par un manque : il n’y a pas encore de pluie, et il manque l’homme pour cultiver le sol. Pour remédier à ce manque, Yhwh crée alors l’homme à la manière d’un potier (…). Yhwh forme Adam avec de la terre (…) mais pour qu’il devienne vivant, il lui faut également, comme dans les mythes mésopotamiens, un élément divin. Cependant, la Genèse évite l’idée du sang divin dans l’homme, le sang est remplacé dans la Genèse par le souffle divin que Yahvé insuffle à l’homme dans ses narines et qui le rend vivant. L’allusion au sang n’est peut-être pas totalement absente à cause du jeu de mots entre le sang דם (dam) et l’homme אָדָם, (« adam) pris de la terre rougeâtre הָאֲדָמָה (« adamah).
Gn 2,18 fait un constat anthropologique : l’homme a besoin d’un vis-à-vis, quelqu’un qui lui soit une aide, mais dans lequel il se retrouve ou se reflète. Le même constat sous-tend l’épopée de Gilgamesh. Yhwh curieusement crée l’homme et l’animal, parenté qui est évidente dans un contexte rural du premier millénaire avant notre ère, où les hommes et les animaux sont en contact permanent. Apparemment, Yhwh expérimente pour trouver le vis-à-vis adéquat pour l’homme. Il y a, comme dans le premier récit de la création en Gn 1, l’idée d’une cohabitons pacifique entre hommes et animaux qui prendra fin au moment où l’ordre du jardinet perturbé par la transgression de la femme et de l’homme. La femme qui est créée ensuite par une sorte de dédoublement de l’homme primordial représente ainsi un véritable vis-à-vis pour l’homme, mais leur relation reste néanmoins inégale, puisque c’est l’homme qui nomme la femme, comme il a nommé les animaux.
Leur premier état dans le jardin ressemble à celui d’Enkidu après sa création : ils sont nus, n’ont pas l’expérience de la sexualité (…), et ne sont pas encore entièrement différenciés des animaux (…).
L’idée de l’expulsion du jardin qui se trouve en Gn3 reprend le motif de l’expulsion d’un être primordial qui a laissé une trace (…). En Gn3, l’agent provocateur de la transgression est le serpent, animal qui tient un rôle important dans les mythologies en général. Dans le récit de la Genèse, le serpent n’a pas d’autonomie, car il fait partie des créatures de Dieu, mais joue le rôle d’agent provocateur, il a un côté prométhéen. Par les sanctions que Yhwh inflige au serpent, à la femme, à l’homme, le texte expliquer comment la souffrance et la mort sont arrivées dans la création, tout en insistant sur le fait que, malgré la sanction divine, la vie reste possible. C’est seulement après la transgression que l’homme donne un nom à la femme, qu’il y a une individualisation. Le nom de Hawwa (Ève) explique que malgré la mort qui est le destin de tous les hommes, la vie reste possible, via la descendance, la femme pouvant enfanter, donner la vie, et ainsi faire face à la mort. L’expulsion du jardin est une réflexion sur l’autonomie de l’homme face au monde des dieux. L’homme a une certaine liberté face à Dieu, mais il faut aussi en assumer les conséquences. En même temps, cette liberté est quelque peu limitée, car si le serpent est un agent provocateur, on peut se poser la question de savoir si ce n’est pas Yhwh lui-même qui pousse l’homme à la transgression, pour qu’il occupe son espace à lui.
Notre auteur poursuit sur les violences divines/violences humaines, la diversité des cultures et des langues, les amitiés, amours, sexualités, les interdits sexuels, l’homme face à la mort, la pensée sur une fin absolue, la colère et le politique, la maladie, résultat de la colère divine… Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est ce que le récit biblique nous dit des violences divines et des violences humaines. Par-delà les diversités culturelles, les mêmes thèmes reviennent dans les récits mythologiques mésopotamiens, babyloniens, sans compter ceux d’Égypte. Et parmi ces thèmes, celui de la violence n’est pas traité en tant que tel. Dans un univers à la vie brève et souvent interrompue de manière violente, ceci ne peut nous étonner. Et pourtant cette question de la violence, si souvent posée de nos jours (souvent d’une manière critique), se relie à celle du mal, qui lui est très évoqué partout. La Bible se centre souvent pour dénoncer la responsabilité (culpabilité) de l’homme dans l’origine du mal, même si elle le fait de manière éminemment plus subtile que les cohortes de prédicateurs des religions monothéistes.
« Alors que, explique Thomas RÖMER, dans la plupart des religions, on trouve des réflexions sur la question des origines du monde et de l’homme, ainsi que sur la question de la mort, la question de la violence, qui est devenue une question centrale, n’est guère traitée sur le plan des mythes étiologiques racontant l’origine de la violence. Dans beaucoup de systèmes d’origines, la violence semble aller de soi.
Dans la Bible, c’est le mal et la violence des hommes qui sont à l’origine du déluge. Mais d’où vient cette violence ? Contrairement au diptyque de Athas-Hasis, les rédacteurs bibliques ont inséré entre la création de l’homme et le déluge un mythe expliquant l’origine de la violence et qui, à ce jour, ne possède pas d’équivalent dans les mythes du Proche-Orient Ancien, c’est l’histoire de Caïn et Abel. La première partie du récit (verset 1 à 16) met en scène le fratricide et ses conséquences et comporte un certain nombre de parallèles avec le récit de la transgression en Gn3. (...).
Les deux frères Caïn et Abel offrent spontanément des dons sans que Dieu leur ait demandé un tel acte. Le mobile qui les pousse n’est pas précisé. Mais Yhwh ne se comporte pas comme attendu. Il accepte le sacrifice d’Abel mais pas celui de Caïn (…). Derrière l’épisode des frères se cache une expérience humaine quotidienne : la vie n’est pas toujours prévisible et elle est faite d’inégalités qui ne sont pas toujours explicables. En Genèse 4, Yhwh conforte Caïn à cette expérience que tout homme doit faire dans sa vie, expérience qui n’est pas toujours facile à supporter.
Malgré l’exhortation divine, Caïn ne parvient pas à surmonter sa frustration. Le verset 8 s’ouvre par “Caïn dit à son frère Abel”, mais il n’existe pas de discours. Les anciennes traditions ont rajouté : “Allons aux champs”. Mais il faut prendre au sérieux cette absence de parole. Le narrateur a sans doute voulu signifier que Caïn, à la suite de l’exhortation divine, a voulu parler à son frère, mais que, finalement, il n’y est pas parvenu. Le premier meurtre et l’éclatement de la violence sont liés à l’incapacité de communiquer. Comme en Gn 3, Yhwh sanctionne Caïn qui, comme les acteurs de la transgression en Gn3, veut d’abord se soustraire à sa responsabilité. Pour Caïn, la sanction divine change son rapport à la terre.
Caïn a compris qu’il a déclenché la spirale de la violence : lui, qui a tué, craint maintenant d’être tué à son tour. Yhwh intervient alors pour protéger le meurtrier et comme en Gn3, deux fois. D’abord, il annonce une vengeance totale (sept fois) pour celui qui tirait Caïn — mais on reste dans la logique de la vendetta : à la violence répond une violence accrue. C’est pourquoi Yhwh change d’idée et protège Caïn par un signe qui empêche de le tuer. Le texte ne précise pas la nature du signe ; ce qui importe au narrateur, c’est l’insistance sur le fait que la vie humaine, même celle d’un meurtrier, est sacrée.
L’installation de Caïn à l’Est d’Éden va permettre la naissance de la civilisation, comme le montre la deuxième partie du récit (v. 17-24). La culture et l’avancement technique viennent des descendants de Caïn. Caïn bâtit la première ville et ses descendants inventent la musique et la métallurgie. Le fait qu’un agriculteur devienne fondateur d’une ville se trouve aussi dans l’histoire de la Phénicie de Philon de Byblos, transmise en extraits par Eusèbe, Praeparutio evangelicua (…).
Malgré la violence, la vie demeure donc possible. Mais elle reste fragile et menacée, comme le montrent les versets 23 et 24, qui rapportent un chant de vantardise d’un descendant de Caïn qui annule le signe qui protégeait Caïn. Lamek se vante d’avoir tué pour une simple blessure et d’avoir déclenché à nouveau la spirale de la violence. Ainsi ce récit primitif se terminait-il par le rappel de l’omniprésence de la violence et désir de vengeance.
C’est pourquoi la troisième partie (v. 25-26) du récit retourne à Adam (…) et Ève qui procréent une descendance à la place d’Abel. C’est (…) l’œuvre d’un rédacteur qui veut faire le lien entre Gn4 et la généalogie de Gn5. Le nom de Seth est le seul avec celui d’e Caïn au début de l’histoire à recevoir une explication étiologique. Dans le contexte actuel, ce nom est un “Ersatzname”. Le narrateur nous dit que c’est sous Enosh qu’on commence à invoquer le nom de Yhwh. Cette idée est en contradiction avec Ex 3 et 6 où le nom de Yhwh est seulement révélé à l’époque de Moïse. Le rédacteur sait peut-être aussi que l’idée selon laquelle Yhwh ne révèle son nom qu’en Égypte n’est pas partagée par tous les textes de la Torah (…). Et veut ainsi affirmer que celle révélation s’est déjà faite (pour la première fois) aux origines.
Dans la version sacerdotale du déluge où Dieu redéfinit ses relations avec les hommes (Gn9), la nouvelle réalité inclut maintenant la possibilité de consommer de la viande, à l’exception du sang. Donc on peut faire violence aux animaux pour qu’ils servent de nourriture. En même temps, on trouve l’ébauche de la loi, plus précisément de la loi du talion. La violence commise sera sanctionnée par la violence, c’est-à-dire par la peine de mort pour un meurtrier. »
Sur les interdits sexuels, sans doute les plus forts dans les lois successives du judaïsme, ils forment un catalogue d’interdits assortis des sanctions en cas de transgression. C’est une véritable collection d’interdits qui resserrent l’éventail des possibilités d’alliances entre hommes et femmes, qui précisent parfois comment ne doivent pas se faire les rapports sexuels, avec des « explications » qui doivent plus à l’ignorance du corps qu’à autre chose. La difficulté de faire respecter le tabou d’inceste, soit volontairement, soit involontairement explique la sévérité des sanctions encourues. L’éventail de ce qui est autorisé inclut parfois des relations sexuelles qui n’ont pas de conséquences directes sur ces alliances. Ce n’est que tardivement dans l’histoire qu’apparaît la notion de jugement dernier et de possible résurrection des morts. Très longtemps, il n’est question que de la relation (l’alliance) entre le peuple et son Dieu, relation soumise à l’observance de tout un réseau de rites qui couvrent tous les actes de la vis quotidienne.
Transgresser les interdits, c’est d’abord, dans la majeure partie de l’histoire du judaïsme, mais des variantes apparaissent sur le tard, variations parfois très loin des textes d’origine, s’attirer la colère de Dieu, soit sur tout le peuple, soit sur un individu. Cette colère divine s’exprime souvent sous forme de maladies — qu’elle soit individuelle, ou collective, sous forme d’épidémies — qui comme dans beaucoup de civilisations anciennes sont le résultat de péchés. Les formes de repentir pour éviter cette colère sont elles aussi variables et au cours des siècles les dieux semblent bien avoir changer d’avis. Mais ces changements — que des variantes du judaïsme mettent en valeur — se font dans la ligne directe de la Genèse, où Dieu change de stratégie quant au futur de l’homme.
Ajouter un commentaire