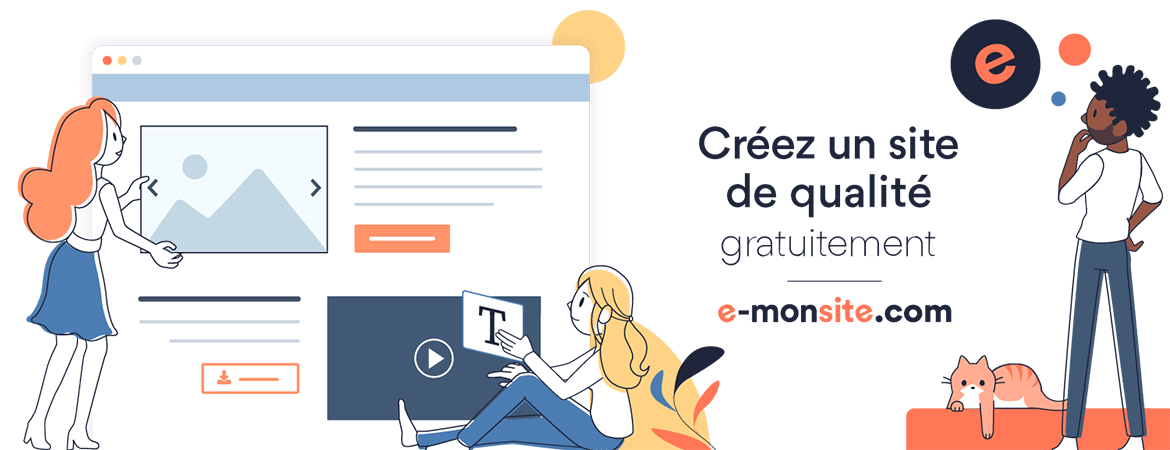- Accueil
- L'enseignement de Jésus au travers les Evangiles
- les premiers Entretiens
- Dialogue avec la Samaritaine Guérison du fils du fonctionnaire
Dialogue avec la Samaritaine Guérison du fils du fonctionnaire
Dialogue avec la Samaritaine Guérison du fils du fonctionnaire
Chapitre IV de l’Évangile de Jean (version Nelson Darby)
1 Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire : Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean
2 (toutefois Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples),
3 il quitta la Judée, et s’en alla encore en Galilée.
4 Et il fallait qu’il traversât la Samarie.
5 Il vient donc à une ville de la Samarie, nommée Sichar, (Sichem) près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils.
6 Et il y avait là une fontaine de Jacob. (Le puits de Jacob) Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine (margelle du puits) ; c’était environ la sixième heure.
La Samarie.
Petit cours d’Histoire et géographie sur la Samarie.
La Samarie ?????? (Shomrôn) est le nom historique et biblique d’une région montagneuse du Proche-Orient ayant constitué l’ancien Royaume d’Israël autour de son ancienne capitale Samarie, proche de Sichem ??? (près de l’actuelle ville de Naplouse), et rival de son voisin judéen du sud, le royaume de Juda. Elle se situe aujourd’hui à cheval sur les territoires de Cisjordanie et d’Israël, dans ce qui représente le tiers septentrional de l’actuelle Cisjordanie et la bande côtière s’étendant au nord de Tel-Aviv jusqu’aux frontières libanaises.
Selon la Bible, à la mort du roi Salomon au IX siècle av J-C., le royaume de David éclate en deux entités. Au sud, le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem et au nord, le Royaume d’Israël avec pour capitale la ville de Samarie ; Ochozias est "roi de Samarie". Historiquement, en -722, les Assyriens conduits par Salmanazar V puis Sargon II détruisent cette dernière mettant fin du même coup au royaume d’Israël.
Une partie de la population est emmenée en exil mais une petite partie reste sur place. Les deux Livres des Rois accuseront par la suite la population de Samarie d’être composée de colons venus de Babylonie ou de Syrie et convertis à une religion hébraïco-païenne. Les Samaritains affirmeront toujours être les purs descendants des 10 tribus ayant habité le royaume de Samarie, et rejetteront toute accusation de paganisme.
Les habitants du royaume de Juda sont à leur tour déportés en -586. Revenant au pays à la fin du V siècle, les exilés judéens (devenus des juifs par leur expérience de l’exil) écartent les Samaritains des travaux de reconstruction du Temple. Le nom de Samaritains devient synonyme pour eux d’hérésie et d’impureté. Les Samaritains sont cependant fidèles à la Torah, pratiquent la circoncision et le sabbat. Ils édifient un temple au mont Garizim à la fin du IV siècle av. J.-C. qui est détruit par Jean Hyrcan I en -108.
Une faible communauté de Samaritains a survécu jusqu’à nos jours dans la région de Naplouse.
La parabole du Bon Samaritain, dans les Évangiles, illustre l’opinion généralement mauvaise que les habitants du royaume de Juda avaient des Samaritains au début de notre ère.
Au temps de Jésus, la Samarie est avec la Judée et la Galilée l’un des trois districts administratifs de la Palestine. Jésus si est rendu, l’Évangile y fut prêché par le diacre Philippe. Pierre et Jean s’y rendirent et imposèrent les mains aux convertis pour qu’ils reçoivent l’Esprit.
Paul passa sur la route d’Antioche à Jérusalem. Le nom de Sébaste donné par Hérode subsiste dans l’actuelle Sebastiyeh. C’est le nom qui est donné à la capitale du royaume d’Israël, après le schisme, vers -880. C'est une des rares villes entièrement construites par les Israélites eux-mêmes.
Omri acheta pour deux talents d’argent (68 kg), une colline de 443 mètres de haut, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Sichem, à un nommé Chèmer, qui devait donner son nom à la cité. Le site était remarquablement choisi, au bord d’une vallée qui conduit à la mer.
Dans ses imprécations, le prophète Isaïe parle de "l’orgueilleuse couronne des ivrognes d’Ephraïm (le royaume du Nord) sur le sommet qui domine la grasse vallée". Seul inconvénient, le manque de sources. Mais le site fut pourvu d’importantes citernes et d’une enceinte extérieure qui enfermait une dizaine d’hectares de terres cultivées : moyennant quoi. Samarie devait soutenir de longs sièges. Le roi-soldat fortifia la position d’un premier mur de 1,40 mètre de large, doublé d’une liée extérieure, large de plus de 10 mètres et garnie de casemates, de tours et de bastions. Les gens de condition aisée demeuraient dans la citadelle, les plus modestes dans la ville basse.
Achab, successeur d’Omri, y ajouta des entrepôts et des magasins. Mais, parce que le climat y était rude, il s’était fait construire à Yizréel une résidence d’été. Plus tard, le palais fut doté par Jéroboam II de meubles incrustés d’ivoire et de pierres précieuses dont Amos dénonça le luxe provocant.
Par deux fois, les rois de Damas assiégèrent Samarie : alors qu’Achab régnait sur Israël, le roi d’Aram Ben-Hadad II monta contre la ville et exigea aussitôt, sans coup férir, une reddition complète. Achab, qui avait d’abord accepté les conditions, consulta le peuple et les Anciens qui lui conseillèrent de résister. Un prophète annonça au roi d’Israël que Dieu lui accorderait la victoire. Ce qui arriva.
Au temps de Joram, vers -845, un second siège fut tenu probablement par le même roi, ou par son successeur. Cette fois c’est le prophète Elisée qui annonça la fin des misères.
Une nuit, les Araméens quittèrent inexplicablement le camp où ils s’étaient retranchés. Le siège fut levé, sans combat.
Il fallut trois ans à l’armée assyrienne de Salmanazar V, près d’un siècle plus tard, pour venir à bout de la fière cité. Celle-ci se rendit au généralissime de Salmanazar, qui fut son successeur, Sargon II, en -721. Le roi Osée fut fait prisonnier, et 27000 Israélites furent déportés. À leur place, le roi d’Assour fit installer des colons originaires des peuples vaincus, et qui allaient former la population composite des Samaritains. Ainsi l’avait annoncé Isaïe. Désormais Samarie ne serait plus qu’une province assyrienne, puis babylonienne, puis perse, En -321 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand y installe une colonie de vétérans de son armée. La ville devint grecque et fut fortifiée. Mais au temps des Hasmonéens, Jean Hyrcan s’en empara et, selon Flavius Josèphe, la détruisit. Les Romains lui donnèrent un nouvel essor. Auguste en fit don à Hérode le Grand, qui la transforma en une cité nommée Sébaste, transcription grecque du nom d’Auguste. Un temple dédié à l’empereur en couronna le sommet, à la place de l’ancien palais royal.
Selon le livre d’Esdras, les successeurs de Sargon, Asarhaddon et Assourbanipal, avaient procédé à la même opération. Les inévitables croisements avec ceux qui avaient échappé à la déportation formèrent un peuplement hétérogène, le roi d’Assyrie, sur la demande de ses colons, envoya à Samarie un des prêtres israélites déportés pour que le culte de YHWH fût remis en honneur, mais celui-ci côtoyait des cultes païens importés par les colons. Donc, Les Samaritains se mirent à adorer YHWH, mais certains partis eux conservèrent des idoles, si bien que ce syncrétisme rejaillit sur ce qui restait des populations autochtones. Une partie semble avoir continué à participer au culte de Jérusalem : elle sera soumise à la réforme d’Ezéchias et à celle de Josias et conviée à célébrer la Pâque organisée par ce roi.
Au retour d’exil des Judéens, les Samaritains demandèrent de collaborer à la reconstruction du Temple. Mais Zorobabel et le grand prêtre Josué refusèrent. Furieux de cet affront, les Samaritains mirent toutes sortes d’obstacles à l’entreprise. Bientôt affluèrent vers la Samarie de nombreux Judéens et leur famille, qui ne voulaient pas se plier aux prescriptions d’Esdras qui voulait purifier le sang juif, en imposant aux hommes Juifs ayant pour épouse une femme étrangère de se séparer d’elle, ainsi que de leurs enfants qu’il aurait pu avoir avec elle.
Bien que le temple des Samaritains ait été détruit par Jean Hyrcan en -128 avant Jésus-Christ, le mont Garizim demeurait un lieu de culte dissident.
Les Juifs ne frayaient pas avec les Samaritains. Pour un Juif, le mot "Samaritain" équivalait à "païen", voire à "possédé du démon" ou "suppôt de Satan", comme en témoigne l’injure faite à Jésus par les Juifs. Pour se rendre de Galilée à Jérusalem, on évitait de traverser la Samarie : Jésus et ses apôtres s’y virent un jour refuser le gîte. Mais il est de "bons Samaritains", modèles du comportement vis-à-vis de Dieu, tel le lépreux qui, guéri, rend seul grâce à Jésus ou vis-à-vis du prochain, tel le héros de la parabole. Si, dans un premier temps, Jésus recommande à ses apôtres de ne prêcher qu’aux Juifs, à l’exclusion des païens et des Samaritains, avant son Ascension, cette recommandation Jésus ne semble pas se l’appliquer à lui-même, elle ne semble destinée qu’à ses disciples. Après son Ascension il leur enjoint au contraire de s’adresser à eux comme au monde entier : "Vous serez mes témoins dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre". Au lendemain de la Pentecôte, le diacre Philippe et les apôtres Pierre et Jean y porteront la Parole de Dieu et y donneront les premières impositions de l’Esprit.
De nos jours la communauté samaritaine de Naplouse, au pied du mont Garizim, continue à attendre le Messie et à immoler chaque année l’agneau pascal.
La synagogue conserve un manuscrit en caractères hébraïques, dit le Pentateuque samaritain : ils ne reconnaissent pas d’autre livre de la Bible.
Le voyage.
Pour aller de la Judée en Galilée, Jésus traverse donc la Samarie. C’est le chemin le plus court mais, étant donné l’inimitié entre eux et les Samaritains, les juifs faisaient un détour et passaient par la Pérée. Jésus montre donc qu’il n’est pas conditionné par cette haine raciale et religieuse.
"4 Et il fallait qu’il traversât la Samarie"
Mais le texte précise qu’il « devait » y passer. Pourquoi ? Il faut peut-être distinguer " un double falloir… Celui du trajet à suivre… Et celui qui permet d’entrer dans le dessein de Dieu". Mais étant donné que le récit est allégorique, ce dessein n’est pas, "un rendez-vous à ne pas manquer ", mais le sens théologique que l’auteur fixe à son récit.
Comme ce n’était pas une obligation géographique ou topographique, car il aurait pu prendre une autre route. Était-ce une obligation malheureuse, du type : « il fallait encore que tu manges la confiture alors que tu viens de mettre ta chemise blanche qui maintenant est sale ». Ou bien est-ce de la provocation : Jésus qui cherche non pas la confrontation avec des adversaires, mais l’affrontement avec les ennemis au cœur de leur fief intégriste, quitte à courir le risque de se faire tuer ou du moins tabasser ? Avait-il autre chose en tête, et si oui quoi ?
Si nous considérons l’histoire de ses ancêtres présumés, Jésus ne fait que reprendre le chemin que fit Ruth, l’une de ses aïeules. Moabite, Ruth était mariée à l’un des fils d’Élimélek, de Bethléem. Celui-ci avait en effet quitté sa ville natale pour aller, avec sa femme Noémie, "dans les champs de Moab" (Rt 1:1), c’est-à-dire en Samarie. Après la mort de ses fils, Noémie retourna avec sa belle-fille à Bethléem, parce qu’elle espérait que Dieu lui "donnerait du pain" (Rt 1:6). Bethléem signifiant "la maison de pain". Si nous gardons à l’esprit cette trame généalogique, Jésus fait donc le chemin inverse de celui de Ruth : il va de la Judée à "la terre jadis donnée par Jacob à Joseph, son fils" (Jn 4:5), c’est-à-dire la terre de Moab.
Jésus revient-il dans sa terre "natale" celle de ses racines généalogiques ? Si nous pensons que l’expression "Joseph son fils" peut avoir un sens messianique, dans la mesure où Joseph est figure du Christ, nous pouvons affirmer que l’auteur du quatrième évangile voit dans la donation de cette terre par Jacob à Joseph une préfiguration de la terre que Dieu aurait donnée à son fils pour sa venue au monde. Ce sens supposerait donc que Jésus est né en "Samarie", et par ce voyage l’auteur le ferait revenir dans sa terre natale, comme pour légitimer son origine par celle de Ruth. À l’ombre de celle-ci, Jésus apparaît donc comme juif et samaritain à la fois.
Nous sommes à une époque particulière et à un endroit spécial, les renseignements historiques et les détails géographiques dont nous disposons dans le texte sont riches d’enseignement : la ville de Sychar, au cœur de la Samarie, en compétition avec Jérusalem, le poumon d’Israël, avec des questions vitales portant
Sur le lieu : Quel est le bon endroit pour la vraie adoration : la Samarie ? Israël ? Sychar ? Jérusalem ? Le Mont Garizim ? Le Sinaï ? Ma montagne ? Ma ville ? L’église ?, La Cathédrale ?, le Temple ?
Sur les gens : qui sont les meilleurs ? Les Samaritains ? Les Juifs ? Les Pharisiens ? Jean-Baptiste ? Jésus ? Les disciples duquel des deux ? Les croyants ? Les libéraux ou les fondamentalistes ? Les protestants ? Les catholiques ?
Nous avons en tout cas une certitude : chez les chrétiens protestants comme chez nos frères catholiques, ou encore chez nos cousins les juifs, et les musulmans, souvent nous croyons que nous sommes meilleurs que les gens du monde ceux d’une autre croyance que la nôtre. Il y a très nettement un contexte de compétition, de rivalité. C’est une configuration mentale de notre ego de type satanisme, du grec satanas (ce qui signifie l’adversaire "le satan") pour parler de notre adversité, ou de notre adversaire, ce qui divise, qui établit la rivalité et la compétition entre les gens (l’un se croyant supérieur à l’autre, alors qu’il est peut-être simplement différent de lui) c’est le fruit de notre ego ; rivalité aussi et exclusion entre les lieux qu’ils habitent, même entre les lieux qu’ils vénèrent dans leur mémoire (nous reparlerons de cet aspect avec la Samaritaine et dans sa manière d’établir des rapports avec les lieux du passé qu’elle évoque en dialoguant avec Jésus).
Peut-être qu’une des raisons qu’avait Jésus de passer en Samarie était de changer cette mentalité, cette rivalité, pour la métamorphoser en réconciliation et en coopération.
Il y a aussi le champ de Jacob, donné à son fils Joseph, et surtout ce puits, vivant dans la mémoire individuelle de la femme, et dans la mémoire collective de la tribu dont elle faisait partie, tout en se situant "à la marge" (pas vraiment à la margelle). Endroit magique, imprégné d’une histoire passée qu’on ne peut évoquer sans être touché, sans vibrer, car elle évoque avant tout la mémoire affective. Jésus s’y assied, fatigué. Un détail chronologique : c’est la sixième heure, (donc vers midi) le soleil au zénith, frappant dur comme du plomb. C’est l’heure où les gens "normaux" restent chez eux, à l’ombre. C’est le moment propice pour faire des rencontres… Bizarres, avec des gens étranges : c’est en tout cas là que vont se croiser, une femme (pas comme les autres), et un homme (unique en son genre).
7 Une femme de la Samarie vient pour puiser de l’eau (au puits). Jésus lui dit : Donne-moi à boire
8 (car ses disciples s’en étaient allés à la ville pour acheter des vivres).
9 La femme samaritaine lui dit donc : Comment toi qui es Juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? (Car les Juifs n’ont point de relations avec les Samaritains).
10 Jésus répondit et lui dit : Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, toi, tu lui eusses demandé, et il t’eût donné de l’eau vive.
11 La femme lui dit : Seigneur*, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où as-tu donc cette eau vive ?
12 Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits ; et lui-même en a bu, et ses fils, et son bétail ?
13 Jésus répondit et lui dit : Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif ;
14 mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à jamais ; mais l’eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle.
15 La femme lui dit : Seigneur*, donne-moi cette eau, afin que je n’aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser.
16 Jésus lui dit : Va, appelle ton mari, et viens ici.
17 La femme répondit et dit : Je n’ai pas de mari. Jésus lui dit : Tu as bien dit : Je n’ai pas de mari ;
18 car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; en cela tu as dit vrai.
19 La femme lui dit : Seigneur*, je vois que tu es un prophète.
20 Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous, vous dites qu’à Jérusalem est le lieu où il faut adorer.
21 Jésus lui dit : Femme, crois-moi : l’heure vient que vous n’adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem.
22 Vous, vous adorez, vous ne savez quoi* ; nous, nous savons ce que nous adorons** ; car le salut vient des Juifs.
23 Mais l’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi le Père en cherche de tels qui l’adorent.
24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.
25 La femme lui dit : Je sais que le Messie qui est appelé le Christ, vient ; quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses.
26 Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle.
27 Et là-dessus ses disciples vinrent ; et ils s’étonnaient de ce qu’il parlait avec une femme ; toutefois nul ne dit : Que lui demandes-tu ? Ou, de quoi* parles-tu avec elle ?
— v. 11, 15, 19 : plutôt : Monsieur. — v. 22* : ou : vous adorez ce que vous ne connaissez pas. — v. 22** : litt. : Nous adorons nous savons quoi. — v. 27 : ou : pourquoi.
Le sens biblique du puits et de l’eau puisée :
Plus généralement dans les sources bibliques, le puits est relié au thème de la loi mais aussi de la rencontre homme femme et à celui nuptial. Par exemple :
En Genèse 24 : 10-22, le serviteur d’Abraham envoyé pour trouver une épouse pour le fils de son maître rencontre Rébecca au puits, elle deviendra la femme d’Isaac.
En Genèse 29 : 1-14, Ces près d’un puits que Jacob rencontre Rachelle, qui deviendra son épouse.
En Exode 16:22, Moïse et Séphora se rencontrent près d’un puits.
Dans les récits de l’AT l’eau est donc aussi demandée, puis donnée ; et dans ces références le mariage est scellé.
En ce qui concerne le récit johannique, avec la révélation de l’identité de Jésus et la confession de foi des Samaritains à la fin de l’épisode, on peut penser qu’il est question ici de l’union de la Samarie avec son vrai Dieu. C’est possible mais je ne crois pas que cela se résume à cette simple dimension, et qu’il faut creuser pour aller en chercher une autre ou tout au moins plus global, et l’on peut y voir bien au-delà de la simple Samarie, et je crois personnellement que l’on peut y voir ici, les noces mystiques de Jésus-Christ avec son Église.
Le personnage de Jacob lui-même est important pour comprendre ce passage. Il est cité trois fois, d’abord dans le verset 5 : « C’est ainsi qu’il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, (Sichem) non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph ». Nous en trouvons la mention en Genèse 48 : 21-22, où Jacob Israël dit à Joseph :
« Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir au pays de vos pères. Moi, je te donne Sichem, une part de plus qu’à tes frères, que j’ai enlevés au pouvoir des Amorites par l’épée et par l’arc. »
On trouve dans le livre de Josué 24 : 32 que les ossements de Joseph y sont enfouis :
« Quant aux ossements de Joseph, que les fils d’Israël avaient emportés d’Égypte, on les ensevelit à Sichem, dans la portion de champ que Jacob avait achetée pour cent pièces d’argent aux fils de Hamor, père de Sichem ; ils firent partie du patrimoine des fils de Joseph. »
Ce puits est donc associé aux patriarches et la Samaritaine montre qu’elle est attachée à cette tradition vivante des patriarches qui existe chez les Samaritains. C’est pourquoi elle dit:
«Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob… ? »
Jésus ne la contredit pas dans le sens où il ne lui dit pas : "vous n’avez pas pour père Jacob" ce qu’un juif aurait répliqué, car selon eux les Samaritains n’étaient pas "descendants des fils de Jacob", mais des gens venant d’ailleurs, émigrés de force dans ces territoires, par le roi des Assyriens en -722 av J.C, pour un Juif les Samaritains ne pouvaient pour cette raison prétendre à "être enfants de la promesse" donc, malgré ce qu’ils prétendaient, pour les juifs revenus de déportation à Babylone, les Samaritains n’étaient pas des enfants d’Abraham, donc ils n’étaient pas juifs, et donc ils ne pouvaient prétendre à la promesse divine.
Dans le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, nous serons tous d’accord, pour dire que les paroles de Jésus sont "à prendre symboliquement. " Quand il dit qu’il peut nous donner de l’eau, personne ne l’interprète au pied de la lettre en pensant que Jésus offrirait comme une compagnie des eaux, l’eau courante à tous les étages pour le confort matériel des ménagères. L’eau est le symbole de la grâce de Dieu, le mot Grâce et le mot gratuit, c'est le même mot, on peut encore l'utiliser, et ce qui est gratuit c’est l’amour de Dieu mais c’est surtout la relation avec Dieu pour chaque être humain qui qu'il soit. Il suffit d’une pluie ou d’une source dans le désert pour sauver le voyageur assoiffer pour transformer un lieu aride, inhospitalier et brûlant en un lieu verdoyant, agréable et fécond. Et c’est bien ce qu’offre la grâce de Dieu dans une existence : c’est la vie, et c’est d’y faire germer le meilleur qui s’y trouve pour la rendre belle et féconde. La promesse de Jésus est donc à lire symboliquement, comme bien d’autres promesses dans l’Évangile, comme sa lumière qui ne se mesure pas lux ou en kilowatts. Quant à la Samaritaine, qu’en elle nous dit "le puits est profonds et tu n’as pas de seau," les commentateurs disent, trop souvent, quelle ne comprend rien et qu’elle prend tous les propos de Jésus au pied de la lettre, bref Jésus lui parle spirituellement mais elle répond de façon littérale, faisant de ce dialogue une sorte de quiproquo. Personnellement je crois que cette lecture est bien discutable. Réfléchissons ! L’intérêt d’un évangile aussi profond que celui de l’Apôtre Jean ne peut reposer sur le simple fait, de s’amuser de la bêtise de quelqu’un qui répond de travers et d’autant plus qu’alors toutes ses interventions seraient des non-sens. C’est prendre le point de vue des juifs, celui des pharisiens ; car on se doit de penser au contraire que la Samaritaine, dès le début, comprend très bien de quoi il s’agit, et elle aussi, est dans le registre du symbolique. Le dialogue entre elle et Jésus n’est donc pas alors un malentendu, mais une discussion théologique serrée sur la grâce divine. La preuve, c’est ce qu’elle répond : si Jésus lui donnait l’eau lui permettant de n’avoir plus soif, elle n’aurait plus besoin d’aller puiser. Mais dans le sens littéral, cela est absurde car matériellement, l’eau pour boire représente à peine 10 % des besoins en eau ; même si elle n’avait plus soif, elle devrait tout de même puiser, de l’eau pour la cuisine, pour les bêtes, pour faire la lessive et tout le reste ; et puis il y a cette mention du « puits de Jacob » pourquoi préciser que ce puits fut donné par Jacob ? N’importe quelle puits aurait pu faire l’affaire ! Pourquoi l’auteur précise que ce puits est celui de Jacob ? Par ce que l’origine de l’eau puisée est importante.
Tout cela n’a de sens que spirituellement. Les Samaritains quoi que les juifs en penser, n’étaient pas aussi éloignés que cela d’eux, dans ce qui concernait leur logique traditionnelle ; pensant que l’Esprit de Dieu avait soufflé dans les temps jadis, du temps des patriarches, jusqu’à Moïse, et qu’aujourd’hui pour avoir la grâce de Dieu, il fallait retourner puiser à la source de ces temps anciens. Elle était dans une pure logique de religion et d’observance où il faut peiner, travailler, œuvrer pour gagner la grâce de Dieu, à la sueur de son front. Or Jésus, lui propose une autre conception : la grâce elle ne doit pas aller la chercher chaque jour par de grands efforts, la grâce est offerte, elle est là, il n’y a pas à la gagner, il suffit de se l’approprier en la demandant.
Mais, dit-elle, "le puits est profond et tu n’as rien pour puiser ". Dans un sens littéral, cette réponse n’a que du bon sens, sans corde ni sceau, sans outils, sans matériel, comment ce juif peut-il prétendre lui donner à boire ! Jésus ne lui propose pas l’eau de ce puits ; nous ne sommes pas les seuls à le comprendre, la Samaritaine le comprend très bien elle aussi, et je ne vois pas pourquoi elle irait s’imaginer autre chose, puisque c’est lui-même qui le premier lui a demandé de l’eau de ce puits. Dans un sens plus spirituel, comme la Samaritaine l’a compris, c’est autre chose ! Ce qu’elle dit à Jésus est qu’il n’a peut-être pas le pouvoir "religieux" ou les "moyens religieux" de lui apporter ce qu’il promet. En deux mots, elle a du mal à y croire. Car elle sait que la grâce est loin d’eux, de là sa réponse : "le puits est profond" et comment Jésus pourrait-il prétendre parvenir à lui donner de cette eau, comprendre cette grâce, sans matériel, il faut comprendre sans rites religieux, sans obligations diverses, sans sacrement pourrais-je dire ? De là sa question : "es-tu plus grand que Jacob ?"
Il faut ici comprendre dans ce que représente Jacob dans un sens littéral et aussi dans un sens purement spirituel, Jacob ou Israël, dans l’Ancien Testament. Jacob et ses fils sont des "creuseurs de citernes. " Nos traductions de la Bible hébraïque en grec puis en français nous parle de "puits" aussi bien que lorsqu’il s’agit pour nous de citerne recevant l’eau de la pluie, ou qu’il s’agisse de forages du travail des "puisatiers", que nous nous appelons véritablement "puits" et qu’elle appelle elle "source" ou "source d’eau vive." Donc Jacob et ses fils creusent des citernes, parfois qu’en les conditions géologiques le permettent comme ici à Sichem, ils creusent des sources. Les citernes en majorité pour recevoir l’eau tombée du ciel, et qu’en cela est possible des puits à "source d’eau vive" pour atteindre la nappe phréatique. Dans le sens littéral, comme dans le sens spirituel, c’est donc eux qui ont apporté au peuple juif l’eau matérielle et l’eau de Dieu, (comprendre sa grâce) donc la question "es-tu plus grand que Jacob" « la source d’eaux (comprendre la grâce) qui nous est donné par Jacob et le patriarche est profond, elle est très lointaine, il est très difficile d’atteindre cette eau, (cette grâce) et toi ! As-tu seulement les moyens de ce que tu me promets ? » (Tu n’as pas d’outils). C’est en fait ce que lui demande la Samaritaine : « a tu ce pouvoir » ; « Oui", lui répond Jésus, "je suis plus grand que Jacob". Ce qu’il propose est bien plus grand que l’ancienne alliance des patriarches, il y a en sa parole, son enseignement, non pas une citerne ou un puits qui peuvent se tarir, mais une nouvelle source de révélation, d’esprit et de grâce. Et ce qu’offre Jésus, c’est une source qui sort de terre sans devoir creuser, et bien mieux que les puits ou les citernes des juifs et des Samaritains, une citerne, ou gît une eau ancienne, parfois croupissante ; la source, elle, offre une eau neuve, vivante, elle donne la vie autour d’elle. Il y a la encore une vision totalement différente de la religion, qui ne cherche plus dans une tradition ancienne des relents de souffle vital, mais qui trouve l’esprit et la grâce à la source même qui est Jésus-Christ.
Et Jésus promet en plus que chacun peut devenir à son tour une source, pour soi et pour les autres. Et la Samaritaine comprend très bien cela, elle comprend ce que lui dit Jésus : quand jésus lui dit qu’elle a eu cinq maris ! Que viennent faire ces cinq maris dans la conversation ? Elle doit aller les chercher ! Là encore nous sommes plus dans la symbolique que dans les faits, il ne s’agit pas véritablement de son, ou ses époux physiques, comme certains le croient et le disent, mais de ce qu’elle a suivi et crut jusqu’alors, c’est-à-dire des cinq livres du Pentateuque qui font toute la Bible des Samaritains, leur Loi religieuse, et actuellement, en fait, elle n’a pas de foi vivante, pas de mari, juste une foi qui est une cohabitation avec des pratiques purement humaines. Elle comprend que le véritable époux est celui qui se tient devant elle c’est-à-dire le 7ème, comme me 7ème jour celui où l’on ne doit pas travailler, et qui accomplit toutes les promesses et qui est le Messie, donnant la plénitude de la présence vivifiante de Dieu.
La Samaritaine devient donc elle-même symbole ! Ce symbole est celui de l’Église de Jésus Christ qui est dite "l’Épouse du Christ" et comme à la Samaritaine Jésus offrent à cette épouse à son Église à chaque membre de son Église, cette eau de sa source et non pas l’obligation pour elle et pour chacun de ses membres d’aller puiser dans les croyances rituelles et magiques et ses sacrements mis en place par la religion tout au long des siècles.
Nous sommes donc dans ce passage de l’Évangile de Jean dans la rencontre spirituelle, entre Jésus et ce qui doit devenir son Église, c’est elle qui doit abandonner ses rites et pratiques anciens, sa Loi, et ses Bonnes Œuvres, ses croyances ajoutées au fil des siècles, comme un " mil feuilles" pour obtenir la Grâce de Dieu, Jésus nous l’offre ; La Grâce il suffit de la demander.
Il y a encore une dimension plus profonde dans ce récit dans ce dialogue avec la Samaritaine. Nous croyants, religieux, quelle que soit, ces croyances et aussi notre religion, Jésus-Christ s’adresse à nous au travers ce dialogue car nous sommes tous plus ou moins comme cette Samaritaine. Le risque est peut-être de le devenir complètement.
Beaucoup se sont posé cette question : "que faisait-elle là à midi, au plus chaud de la journée, alors que c’est le matin ou en fin de journée qu’il est d’usage d’aller chercher de l’eau au puits ?" Bien souvent les prédicateurs, les théologiens, se posent cette question parce qu’ils croient en détenir la réponse. Pour eux elle est si évidente. C’est une pécheresse, une femme de mauvaise vie qui a eu cinq époux etc.. Si l’on pense ainsi, c’est que l’on est exactement comme cette Samaritaine, ou les juifs Pharisiens, on ne comprend pas le sens de cet enseignement de Jésus.
Manifestement, si cette femme vient à cette heure-ci, c’est pour éviter la présence d’autres personnes. C’est délibérément qu’elle se tient à l’écart du reste de la population. Elle ne veut pas de contact avec les autres. Sur tous ces points ils ont raison. S’ils ont raison sur le constat, ils ont je crois tord sur la cause. La plus grande partie des commentateurs fond en effet l’hypothèse que c’est en raison de sa vie dissolue, puisqu’il sera dit qu’elle a eu cinq maris. Elle pourrait ne pas vouloir supporter les cancanages et les moqueries à son sujet, mais cet argument ne tient pas la route, car nous l’avons vu, les maris en questions ne sont que symboliques, ils ne sont pas des maris de chair et de sang.
Nous pouvons fort bien former l’hypothèse que la femme se tient à distance parce qu’elle a une grande crainte de l’impiété et des personnes impies. Comme cela sera indiqué dès que le dialogue s’engagera entre Jésus et elle, nous l’avons vu les frontières symboliques sont bien présentes à son esprit. Les mélanges sont récusés. Elle insistera lourdement sur tout ce qui la sépare du juif qui se tient en sa présence. Cette femme, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’elle s’est radicalisée ou, du moins, qu’elle est en voie de radicalisation. Quant à Jésus, s’il est précisé qu’il lui fallait passer par la Samarie, nous pouvons former l’hypothèse que c’est pour y accomplir un devoir urgent, une tâche qui lui incombe et à laquelle il n’entend pas se soustraire : déradicaliser cette Samaritaine, figure récapitulative de la Samarie, héritière du Royaume du Nord, frère ennemi du royaume du Sud, Juda, dont la capitale, Jérusalem, est en concurrence avec le sommet sacré de la Samarie : le mont Garizim. Nous pouvons former l’hypothèse que Jésus intervient pour essayer d’enrayer un processus de radicalisation, par trois actions qui pourraient bien nous inspirer : lever les malentendus, analyser le réel, valoriser les pulsions de vie.
Lever les malentendus
La lecture du texte biblique fait apparaître un quiproquo au sujet de l’eau. Jésus et la femme même s’ils s’entendent sur le sens spirituel de l’eau, semblent ne pas parler de la même chose. Comment pourraient-ils se comprendre, dès lors ? Lever les malentendus, c’est se débarrasser des préjugés, des : "nous savons », du chapitre précédent, que sont les véritables déchets de la pensée, c’est se débarrasser de ce qui fait obstacle à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Les bouddhistes parlent d’une "vision juste". Un malentendu, des déchets de la pensée, c’est la Samaritaine qui pense que seul le patriarche Jacob peut être la source de sa croyance et de son salut. C’est aussi par exemple ce pasteur, Steven Inversons qui critique les victimes du Bataclan pour avoir assisté à un concert de « Dite Métal ». Plus près de nous en France mais certainement inspiré du précédant on trouve cet article signé "Philippe Mirador" sur le cite "croire" une publication de la fédération baptiste, en France, que les morts du bataclan ont subi le même sort que le mort qu’il y a eu lors de la chanson « Sympathy for the Devil », lors du Concert des Rolling Stones à Altamont en 1969. Allant jusqu’à écrire qu’"En ce soir terrible du 13 novembre 2015, le diable a chanté une monstrueuse chanson, à coups de Kalachnikov et d’explosifs. Il l’a chantée au Bataclan et ailleurs." Dans les deux cas, il est reproché d’avoir joué avec le diable, et d’avoir été puni, ce qui, déjà, laisse entendre que les jihadistes seraient effectivement le bras armé de la justice divine.
C’est monstrueux de penser et d’écrire des choses pareilles, pour moi c’est personnes qui pourtant se disent chrétiennes sont comme des salafistes.
Je ne veux pas mettre ici Mick Jagger, et René Girard, auteur du livre "La Violence et le Sacré" sur le même plan académique, mais alors pourquoi ne pas aller jusqu’à dire que René Girard est lui-même mort pour avoir fait, à un niveau universitaire, le travail des chanteurs, des poètes, des artistes en général : mettre en évidence les mécanismes de violence. La chanson des Rolling Stones montre justement la banalité du mal, la capacité qu’a chacun de nous de pouvoir être artisan du mal - ce qui est une manière d’être vigilant face à la violence collective, comme le fait, dans un autre registre "Je vois Satan tomber comme l’éclair". Le mal est aussi dans la plume de l’auteur de cet article "D’Altamont au Bataclan : Don’t play with the devil" de la revue "croire". Mais je ne veux juger personne, ce dialogue de Jésus avec la Samaritaine nous dit quoi en penser.
La femme de Samarie parle de l’eau donner par Jacob, Jésus parle d’une eau spirituelle. La femme parle de religion, Jésus parle d’un idéal de vie. Les rencontres avec des personnes revenues de Syrie révèlent que ce n’est pas pour la gloire d’Allah qu’elles sont parties. Le plus souvent, ce sont des besoins matériels qui ont été couverts par des groupes ou des personnes charismatiques qui sont à l’origine de leur départ : ces « gourous » ont petit à petit mis la main sur ces personnes pour en faire ensuite ce qu’ils en voulaient. De même que l’eau peut recouvrir plusieurs réalités, le diable ou satan peuvent signifier des choses bien différentes, puisqu’il n’est pas une entité définie, mais les conséquences d’une façon de pensées, comme un nom de religion comme le "christianisme" ou "l’Islam" peut désigner des pratiques et des idées diamétralement opposées. Il convient de ne pas faire d’amalgame, et de lever les risques de malentendu.
Analyser le réel
Au malentendu sur l’eau fait suite une discussion sur l’état marital de la femme. De même que l’eau n’est pas de l’eau, nous l’avons vu les maris ne sont pas forcément des maris et Jésus n’est pas omniscient, sachant tout sur tout le monde. Ce dont il parle, c’est de l’histoire de la Samarie, au moment où elle est tombée aux mains des Assyriens. C’est à cette époque, en -722, que Sargon II, le roi d’Assyrie, a déplacé les peuples de cinq pays pour les installer en Samarie, avec leur divinité respective (2 Rois 17/24ss.). Le mari, c’est le Baal, dans les langues sémitiques, ce qui est aussi le nom de Dieu dans les nations proches d’Israël. Jésus parle des divinités auxquelles la Samarie a été exposée et il parle du fait qu’aujourd’hui, elle se retrouve sans mari, c’est-à-dire sans Dieu. L’alliance avec l’Éternel n’a plus cours. Les cinq maris peuvent être aussi les cinq livres de la Torah des Samaritains.
Ici Jésus prend appui sur l’histoire spécifique de la Samarie pour la rejoindre dans son univers. Jésus ne se contente pas d’approximations, il ne fait pas une théorie générale sur la radicalisation, mais il permet à la Samarie de raconter son histoire propre et notamment ce qu’elle a fait pour exister. Car c’est bien de cela dont il est question dans le dialogue entre Jésus et la femme : comment s’y prendre pour ne pas disparaître, pour ne pas mourir de soif, étant entendu que la soif n’est pas ici matérielle.
Comment survivre dans un monde qui ne veut plus de vous, dans une société où nous n’avons plus notre place ? Je le répète, Jésus analyse le réel en convoquant l’histoire. Il ne réfléchit pas sur du ressentiment ou des impressions. Qu’il se réfère à l’histoire indique qu’il fait place à la raison, à la rationalité. À la fois il tient compte de la situation spécifique et il s’appuie sur des faits pour s’adresser à la personne radicalisée. Il ne discute pas idéologie contre idéologie. Il prend en compte le cheminement, les différentes étapes qui ont mené à la radicalisation. Oui, Jésus essaie de comprendre ce qui s’est passé. C’est la seule manière d’avoir ensuite un discours qui pourra faire effet.
Valoriser les pulsions de vie.
C’est à ce moment que Jésus va prendre la parole plus longuement pour lui dire que le fossé qui les sépare va pouvoir se résorber. La situation peut s’arranger non parce que la femme se rangerait à la position de Jésus ou que Jésus se radicaliserait également, mais parce qu’il y a une perspective commune par-delà leurs deux positions. Ce n’est ni le Garizim ni Jérusalem qui est l’horizon ultime, dit Jésus ; l’un et l’autre renvoient à un universel supérieur, ce que Jésus appelle le Père, qui sera adoré en esprit et en vérité, indépendamment d’un lieu, d’un rituel spécifique. Ce que fait Jésus, c’est d’offrir à la femme un idéal supérieur à l’idéal qu’elle s’était donné jusque-là. Ce que fait Jésus, c’est d’attirer la femme vers la perspective d’une vie autrement plus jouissive que ce qu’elle connaissait jusque-là.
C’est d’ailleurs ainsi que Jésus a commencé l’entretien, mais la femme s’était aussi repliée sur elle-même. Souvenez-vous, la première parole que Jésus lui a adressée est : "donne-moi à boire". Oh, dit comme cela, cette parole est aussi anodine que de demander l’heure à quelqu’un. Pourtant, cela signifie bien plus pour Jésus et pour la Samaritaine qui sont l’un et l’autre connaisseurs de la Torah. "Donne-moi à boire" nous l’avons dit c’est l’expression qui annonce la demande en mariage. Du moins est-ce la formule qui retentit en Gn 24, au puits qui sera celui de Jacob, lorsque Rebecca est repérée pour devenir la femme d’Isaac. À la génération suivante, Jacob y embrassera Rachel. On comprend mieux que la Samaritaine ait répondu à Jésus : "Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?" En effet, on ne saurait imaginer qu’un juif puisse avoir une relation avec une Samaritaine. On ne saurait l’imaginer dans la perspective de relations en miroir. On ne saurait l’imaginer si l’intégrisme l’emporte. On ne saurait l’imaginer si nous nous accordons avec les propos relayés par l’Union des Églises méthodistes, ou le journal "la Croix" : un article de Grégory Solari ayant pour titre "nous avons produit le mal qui nous assaille. La présence de l’islam manifeste aujourd’hui notre infidélité à l’Évangile." Outre l’absence d’analyse du réel, une telle affirmation va à l’encontre du projet porté par Jésus dans cet évangile. Pour Jésus, il s’agit de faire alliance ; il s’agit de sortir de la répétition des scénarios et d’accomplir le désir frustré dont il est question en 2 R 17/35 : restaurer l’alliance avec l’Éternel, autrement dit, renouer avec ce qui fait advenir la vie en plénitude.
En disant à la femme qu’elle pourrait avoir de l’eau vivante, Jésus la met sur la piste de la pulsion de vie en lieu et place du repli identitaire dont elle fait preuve, elle qui est bloquée sur le puits de Jacob dont elle fait, sinon un lieu saint, du moins exclusif. Il la met sur la possibilité de nouvelles alliances qui ne sont pas une infidélité à son histoire, mais, au contraire, qui lui donneront une amplitude bien plus importante. Ce n’est pas à coups de pulsions de mort qu’on vient à bout d’autres pulsions de mort. Ce n’est pas à coups de lois liberticides qu’on défend la liberté. Ce n’est pas en figeant la vie qu’on la rend meilleure.
Ce n’est pas à coups de séjours en prisons, de sentences, de missiles, de guerre totale, ou d’État d’urgence, que l’on combat une idéologie. C’est par une autre ouverture, un autre espoir, une vision autre de l’avenir de l’homme. C’est en nouant de nouvelles alliances, en croisant des horizons, en dépassant les affiliations à des chapelles particulières, qu’il est possible de célébrer pleinement la vie dont parle la Bible. Les ultras de Marseille sont bien plus proches de l’attitude de Jésus lorsqu’ils tendent une banderole « Nous sommes Paris » que n’importe quel religieux qui s’enferme dans son bréviaire. Les supporters anglais qui chantent la Marseillaise à Wembley sont bien plus fidèles à l’Évangile que n’importe quel religieux qui se contente de sa déclaration de foi.
Dans cet épisode biblique, Jésus remet en cause les frontières traditionnelles, les oppositions classiques, les clivages qui deviennent une part de notre identité. Nous pouvons exister sans être les ennemis de quelqu’un. Dans un monde en tension, Jésus propose une convivialité qui n’ignore rien des conflits, qu’il n’ignore rien des histoires, mais qui envisage qu’il y ait plus à gagner ensemble que les uns contre les autres.
La déradicalisation ne passe pas par la mise en cage des menaces. Cela, ce serait de l’immobilisation. La déradicalisation passe par une réponse à la soif de vivre. Elle passe par des propositions plus intéressantes en termes d’idéal. Elle refuse de se contenter d’eau plate, autrement dit morte. La déradicalisation passe par la résurrection du désir de vivre et d’être soi-même source de vie pour les autres, d’être soi-même source d’eau vivifiante, d’être soi-même transmetteur de pulsions de vie ; ces pulsions de vie qui ne connaissent ni frontière, ni religion.
28 La femme donc laissa sa cruche et s’en alla à la ville, et dit aux hommes :
29 Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; celui-ci n’est-il point le Christ ?
30 Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers lui.
31 Mais pendant ce temps, les disciples le priaient, disant : Rabbi, mange.
32 Mais il leur dit : Moi, j’ai de la viande* à manger que vous, vous ne connaissez pas.
33 Les disciples donc dirent entre eux : Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ?
34 Jésus leur dit : Ma viande* est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre.
— v. 32, 34 : aliment, nourriture.
La Samaritaine à reçue les paroles de Jésus-Christ elle laisse sa cruche va en ville et elle "dit aux hommes" ici "dit aux hommes" est d’une extrême importance, "elle laissa sa cruche" Il faut comprendre qu’elle abandonne ses veilles croyances. Il n’est pas dit qu’elle "dit à tout le monde" non elle "dit aux hommes" elle les enseigne.
Le fait que les femmes puissent être pasteur est un fait encore trop rare, il faut bien le reconnaître, car cela ne remonte qu’à la 2e guerre mondiale pour les premières femmes pasteurs, et il a même fallu encore attendre longtemps avant que les synodes des Églises réformées acceptent pleinement le ministère pastoral féminin. Certaines églises sans parler que de l’Église catholique, mais certaines Églises protestantes celle que je fréquente d’ailleurs refusent encore de nommer des femmes au ministère pastoral.
Mais si l’on regarde le Nouveau Testament, c’est incroyable qu’il ait fallu attendre si longtemps. Car il apparaît qu’à la suite de Jésus les femmes ont eu une véritable place aux plus hautes responsabilités. Le ministère pastoral féminin n’est donc pas une invention du XXe siècle mais un juste retour à l’impulsion donnée par Jésus-Christ.
Contrairement à certaines habitudes de l’époque réservant aux hommes l’enseignement biblique, dans l’entourage de Jésus, les femmes sont dignes de recevoir les paroles du Christ, et de s’asseoir comme Marie, sœur de Marthe & Lazare, aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement, et le groupe de disciples de Jésus comprenait des hommes et des femmes, pas seulement des hommes. Certains me diront c’est toujours le cas, le droit d’écoute ne donne pas le droit d’enseigner. En somme nous si sûr ? La Samaritaine est là pour nous dire le contraire elle a écouté puis elle est allée ver les hommes de sa ville annoncé la "bonne" nouvelle n’est ce pas là le rôle d’un pasteur ?
Les évangiles disent également que les femmes sont "au service" des autres, le verbe employé est en grec diakoneo est important car c’est celui qui désigne la fonction de diacre existant au temps de rédaction des évangiles, et que ce verbe est utilisé par le Christ pour parler de sa propre mission "le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie" (Mr 10:45).
Et enfin, les Évangiles culminent tous plus ou moins sur la figure de Marie Madeleine qui surpasse les plus grands apôtres, Pierre et Jean, dans l’expérience du Christ ressuscité, et devient ainsi, explicitement, l’apôtre des apôtres, chargée d’annoncer l’Évangile aux 11 apôtres qui restent… Des hommes qui, eux, ont abandonné Jésus et qui restent coupés de lui, et qui longtemps méprisent le témoignage des femmes, bloqués dans leurs préjugés culturels faisant que le témoignage d’une femme ne vaut pas grand-chose… Marie Madeleine est ainsi faite par le Christ ressuscité une apôtre, mais on peut dire ici que la Samaritaine, également, est envoyée vers les hommes de son village pour les mener vers Jésus. On pourrait dire que Marthe est envoyée par Jésus vers sa sœur Marie (Jean 11).
Ensuite, nous voyons dans les Actes des apôtres que les fils et les filles sont porteurs de l’Esprit, et donc faits prophètes (Actes 2 : 17), appelés à témoigner dans le monde du point de vue de Dieu. En particulier les 4 filles du diacre Philippe (Actes 21 : 9)
Dans les épîtres de Paul, nous voyons que des femmes avaient des rôles de premier plan à tous les niveaux :
- Apôtre : Junia (Romains 16:7), malgré les tentatives quelques siècles plus tard de masculiniser ce nom en Junias, montrant bien le scandale que cela a posé quand les machos ont repris l’Église chrétienne en main.
- Diacre : Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l’Église de Cenchrées (Romains 16:1)
- Collaboratrice de Paul : Prisca est une collaboratrice dans le Seigneur (Romains 16:3)
- Responsable d’une assemblée chez elle : Lydie (Actes 16)
Alors c’est vrai qu’il existe quelques versets des lettres de Paul qui disent que la femme ne devrait pas avoir l’autorité sur l’homme ou que la femme doit se taire dans une assemblée (! 1 Cor 14:34). Mais il me semble que l’on ne peut pas faire autrement que de penser que ces phrases étaient liées à des circonstances très particulières d’une ville, puisque ailleurs Paul n’applique lui-même pas ce genre de restrictions, ni dans d’autres villes, ni même à Corinthe, puisque quelques chapitres avant, le fait d’enseigner en public n’est pas interdite aux femmes, mais elles doivent le faire de façon digne 1 Cor 11:5, sous l’influence de l’Esprit et pour l’édification de la communauté, et cela est aussi valable pour les hommes. Cela correspond à un usage pendant des siècles.
Mais même si Paul avait été favorable à cantonner la femme dans des postes ancillaires (ce que je ne pense pas que l’on puisse raisonnablement le penser), ce n’est pas Paul notre Christ mais Jésus, lui qui a fait d’une femme l’apôtre des apôtres, « apostolorum apostola » comme le remarque aussi Hippolyte de Rome à la fin du IIe siècle. Alors, bien entendu, il n’est pas question d’être fondamentaliste, c’est-à-dire de lire les écritures comme si elles étaient une loi éternelle gravée par le doigt de Dieu sur des tables de diamant pur, et dire à partir de cela que les plus hautes responsabilités d’enseignement devraient être réservées aux femmes. D’interpréter les paroles de Jésus-Christ littéralement comme le font ici ses propres disciples : "31 Mais pendant ce temps, les disciples le priaient, disant : Rabbi, mange.
32 Mais il leur dit : Moi, j’ai de la viande à manger que vous, vous ne connaissez pas. 33 Les disciples donc dirent entre eux : Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ?"
Il convient de lire les écritures par l’Esprit, voyant ce que Dieu espère de nous pour notre temps, en s’inspirant des témoignages anciens contenus dans les écritures saintes, mais aussi en s’inspirant de la façon d’être de ces femmes et de ces hommes qui ont littéralement inventé une façon de vivre la foi transmise par le Christ.
Il me semble donc juste de dire que des femmes comme des hommes sont appelés au ministère pastoral. Mais à vrai dire, cela n’a rien d’extraordinaire car le pasteur est avant tout un théologien au service d’une église locale, un permanent d’association, un serviteur pour des personnes et une communauté, mais ce n’est pas quelqu’un de spécial. Pasteur, c’est un métier en quelque sorte, ce peut-être un second, les hautes distinctions et responsabilités, c’est d’être prêtre, c’est d’être prophète, porteur de l’Esprit, et c’est d’être roi, cohéritier avec le Christ du Royaume… Et ces missions elles sont données à chacune et chacun, homme comme femme, quels que soit l’âge et le pays, le degré d’instruction et la santé, la condition sociale. Et ne pas oublier que "Ma (notre) viande est de faire la volonté de celui qui m’a (nous a) envoyé, et d’accomplir son œuvre.
35 Ne dites-vous pas, vous : Il y a encore quatre mois, et la moisson vient ? Voici, je vous dis : Levez vos yeux et regardez les campagnes ; car elles sont déjà blanches pour la moisson.
36 Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle ; afin que, et celui qui sème et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble.
37 Car en ceci est [vérifiée] la vraie parole* : L’un sème, et un autre moissonne.
38 Moi, je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n’avez pas travaillé ; d’autres ont travaillé, et vous, vous êtes entré dans leur travail.
— v. 37 : proprement : le vrai dicton.
Jésus a parlé avec bonheur de l’œuvre de Dieu qu’il accomplissait. (verset 34) Maintenant, il en contemple d’avance les résultats dans ces Samaritains qu’il va amener au salut. Il peint ce triomphe de l’Évangile par une très belle image empruntée à la nature.
4 : 35a "Ne dites-vous pas, vous : Il y a encore quatre mois, et la moisson vient ? " C’est une phrase métaphorique montrant que l’opportunité de la réponse spirituelle était sur le champ ! Les gens étaient sauvés par la foi en Jésus au cours de Sa vie ; et après Sa résurrection.
4 : 35b "Voici, je vous dis : Levez vos yeux et regardez les campagnes ; car elles sont déjà blanches pour la moisson."
Dans la campagne qui s’étendait à l’entour on pouvait voir une promesse de la moisson, mais celle-ci ne devait être mûre que dans quatre mois.
Jésus invite ses disciples à regarder cette campagne comme étant déjà blanche pour la moisson. Il entend par là la moisson spirituelle parmi ces habitants de la Samarie qu’il voyait accourir à lui.
- On peut aussi rattacher le mot "déjà" au commencement du verset suivant, qu’il faudrait alors traduire ainsi : "Et déjà celui qui moissonne, etc."
- La moisson avait lieu en avril, les quatre mois dont parle Jésus nous reportent en décembre. Le séjour de Jésus en Judée, commencé à la fête de Pâque, s’était donc prolongé plus de huit mois.
"Encore quatre mois et la moisson vient," un dicton populaire indiquant le temps qui s’écoule entre les semailles et la moisson.
Le grain représente la Parole de Dieu.
Certains ont semé la parole, d’autres moissonnent. La moisson représente les âmes qui sont sauvées. Jésus avertit de ne pas raisonner en disant
:" Il reste quatre mois…..et alors viendra la moisson".
Selon l’usage, les semences étaient faites en fin d’année et il fallait attendre que l’hiver passe, puis le printemps pour qu’arrive le temps de récolter, de moissonner. Cette période durait à peu près quatre mois. Jésus se sert de cet exemple pour souligner qu’il n’en est pas ainsi de la moisson spirituelle. La moisson est "prête à être faite" "le blé est mûre" et est toujours "mûre" durant tous les jours de la vie du corps. Après il sera trop tard. Nous devons faire notre travail au moment voulu, sinon, comme le proverbe le dit : "La moisson est passée et le grenier est vide "
Les disciples ne peuvent pas discerner cette réalité. Les Samaritains qui arrivent, amenés pas la femme, sont les fruits spirituels de cette moisson. Ainsi, Jésus dit : "Levez les yeux sur la moisson, regardez les champs, qui blanchissent pour la moisson".
D’autre part, nous devons savoir que c’est Dieu qui fait pousser la semence. On ne sait pas comment car c’est une œuvre secrète, Dieu agissant dans le cœur de l’homme.
Marc 4 : 26 "Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre ; 27 qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il sache comment. 28 La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi ; 29 et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là."
4.36 " Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle ; afin que, et celui qui sème et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble."
Celui qui moissonne reçoit un salaire qui consiste à amasser du fruit pour la vie éternelle, c’est-à-dire à recueillir des âmes sauvées.
Cette sentence générale fait comprendre aux disciples que la moisson dont Jésus vient d’annoncer qu’elle est déjà prête, (verset 35) est une moisson spirituelle.
La première partie du verset 36 est une parenthèse explicative.
Jésus se reporte ensuite au fait qu’il a signalé à ses disciples : les campagnes sont déjà blanches pour la moisson ; (verset 35) il en est ainsi continue-t-il, dans l’intention de Celui qui a hâté la marche des événements, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
Dans la règle leur joie n’est point simultanée. Et même les semailles nous sont présentées dans une comparaison connue de l’Ancien Testament, comme un travail pénible. (Psaumes 126.5,6) Mais dans cette circonstance unique Dieu permet que le bonheur des semailles coïncide avec le bonheur de la moisson. Dans la suite (verset 38) Jésus donnera à entendre le sens de cette parabole : celui qui sème, c’est lui-même qui vient de répandre le bon grain dans l’âme de la Samaritaine et va enseigner encore ses concitoyens. (versets 40-42)
Les disciples auront à remplir le rôle de celui qui moissonne.
4.38 "Moi, je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n’avez pas travaillé ; d’autres ont travaillé, et vous, vous êtes entré dans leur travail."
Au verset 37 Jésus confirme (car) ce qu’il donnait à entendre à la fin du verset 36, à savoir que, dans le cas particulier et contrairement à la règle générale, le moissonneur est distinct du semeur. Il le fait en citant un proverbe dont il constate qu’il est vrai dans le cas donné ; puis il dit positivement que c’est lui qui a envoyé ses disciples moissonner là ou d’autres ont travaillé.
Ces paroles trouvaient leur application immédiate dans ce qui se passait alors, près du puits de Jacob, mais elles ont une portée plus étendue qui se vérifiera dans toute la carrière des disciples.
Si Jésus n’avait pas semé, implanté dans notre humanité les germes d’une vie divine, jamais les apôtres n’y auraient recueilli une moisson pour la vie éternelle.
- Par ces mots : d’autres ont travaillé, plusieurs interprètes ont entendu Jésus et Jean-Baptiste, ou encore les prophètes avant eux. Il est plus probable que Jésus n’entend parler que de lui-même, et qu’il se voile en quelque sorte sous ce pluriel.
En parlant ainsi, il ne méconnaît point le rude labeur qui attend ses disciples ; mais, de même qu’en Samarie ils ont part à la joie de la moisson que leur Maître a préparée, de même, à l’avenir, ils ne feront qu’entrer dans son travail et le poursuivre, comme le font encore aujourd’hui tous ses fidèles serviteurs.
39 "Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage : Il m’a dit tout ce que j’ai fait.
40 Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le priaient de demeurer avec eux ; et il demeura là deux jours.
41 Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole ;
42 et ils disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ton dire que nous croyons ; car nous-mêmes nous [l’]avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde."
L’évangéliste reprend son récit, interrompu au verset 30.
Plusieurs des Samaritains crurent en Jésus, d’une foi qui n’avait encore d’autre fondement que le témoignage de la femme.
Mais comme cette foi était sincère, elle va devenir tout autre par un moyen plus direct. (verset 42)
4.40 "Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le priaient de demeurer avec eux ; et il demeura là deux jours."
La prière de demeurer auprès d’eux, que les Samaritains adressent à Jésus, après être venus vers lui, c’est-à-dire après l’avoir vu et entendu, est l’indice d’un progrès dans leur foi, et du besoin qu’ils ressentent de plus de lumière.
De son côté, Jésus, heureux de voir ces hommes altérés de vérité, va leur consacrer deux jours entiers.
4.41 "Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole ;"
Ces mots : à cause de sa parole, dont ils avaient éprouvé dans leur cœur la vérité et la puissance, forment ici un contraste marqué avec ceux-ci : "à cause de la parole de la femme." (verset 39)
4.42 "et ils disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ton dire que nous croyons ; car nous-mêmes nous [l’]avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde."
Les Samaritains expriment clairement la différence qu’il y a entre la foi d’autorité, qui repose sur un récit, un témoignage et la foi qui se fonde sur l’expérience immédiate et personnelle (nous-mêmes, nous avons entendu).
Et telle a été la puissance de la parole de Jésus sur leur âme, pendant ces deux journées, qu’ils peuvent dire, non seulement nous croyons, mais nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. On s’est étonné de trouver dans la bouche de ces Samaritains une profession si explicite de leur foi, qui s’élève jusqu’à l’universalité du salut.
Mais, cette confession est très compréhensible, puisqu’elle est le fruit de deux jours d’instructions de Jésus, et elle l’est d’autant plus que les espérances messianiques des Samaritains n’étaient pas entachées de l’étroit particularisme juif. La semence de vie répandue par le Sauveur dans cette contrée ne périt point, mais prépara la riche moisson que les disciples y firent plus tard. (Actes 8.5-8,14-17)
Ajouter un commentaire