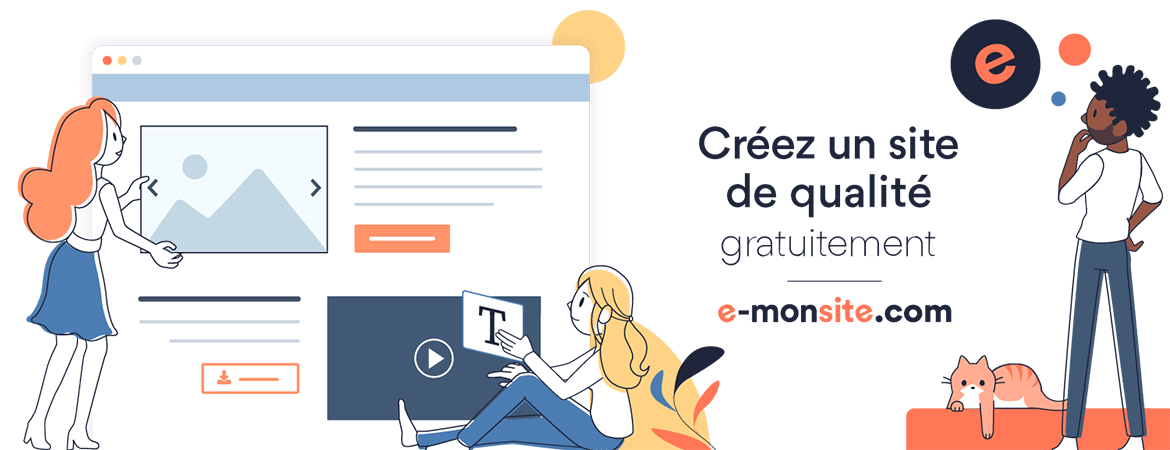- Accueil
- L'enseignement de Jésus au travers les Evangiles
- Jésus et l'appel à la non-violence et faire sien le royaume de Dieu.
Jésus et l'appel à la non-violence et faire sien le royaume de Dieu.
Aimez vos ennemis
(Lc 6:27-28, 35c-d; Mt 5:45)
source Q
6:27 Aimez vos ennemis
6:28 et priez pour ceux qui vous persécutent,
6:35c-d afin que vous deveniez les fils de votre Père, parce qu'il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes.
L’histoire de l’humanité est dominée par la violence. Même de nombreux passages dans la Bible font état de violence, et attribut même à Dieu le droit à légitimer la violence.
Le facteur religieux est cité comme essentiel - voire central - à propos de nombreux actes de violence ou guerres. On pense à des conflits d’un passé récent, encore dans nos mémoires : Irlande du Nord, Liban, Balkans, Sri Lanka… On pense surtout à des faits actuels : la terreur que font régner Al Qaïda au Mali, Boko Haram au Nigéria, les Talibans en Afghanistan et bien sûr Daesh en Syrie et en Irak. On évoque aussi les affrontements entre chiites et sunnites en Irak, la persécution, en Birmanie (ou Myanmar) des Rohyingas musulmans par la majorité bouddhiste, la persécution des minorités chrétiennes et yézidies dans l’ensemble des pays du Moyen Orient. Tout près de nous, les attentats terroristes commis dans nos pays européens, comme ceux de Charlie Hebdo et du Bataclan en 2015 ; certains crient « Allah Ouakbar », comme lors de l’assassinat du Père Hamel… Tout cela accrédite dans l’opinion l’idée que les religions sont des causes de violences, quel que soit par ailleurs le caractère pacifique de leur message.
C'est vite oublier que les religions ont été aussi persécutées que persécutrices. Elles le furent persécutées au nom d'une autre religion et même de l’athéisme quand ce dernier était « religion d'État », les deux grands totalitarismes, le brun et le rouge, qui ont ensanglanté le XXème siècle avaient bel et bien pour point commun d’être agressivement athées.
Cependant les croyants sont nombreux parmi les artisans de paix les plus actifs, qui prennent des risques personnels importants pour s’opposer à la violence et à l’injustice. On se souvient, bien sûr, des célèbres figures de Gandhi et de Luther King dans le passé, de Mgr Desmond Tutu plus récemment en Afrique du Sud, sans oublier, bien sûr, le message de paix et de non-violence du Dalaï Lama. Mais tous ces croyants prônants la non-violence n'étaient-ils pas plus avant toute chose des êtres spirituels que des religieux ?
Il faut commencer par s’interroger sur le mot même de « religion ». Qu’évoque-t-il à nos oreilles d’Occidentaux ? Des croyances, des « pratiques » (prière, culte), des règles de conduite (une éthique), parfois une « spiritualité ». Ce n’est pas la notion de « communauté » qui nous vient d’abord à l’esprit. Ou alors, il s’agit de communautés qui se rassemblent volontairement, pour prier, partager une même foi. Mais chacun peut sortir librement de ces « communautés », même s’il y a encore, çà ou là, des pressions familiales et des conformismes sociaux qui peuvent restreindre cette liberté.
Cette importance de l’adhésion libre à une religion, dans nos pays, nous fait oublier qu’il n’en va pas de même partout dans le monde. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, le mot « religion » renvoie d’abord à une communauté, dans laquelle on naît et meurt, sans pouvoir en sortir, même si on n’adhère plus intérieurement à ce que professe cette religion. Bien sûr, il y a aussi des croyances, des rites, des conduites, mais ce sont justement ceux qui signent l’appartenance à la communauté.
Dans beaucoup de sociétés – notamment celles où l’identité nationale est en crise ou ne s’est pas constituée – l'appartenance religieuse n'est pas d'abord perçue comme une foi, une spiritualité, mais comme une étiquette permettant de s’identifier comme communauté. Dans le Liban des années de la guerre civile, il est rare qu’on se définisse d’abord comme « Libanais » : on est « chrétien maronite », « musulman chiite », « musulman sunnite », « chrétien grec-catholique », etc. et secondairement « libanais ». Et cela même si l’on est subjectivement athée.
Si on entend par « guerre de religion » une guerre où les acteurs puisent dans leur croyance religieuse même la conviction que c’est pour eux un devoir religieux que de faire la guerre aux croyants d’autres religions ou d'autres courants de pensées de leur religion (pour les soumettre, les éliminer ou les convertir), les cas sont sans doute aujourd'hui peu nombreux. Le plus souvent, on parle de « guerre de religion » à propos d’une guerre où le facteur religieux est très important. Mais il n’est presque jamais le seul.
Évidemment, on pense aujourd’hui au « djihadisme ». Ceux qui, parmi les djihadistes, recourent à la violence (notamment terroriste) – pas tous, loin de là – relèvent de ce cas, du moins si on écoute ce qu’ils disent : ils prétendent tirer de leur croyance religieuse la conviction qu’il est légitime, et même obligatoire, de faire la guerre à ceux qu’ils perçoivent comme des ennemis de leur religion.
C’est ce qu’ils disent, mais on garde le droit de s’interroger. La plupart des experts expliquent qu’il s'agit d’abord d'un projet politique qui mobilise le registre religieux. Sans doute ne savons-nous rien de la croyance subjective de ceux qui le promeuvent et qui appellent à la violence en s'appuyant sur leur interprétation de l'islam. Mais l’expansion des mouvements qui portent ce genre de projet politique s’explique surtout par le fait que le registre religieux est devenu le seul qui soit disponible pour exprimer une opposition politique radicale.
Cependant le plus souvent la radicalisation va de pair, avec une profonde ignorance religieuse.
Ce qui importe, c’est le rapport entre les croyants et leurs textes sacrés
Peut-on classer les religions selon qu’elles seraient plus ou moins pacifiques ou plus ou moins pro violence ? Beaucoup le pensent. Ils croient qu’il suffit d’examiner ce que disent les textes sacrés de chaque religion. Ainsi, on dira : l’Ancien Testament est rempli de guerres saintes ; donc le judaïsme est plutôt violent. Le message de Jésus-Christ, c’est la non-violence, l’amour des ennemis ; donc les chrétiens sont forcément pour la paix, la tolérance. Le Coran contient des passages légitimant le djihad ; donc, il va de soi que les musulmans sont davantage enclins à la violence. Le bouddhisme a parmi ses principes fondateurs l’ahimsa, la non-violence radicale ; donc les bouddhistes sont toujours des artisans de paix. L’hindouisme accepte aisément les divinités des autres religions, qu’il se contente d’ajouter à son panthéon ; donc il est tolérant par nature, etc.
Le problème, c’est que si on regarde non plus ce que dit les textes mais ce que font les croyants, on s’aperçoit que les faits historiques contredisent totalement ces idées toutes faites.
Le christianisme a produit les croisades, et pas seulement au Moyen Âge ! Les propos de certains prélats espagnols, lors de la guerre civile, en plein XX siècle, sont des propos de « guerre sainte ». Le catholicisme a inventé l'inquisition. Au Sri Lanka, pendant la guerre civile, ce sont les moines bouddhistes qui ont mené les campagnes les plus vigoureuses pour torpiller les chances de paix, car ils identifiaient Bouddhisme et culture Cingalaise (anti-tamoule). En Birmanie (Myanmar), la majorité bouddhiste de la population soutient la persécution des Rohyingas musulmans et leur expulsion vers les pays voisins. Quant à l’hindouisme, c’est parmi ses défenseurs les plus farouches que s’est développée l’idéologie Hindutva, qui identifie religion hindoue et citoyenneté indienne, et qui jette le soupçon sur les chrétiens et surtout les musulmans… Ce sont des hindous extrémistes qui ont assassiné Gandhi, qu’ils jugeaient trop favorable aux musulmans.
C’est donc moins le contenu des textes que la relation entre les croyants et leurs textes qui pose problème. S’agit-il d’une relation qui laisse toute sa place à l’interprétation, à l’exercice de la raison, à l’esprit critique ? Ou de la répétition automatique de formules apprises ? Ce rapport d’interprétation évolue avec le temps, avec les circonstances politiques, sociales, culturelles… Prenons l’exemple du christianisme : la question pertinente n’est pas de savoir s’il est violent ou non-violent. Mais : pourquoi, à une époque, les chrétiens mettent-ils en avant les textes de l’Ancien testament qui légitiment la guerre et, à d’autres époques, ils ne parlent que du Sermon sur la montagne et de son message de douceur et de non-violence ?
La question de savoir si telle ou telle religion est plutôt facteur de violence ou plutôt facteur de paix ne relève pas d’abord de la théologie, mais de la sociologie religieuse, de l’histoire des mentalités, de l’analyse de la situation de chaque religion dans son environnement social, politique et culturel, etc.
Si l’on veut comprendre ce qui se passe aujourd’hui dans les régions du monde où l’islam est prédominant, il est plus éclairant de faire appel à l’expertise des historiens, des économistes, des politises spécialistes de ces régions plutôt qu’à des islamologues spécialistes du Coran. On évite ainsi les lectures culturalistes, qui prétendent trouver dans la tradition musulmane des « constantes », qui cherchent à coupler de manière a-historique les croyances des musulmans d’aujourd’hui aux comportements violents de certains de leurs ancêtres.
Quant à la question du rapport à la violence dans les cultures marquées par les textes sacrés, ceux-ci fournissent un cadre à des interprétations, mais aussi à un imaginaire, et cet imaginaire n’est pas forcément un imaginaire non-violent. Cela interdit-il toute lecture radicalement non-violente de l'Ancien Testament ou du Coran ? Non. Mais à l’inverse, l'Ancien Testament ou le Coran, n’obligent pas à une lecture violente. Je dirais que l'Ancien Testament et le Coran ne sont pas des textes violents, mais qu’ils offrent une certaine disponibilité à un usage violent. Une comparaison peut être éclairante, si on en ôte l’effet « point Godwin » tout à fait fâcheux : Wagner n’était pas nazi, Nietzsche n’était pas nazi, mais ils ont pu être récupérés par le nazisme ; ce que le nazisme n’aurait jamais pu faire avec la philosophie de Kant ou la musique de Haydn. Faut-il condamner Wagner et Nietzsche pour cette disponibilité ?
À la question, « les religions sont-elles facteurs de paix ou de violence ? », aucune réponse n’est possible tant que l’on n’a pas défini le mot « religion ». Il faut donc déplacer la question, et s’interroger, non pas sur « les religions », mais sur la relation que les individus, les peuples, les communautés de croyants entretiennent avec leur religion : s’agit-il d’un rapport intériorisé (foi, spiritualité), soumis au questionnement critique de la raison et de l’éthique, préservant la liberté d’adhérer ou non à la communauté constituée par les croyants ? Ou s’agit-il d’un héritage que l’on reçoit sans le faire sien, une identité qui sécurise et donne de l’assurance au sein d’un groupe homogène ? Dans ce dernier cas, le risque est très grand de voir cette religion (disons plutôt : cette adhésion du groupe à une identité religieuse communautaire) être instrumentalisée pour tout et n’importe quoi par le premier politicien habile et manipulateur.
Derrière ces questions, il y a, plus radicale encore, celle de l’image de Dieu véhiculée par chaque religion. Est-ce le « Dieu de la tribu » ? Le Dieu qui épouse les causes politiques d’un peuple particulier ? Ou un Dieu universel, qui se propose à tous, mais sans s’imposer à qui que ce soit ?
Le Dieu que Jésus présente dans l’Évangile ne peut encourager la moindre violence. Comme il est présenté ici, « Il fait lever son soleil sur les justes et les injustes, tomber la pluie sur les bons et les méchants ». Quant à la violence, Jésus ne la rend pas, mais la prend sur lui : « En sa chair il a tué la haine » (Paul, épître aux Ephésiens). Et il invite à « aimez ses ennemis », à refuser l’usage du glaive…
S’il arrive que des chrétiens se résignent à recourir à une violence qui leur semble « juste » (compte tenu des conséquences du choix inverse), ce ne peut donc être que pour des raisons éthiques, politiques mais jamais pour des raisons religieuses.
L’humanité a été meurtrie et humiliée par la violence depuis des siècles. Cependant, l’homme n’a pas uniquement subi et exercé la violence ; il n’a pas toujours été dans une relation de domination et de soumission. Il y a eu des moments privilégiés de son histoire où il a pris conscience de la violence qu’il fait à son espèce et aux autres êtres vivants et où il a essayé de trouver des moyens éthiques et politiques de s’opposer à elle. En disant non à la violence l’homme a créé l’idée de non-violence. Cette notion est plus que jamais au centre de nos débats actuels. Mais pour mieux la comprendre, il faut se reporter à son histoire et aux différentes figures historiques qui l’ont incarnée durant les trente derniers siècles. Jésus, et à travers lui le christianisme n'est pas le seul dans l'antiquité à prôner la non-violence. On retrouve des commandements des recommandations à la non-violence chez tous les « fondateurs » spirituels et dans toutes les religions qui ont traversé l'histoire humaine et sont parvenu jusque nous.
L'ennemi dans la Bible, c'est celui qui refuse l'amour comme loi du monde. C'est celui qui sème la zizanie, qui refuse la justice, la vérité, et qui fait tout ce qui empêche l'amour.
« Tu aimerais ton ennemi » n’est pas littéralement dans l’Ancien Testament, même si plusieurs textes de sagesse insistent sur l'attention à porter à l'ennemi dans la détresse : « si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire » (Prv 25, 21)
Pour autant il est plus souvent question de dénoncer ceux qui attaquent Dieu, et la communauté de Qumran se fait un devoir d’aimer tous les fils de lumière et de haïr tous les fils des ténèbres.
En cela Jésus différait totalement des Esséniens.
L’histoire de la non-violence se présente donc comme un refus de la violence historique. Mais dire non à l’histoire en tant que violence, c’est déjà une manière de la transgresser et de la transcender. Par un contraste radical, la non-violence s’oppose au cours de l’histoire en proposant sa propre histoire : celle qui assure le respect de la dignité humaine. La non-violence se présente dans l’histoire à la fois comme un refus de la violence institutionnelle et comme une « éthique de conviction » qui vise à faire valoir la dignité humaine en proposant une vision morale du monde. Nous pouvons donc penser la non-violence comme une attitude purement éthique, mais aussi comme un moyen de résistance à l’injustice. En tant que forme de « résistance » et de « désobéissance », la non-violence prend un tour négatif et se révèle une stratégie du refus, qui utilise diverses méthodes de dissuasion, tels la grève, le boycottage, la manifestation, pour venir à bout du mal auquel elle résiste. Par ces méthodes, la stratégie non violente s’exprime comme une véritable force de pression sur l’adversaire. Mais pour être efficace, cette forme de résistance doit s’inscrire dans les structures politiques et collectives de la société civile.
Ce type de non-violence - nous l’appellerons la « non-violence stratégique » - surgit dans l’histoire comme une réponse spontanée d’une population opprimée à une situation jugée intolérable. Le XX siècle présente des cas variés d’actions non violentes de ce genre où les acteurs sociaux de la non-violence ont tenté de résister à la violence institutionnelle par les moyens d’une non-violence insurrectionnelle. Par exemple : la lutte non violente menée par Nelson Mandela contre la politique de l’apartheid peut être considérée comme ressortissant à la non-violence stratégique. Par son recours aux moyens de persuasion et à la non-coopération, cette forme de non-violence cherche donc à transformer l’espace public de la société civile. Elle fonde et garantit en quelque sorte un espace de délibération et de discussion où les membres de la société peuvent débattre leurs problèmes.
Si l’on admet avec Hannah Arendt qu’« être politique, vivre dans une polis, cela signifie que toutes choses se décident par la parole et la persuasion et non par la force ni par la violence », la non-violence stratégique apparaît comme une tentative de création, de gestion, de la démocratie. Posée en ces termes, elle vise à faire émerger le « vouloir vivre ensemble » dans une société donnée en remplaçant les rapports de domination-soumission entre les hommes par des rapports de dialogue et d’échange. La non-violence stratégique est une forme pragmatique et conflictuelle d’action non violente. C’est par son pragmatisme et sa façon de conflictualiser l’espace public qu’elle propose d’établir un « rapport de réciprocité » entre les individus, rapport qui se fonde sur le respect de la dignité de l’autre. Il ne peut y avoir de dialogue sans le principe de respect, de même qu’il ne peut y avoir de politique, au sens véritable, sans le dialogue et l’échange d’idées. Mais respecter l’autre ne signifie pas pour autant le convertir. C’est ici le point de divergence entre la non-violence stratégique et ce deuxième type de non-violence : la « non-violence spirituelle », celle qui est ici enseignée par Jésus, celle voulue par Dieu.
La non-violence spirituelle est une non-violence de conviction, voire de conscience, et non pas de stratégie. Bâtie sur une conviction éthique ou religieuse, elle se présente sous forme d’un impératif catégorique adressé à l’individu par une doctrine religieuse ou philosophique : « Tu ne tueras pas » ou « Tu aimeras ton prochain » ou « tu aimeras tes ennemis ». Elle n’est donc pas formulée comme une stratégie de riposte à une situation politique donnée, mais comme une règle de conduite quotidienne. Axée sur ce que Paul Ricœur appelle un « noyau prophétique », la non-violence spirituelle est issue d’une victoire de la conscience morale sur la dure loi de la réalité. Elle n’est donc pas de nature politique, car elle n’a pas pour fin d’engendrer le conflit au sein de l’espace public : c’est au regard de son exigence morale qu’elle refuse d’obéir à l’autorité politique. Le but visé par un « non-violent spirituel » n’est pas la gestion démocratique de la société, mais l’affirmation de son éthique religieuse par la voie de la non-violence. Celle-ci se caractérise donc plus par une position d’attente eschatologique que par une tentative de modification de la sphère politique. L’important n’est pas l’élaboration « horizontale » du contrat social, mais l’acceptation d’une règle d’or destinée à procurer la paix intérieure et le salut individuel. Ce qui ne veut pas dire que la non-violence spirituelle évite de transgresser une loi politique quand celle-ci est estimée injuste. Bien au contraire, de nombreux cas historiques nous montrent qu’à chaque fois que la non-violence spirituelle se trouve face à une autorité tyrannique ou dans une situation de violence généralisée, elle tente d’investir la sphère du politique, au nom du « vivre ensemble » en vue de protéger et de promouvoir son éthique de conviction. La non-violence spirituelle prend alors une orientation « stratégique » sans abandonner pour autant sa substance éthico-religieuse. Son action est donc marquée par l’affirmation de son identité religieuse. Sa résistance civile passe par un état de purification personnelle. Engagement non violent et croyance religieuse vont ici de pair. La résistance d’un non-violent spirituel ne peut se développer que sur la base d’impératifs religieux et éthiques.
La liste de ceux dont la résistance s’inscrit dans une telle perspective est longue. Sans doute les deux plus grands noms de cette non-violence au XX siècle sont-ils Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Pour Gandhi, la vérité et la non-violence étaient « les deux faces de la même médaille ». L’exigence de véracité se confond à ses yeux avec celle de non-violence. Celle-ci est pour lui un moyen de connaître la vérité, qui est Dieu. « Dans la réalité, écrit Gandhi, il n’est rien, il n’existe rien que la vérité. » Et il ajoute : « La vérité subsiste même si le public n’y croit pas, elle subsiste d’elle-même. » C’est donc la vérité qui détermine sa ligne de pensée et d’action. Sans elle la non-violence n’a pas de sens. Il faut considérer l’entrée en politique de Gandhi comme un acte religieux, c’est-à-dire comme un acte de conviction. Il l’a répété souvent lui-même : « J’ai toujours dit que ma politique est soumise à ma religion », ou encore : « Je ne me mêle de politique que dans la mesure où elle développe en moi la faculté religieuse. »
La désobéissance civile et la non-coopération chez Gandhi sont des actes religieux avant d’être des actes politiques. Il en va de même pour Martin Luther King, chez qui l’amour (agape) est le pilier de la résistance non violente. Ce que King entend par l’amour n’est que la doctrine qui traduit l’enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans :« aimé vos ennemis ». Ce rapport à Dieu est aussi déterminant dans la pensée de King que dans celle de Gandhi. Si l’on ne tient pas compte du caractère théologique du choix qu’il a fait de la non-violence, on s’expose à n’y voir qu’une simple tactique de lutte politique. Il ne faut jamais oublier que chez King, la conviction religieuse passe avant la stratégie de l’action sociale. Dans ses discours et écrits, il ne cesse de souligner sa proximité intellectuelle et spirituelle avec la doctrine de Jésus. Pratiquer la non-violence devient pour lui le devoir d’un homme de foi. « Je marche parce que je le dois, affirme King, parce que je suis un homme et un enfant de Dieu ».
L’éventuel échec de sa stratégie ne préoccupe donc pas trop le non-violent spirituel, car il sait en son for intérieur que la victoire finale dépend de Dieu et non de lui-même. Pour King, son combat est le combat de Dieu ; la non-violence telle qu’il la pratique n’a pas de fondement sans Dieu. Il se lève pour défendre le droit, la justice et la non-violence au nom de Dieu et, surtout, pour chercher Dieu. En fait, c’est l’être même de Dieu qui le force à s’opposer aux lois injustes. Sous-jacente à cette pensée, il y a l’idée que Dieu n’est pas neutre et qu’il se soucie toujours sérieusement des exclus, des rejetés et des opprimés. C’est une idée fondamentale qu’on retrouve chez d’autres chrétiens non violents comme Desmond Tutu et Mère Teresa.
Pour saisir l’essence de l’action non violente chez Gandhi, King, Tutu, Mère Teresa ou le Dalaï-Lama, il faut revenir à la racine même du mot « non-violence ». Il est une traduction approximative du mot sanskrit ahimsa. En faisant de cette notion la condition principale de la satyagraha ou « étreinte de la vérité », Gandhi a voulu marquer sa dette envers le legs de la culture indienne, en particulier la tradition jaïniste et l’école brahmanique.
L’ahimsa est un concept négatif : le, "a" privatif (a-himsa) exprime une opposition et un refus. C’est le rejet du himsa ou nuisance. Selon Albert Schweitzer, le verbe hims est une forme dérivée de han (tuer, blesser) et signifie donc le désir de tuer et de blesser.Ainsi le substantif a-himsa signifie « la renonciation au désir de tuer et de blesser ». Mais s’il exprime grammaticalement une négation, ce concept n’en possède pas moins un contenu positif et dynamique : celui de la résistance à la violence et au mal. L’ahimsa n’est pas seulement un acte d’abstention, c’est aussi un acte d’opposition au mal qui doit s’effectuer par l’esprit du bien. Adhérer au principe d’ahimsa, c’est substituer au himsa, à la nuisance, une autre dynamique : le principe de l’amour.
Inspiré par ses lectures des Évangiles et du « Royaume de Dieu est en vous » de Tolstoï, Gandhi a voulu affiner le concept jaïniste d’ahimsa en l’identifiant avec le concept chrétien d’amour. De négatif qu’il est dans la doctrine jaïniste, il devient positif dans la conception de la non-violence selon Gandhi. Dépassant le contexte d’une mystique non violente, celui-ci situe le concept d’ahimsa dans le cadre de l’action intersubjective. « J’accepte l’interprétation d’ahimsa, écrit Gandhi, en tant qu’il n’est pas un état négatif de la non-nuisance, mais un état positif d’amour et du bien même à l’égard de celui qui fait le mal. Mais cela ne signifie pas qu’il faille aider le fauteur de mal à faire le mal ou le tolérer par un consentement passif. Au contraire, l’amour, l’état actif de l’ahimsa, vous demande de résister à celui qui fait le mal en vous dissociant de lui, même s’il est offensé ou blessé physiquement. »
Gandhi ré-interprète donc la doctrine classique de l’ahimsa en tenant compte de l’exigence du monde moderne. En élargissant le noyau prophétique de cette notion telle qu’elle a été prescrite par le jaïnisme, le bouddhisme et l’hindouisme, il l'inscrit dans une expérience historique exceptionnelle. L’ahimsa devient une force active d’altérité, qui opère une véritable percée historique en tant que mouvement de masse. L’originalité de la non-violence gandhienne vient de ce qu’elle est à la fois morale et politique, même si le politique y est dominé par le religieux.
C'est ce qu'enseigne Jésus dans : « aimez vos ennemis ». Ce n'est pas répondre à nos ennemis qui nous veulent du mal, dans ou par la passivité face au mal, mais de répondre au mal par une autre force qui celle de l'Amour, Amour qui vient de Dieu.
Conscient de la nature « spirituelle » de sa non-violence, Gandhi oriente néanmoins celle-ci dans le sens d’une stratégie politique et fixe les conditions pratiques de sa construction. Tout progrès vers la non-violence est défini comme un pas vers la moralisation du politique. Pour lui, pratiquer la non-violence signifie qu’on veut donner un sens moral à la vie communautaire. Mais l’exigence morale commune d’une action non violente ne peut être que celle d’une réalité politique. L’efficacité d’un mouvement de masse oblige Gandhi à envisager le rapport de la fin et des moyens sous un angle stratégique. Le point d’ancrage de l’ahimsa dans sa pensée n’est pas uniquement, comme chez le mystique jaïn ou bouddhiste, le sujet solitaire face à sa conscience, mais aussi le rapport d’intersubjectivité replacé dans la visée des pratiques non violentes à mettre en œuvre. Ce qui l’intéresse, c’est la pluralité des consciences et non la figure solitaire de la conscience dans l’histoire. Par un geste historique sans précédent, Gandhi sort la non-violence de son isolement mystique pour la doter d’un dynamisme de transformation sociale : elle devient à la fois une manière d’être et un mode d’action. Il a su reprendre l’exigence éthique de la non-violence (telle qu’elle est reconnue par les religions et les philosophies) et la situer au niveau d’une stratégie politique. Des non-violents comme Martin Luther King, Vinoba Bhave, Abdul Ghaffar Khan, Lanza del Vasto, le Dalaï-Lama et Desmond Tutu ont eu l’immense mérite de recommencer cette entreprise. Pour eux, comme pour Gandhi, le combat non violent pour la justice et la démocratie est une exigence éthique qui répond à une conviction religieuse, mais qui est aussi capable de renouveler la chose publique sous forme d’une stratégie sociale.
Caractérisée par le courage, l’amour de la liberté et la maîtrise de soi, la non-violence est à l’opposé d’une attitude statique et immobile. Créatrice, agissante, elle peut accélérer la dynamique de la société, favoriser la justice et la démocratie. Elle traverse de façon étonnante toutes les grandes religions comme si elle était inscrite en gène au cœur de celles-ci. Nos sociétés actuelles ont grand besoin de ce dynamisme-là pour se libérer de l’emprise de toutes les formes de violence (politique, économique, culturelle et sexuelle) qui privent les hommes et les femmes de leur droit à la parole, voire à la vie, et en ce sens la religion au plan spirituel du terme est la clef. La réussite de la non-violence, c’est aussi celle du débat démocratique, c’est-à-dire un échange de paroles entre citoyens pour décider d’un avenir commun. Car, comme disait le philosophe Eric Weill : « La non-violence, dans l’histoire et par l’histoire, est devenue le but de l’histoire et est conçue comme son but. »
LAO-TSEU ET LE TAO
Il serait difficile, et parfois même impossible de comprendre la civilisation chinoise sans se référer au Tao Te Ching. Ce traité, le plus ancien du taoïsme, a été écrit à une époque (probablement entre le VI siècle et le IV siècle avant J.-C.), où la Chine était menacée par une situation chaotique due à la lutte sanglante qui opposait les seigneurs féodaux. On peut donc y voir une réaction aux données de son temps ; dès lors on comprend mieux pourquoi on y trouve des passages où son auteur présumé, Lao-tseu, critique sévèrement les pratiques politiques en cours, par exemple au chapitre 75, où il affirme : « Le peuple est affamé lorsque le souverain prélève trop de taxes. C’est pour cela que le peuple a faim », ou encore au chapitre 74 : « Le peuple ne craint pas la mort. Pourquoi l’en menacer ? » Les nombreuses réflexions contestataires de Lao-tseu ont amené ses interprètes à voir en lui un rebelle à l’ordre établi. Cette interprétation n’est pas entièrement fausse. Il ne faut pas oublier que tout au long de l’histoire de la Chine, le taoïsme a été considéré comme la philosophie d’une minorité de personnes qui se regroupèrent en sociétés secrètes pour combattre le pouvoir en place. En cela, le taoïsme s’oppose aux principes confucéens de la discipline et du devoir.
Dans la philosophie du « Tao » l’accent porte sur la spontanéité et sur l’harmonie avec la Nature. Le Tao ne préconise aucune action à l’égard du monde, mais « il aide toute chose à suivre sa nature ». Il entend donc être profitable à toute chose, mais sans esprit de rivalité. Il est accomplissement, mais n’est pas orgueilleux de ce qu’il accomplit. Le Tao pour Lao-tseu est la « mère » de toute chose, mais aussi l’« ancêtre » de tout ce qui existe. C’est pourquoi en substance il est indivisible, inaudible et inépuisable. Il est l’unité qui se cache derrière la multiplicité de la vie : « Le Tao coule comme l’eau, soit à droite, soit à gauche. Tout ce qui est né dépend de lui et il ne refuse pas cette dépendance. »
Le Tao est sans nom ( Wou-ming) parce qu’il n’est pas une chose concrète. Il est également le non-être (wou), car « tout L’univers est né de l’Être, [mais] l’Être est né du non-être ». Le concept de non-être est une idée fondamentale dans la pensée du Tao. Pour Lao-tseu, L’Être et le non-être sont complémentaires ; il y a, dans la réalité, de l’Être comme il y a de la diversité ; mais l’un et l’autre émanent du non-être, c’est-à-dire du Tao. Affirmer que le Tao est le non-être ne confère au Tao aucun caractère négatif. Le non-être, c’est le vide, l’absence des qualités percevables par les cinq sens, mais c’est aussi l’état que peut atteindre le sage taoïste lorsqu’il pénètre dans le Tao. Lao-tseu décrit ainsi le non-être : « Il faut trente rayons à une roue de chariot. Mais l’utilité de la roue réside dans son espace vide. On pétrit de la pâte pour faire un vase, mais l’utilité du vase réside dans son espace vide. On cisèle des portes et des fenêtres pour faire les chambres d’une maison. Mais l’utilité de la maison réside dans son espace vide. Ainsi l’Être est avantageux. Le non-être est utile. » Le sage taoïste ne peut atteindre le bonheur qu’en abandonnant ses désirs égoïstes. Autrement dit, il doit éviter l’extrême, l’extravagant et l’excessif. Il doit aussi laisser derrière lui tout esprit de rivalité et les choses qui ont un rapport avec les sens, car affirme Lao-tseu, « les cinq couleurs aveuglent l’homme et les cinq sons l’assourdissent ». La vertu cardinale, pour le sage, consiste à pouvoir créer sans s’enorgueillir de sa création et sans vouloir non plus se l’approprier.
Le Tao Te Ching invite les hommes à prendre le chemin d’une vie simple, paisible et sobre ; une vie où il n’y a aucune trace de pouvoir, de notoriété et de richesse. Le sage doit chercher les « trois trésors » : la bonté, la frugalité et le manque d’ambition. De cette façon seulement il deviendra courageux, généreux et victorieux. La générosité et la bonté constituent des éléments clés de la vertu taoïste. Il faut leur adjoindre l’amour, car pour être en mesure d’atteindre le Tao, il est indispensable de savoir aimer la Nature et l’humanité tout entière. Le Tao Te Ching opte donc pour la voie de la non-violence : la seule manière de se venger c’est « en faisant le bien » Lao-tseu condamne la guerre : « Une bonne armée est un instrument de malheur, elle est détestée de tous les êtres, c’est pourquoi celui qui a le Tao ne tient pas à elle. »
Le Tao Te Ching occupe une place éminente dans la littérature de la non-violence ; Lao tseu est à cet égard l’un des précurseurs de la non-violence tout comme Jésus et Bouddha.
Quelques enseignements du : Tao Te Ching :
Le sage n‘a pas d’idées immuables il fait sienne les idées du peuple.Je traite avec bonté ceux qui ont la bonté, je traite avec bonté ceux qui sont sans bonté et ainsi je gagne de la bonté.Je suis honnête envers ceux qui sont honnêtes, je suis honnête envers ceux qui ne sont pas honnêtes, et ainsi je gagne de l‘honnêteté.
(Chapitre 49, trad. de Joseph Liu)
L'Évangile du Bouddha
La doctrine du Bouddha repose sur quatre nobles vérités : vérité sur la douleur, vérité sur l’origine de la douleur, vérité sur la cessation de la douleur, et vérité sur le chemin qui mène à la cessation de la douleur. Toute vie est douleur et souffrance. L’être vivant souffre parce qu’il est dépendant de son « Soi ». À l’origine de la douleur se trouve le désir du « Soi » : un attachement au monde, qui constitue la force appelée Karma, lequel n’est pas affectée par la mort et continue à vivre. C’est pourquoi il provoque le cycle des renaissances et oblige les êtres à la transmigration. Pour le Bouddha, il faut supprimer le désir afin de mettre un terme à la douleur et au cycle des renaissances. Aussi propose-t-il la destruction entière de toute pensée du « Soi », pour ouvrir la porte au Nirvana, un état qui se définit par l’extinction des passions. L’homme doit se purifier de tout égoïsme, de tout péché, en défiant toutes les formes du plaisir et du désir. Pour le bouddhisme, la haine, ainsi que la colère, sont des formes de désir. La colère de l’esprit donne naissance à la colère dans l’acte. Or, pour suivre la voie de la sagesse, l’homme doit avoir une pensée juste. Être injuste, selon le Bouddha, c’est être violent.En d’autres termes, la justice et la non-violence vont ensemble dans la philosophie bouddhique. La non-violence est la plus haute des vertus, car le Bodhisattva est un océan de patience et de tolérance.Il cultive l’amour pour ses ennemis et la compassion envers tout être vivant. « La haine est la plus violente des fièvres », dit le Bouddha et l’on peut résumer son évangile par le vers suivant, du Dhammapada : « Ne pas faire de mal, cultiver le bien purifier l’esprit. »
Le livre sacré du bouddhisme est le Tipitaka (littéralement « Les trois corbeilles »), constitué, comme l’indique son titre, de trois sections. La première, le Sutta Pitaka (la corbeille des discours), présente sous la forme de sermons et de dialogues toutes les vérités enseignées par le Bouddha. La deuxième, ou Vinaya Pitaka (la corbeille des codes), contient les règles pour les moines bouddhistes. La dernière section, ou Abhidhamma Pitaka, plus complexe que les deux premières, vise à analyser et classer tous les éléments qui constituent un être humain. Pour les bouddhistes, le Tipitaka rassemble les enseignements et les directions à suivre pour atteindre le « Nirvana ».
Quelques enseignements de Bouddha sur la non-violence
La vérité demeure cachée pour celui qui est tenu dans la servitude de la haine et du désir. C'est par des actes continuels de bonté que nous atteignons le chemin immortel, et c’est par la compassion et la charité que nous perfectionnons notre âme.
Ce n‘est pas par la haine que la haine s’apaise. La haine est apaisée par l'amour. Ceci est une loi éternelle.
Dix choses rendent mauvais tous les actes des êtres vivants, et leurs actes deviennent bons quand ils évitent ces dix choses. Ce sont trois péchés du corps, quatre péchés de la langue et trois péchés de L’esprit. Les trois péchés du corps sont : le meurtre, le vol et l‘adultère. Les quatre péchés de la langue sont : mentir, calomnier, injurier et parler inutilement. Les trois péchés de l’esprit sont : la convoitise, la haine et l’erreur. C'est pourquoi je vous donne ces commandements : ne tuez point, mais ayez du respect pour la vie. Ne volez point, ni ne dérobez, mais aidez chacun à posséder les fruits de son travail. Évitez toute impureté et menez une vie de chasteté.. Purifiez votre cœur de la malice, rejetez loin de vous la colère.
Vivons donc heureux, sans haine pour ceux qui nous haïssent ! Au milieu des hommes qui nous haïssent, vivons exempts de toute haine.
Que nul d'entre vous ne trompe autrui, que nul ne méprise autrui, qu'aucun par colère ou ressentiment ne souhaite nuire à autrui.
Un sot ayant appris que le Bouddha observait le principe de grand amour, qui commande de rendre le bien pour le mal, vint et l‘injuria. Le Bouddha demeura silencieux, plein de pitié pour sa folie. Cet homme ayant cessé ses injures, le Bouddha l’interrogea, disant : « Mon fils, si quelqu’un refuse d’accepter un présent qu’on lui fait, à qui ce don appartiendra-t-il » ?Et l’homme répondit : « Dans ce cas le présent doit appartenir à celui qui l’a offert, » « Mon fils, dit le Bouddha, tu m’as injurié, mais je refuse d’accepter tes injures et te prie de les garder pour toi. Ne seront-elles pas une source de malheur pour toi ?De même que l’écho appartient au son et l’ombre à la substance, ainsi le malheur accablera sûrement l’artisan du mal. »
L’insulteur ne répondit pas et le Bouddha continua : « Le méchant qui méprise un homme vertueux est semblable à celui qui lève la tête et crache vers le ciel ; son crachat ne souille pas le ciel, mais il retombe et salit sa propre personne » L’insulteur partit honteux, mais il revint et prit refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sanghaz.
LA BHAGAVAD-GITA
La Bhagavad-Cita est le livre le plus lu et le plus vénéré de la culture hindoue. Comme disait Rai Bahadur La Baijnath au début du siècle, elle est « pour l’hindou le livre des livres ». Mais la Gita a eu aussi beaucoup de lecteurs et d’admirateurs en Occident. Parmi les Occidentaux illustres qui l’ont lue, on peut citer Hegel, Schopenhauer, Emerson, Thoreau, Albert Schweitzer et bien d’autres penseurs et écrivains. Mais à quoi faut-il attribuer la renommée mondiale de ce livre ? Qu’est-ce que la Bhagavad-Gita ?
En quoi peut-on considérer ce texte comme l’une des sources historiques de la non-violence ?
La Bhagavad-Gita se présente comme une recherche de soi, sous la forme d’un dialogue dramatique. À chaque étape du livre, Krishna est conscient du conflit spirituel qui déchire l’âme d’Arjuna et il le guide vers le chemin approprié, pour qu’il puisse résoudre ses tensions internes. Krishna l’invite à ne pas tuer, mais à renoncer à son attachement aux fruits de l’action. À la suite de cette leçon, Arjuna apprend à maîtriser son action et ses émotions, sans quitter pour autant la scène de la bataille. Ce n’est pas parce que tout le dialogue entre Krishna et Arjuna se passe sur une scène de bataille que la Bhagavad-Gita est une œuvre de violence. Bien au contraire, la Gita plaide en faveur de l’ahimsa (la non-violence). En vérité, Krishna, à travers ses enseignements, rejette explicitement la violence et le mal envers autrui. De même, la doctrine morale de la Bhagavad-Gita ne s’applique pas seulement à la guerre fratricide décrite dans le Mahabharata, mais à toutes les guerres. Gandhi est de cet avis, puisqu’il considère la guerre d’écrite dans le Bhagavad-Gita est aussi Mahabharata comme « une allégorie sans aucune référence historique ». Point de vue que fait sien également Mahadev Desai : « la Bhagavad-Gita ne peut être considérée en aucune manière comme un dialogue historique ». Ce que Radhakrishnan confirme en soulignant à juste titre que dans la Bhagavad-Gita « on s’éloigne de plus en plus des échos de la scène de bataille pour s’approcher d’un dialogue entre Dieu et l’Homme ».
La non-violence est donc inscrite au cœur de la Bhagavad-Gita : le mot ahimsa y apparaît à quatre reprises (aux chapitres X,5, X111,7, XVI,2 et XVII,14). Toutefois, ce concept n’apparaît pas comme un impératif catégorique ; le noyau central du livre n’est donc pas le problème de la non-violence. La Gita n’en propose pas moins une philosophie qui renforce les fondements de la non-violence. L’essence de l’enseignement qu’elle dispense, c’est de pouvoir accepter l’action sans se soucier de ses fruits. Par là, elle invite le lecteur à choisir la voie de la transcendance spirituelle en se libérant de toute forme d’égoïsme et d’intérêt personnel. Or la non-violence fait partie des vingt-six qualités qui constituent le mode d’être de celui qui arrive à atteindre cet état de transcendance. Le message de la Gita est donc très clair. Que l’homme se libère du souci, car le souci et l’angoisse sont à l’origine du chagrin et de la tristesse. Il doit rester serein et tranquille. L’essentiel chez l’être humain n’est ni son corps ni ses sens, c’est son esprit, qui reste in-changeable et indestructible. D’où cette affirmation : « Croire que l’un tue, penser que l’autre est tué, c’est également se tromper ; ni l’un ne tue, ni l’autre n’est tué. » Il est donc plus juste d’affirmer avec Vinoba Bhave que si l’ahimsa (la non-violence) et le satya (la vérité) sont les deux buts du yoga ultime enseigné par Dieu à l’Homme dans la Gita, ce livre constitue l’un des fondements majeurs de la philosophie de la non-violence.
LE JAÏNISME
Selon le premier principe du jaïnisme, l’Homme est un être double : il est à la fois matériel et spirituel. Il n’est pas un être parfait, parce que son âme (jiva) subit le lieu que lui impose le Karma. Aussi passe-t-elle par diverses incarnations en parcourant le cercle des renaissances (samsara), tantôt sous une forme supérieure, tantôt sous une forme inférieure. Lorsque la matière exerce pleinement son influx, le Karma produit la totalité de son effet. L’univers, selon le jaïnisme, est divisé entre l’âme et la non- âme ou substance inanimée (ajiva). Toute la philosophie jaïniste est fondée sur l’interaction de ces deux principes. C’est l’interaction entre tout ce qui est vivant et tout ce qui est non vivant qui produit les éléments de la vie comme la naissance, la mort, etc.
Cinq substances inanimées s’opposent à l’âme : la matière, l’espace (akasa), le temps (kala), le dharma (la cause du mouvement) et l’adharma (la cause du repos). Ainsi sont définies les conditions générales de l’être. Mais comment la matière s’attache-t-elle à l’âme ? Le Karma, qui est de nature matérielle, s’attache à l’âme par un influx, ou asrava, et impose à celle-ci un lieu (bandha) en la soumettant aux renaissances successives (samsara). Pour que l’âme s’affranchisse de la matière, la loi morale doit lui en indiquer les moyens.
Les principes de la morale jaïniste sont contenus dans les cinq prescriptions ou commandements appelés les « vartas ». Ils doivent être respectés et appliqués en toutes circonstances. La première de ces interdictions, c’est le devoir strict de l’ahimsa (la non- violence). Pour les jaïnistes, ne pas tuer, c’est la loi suprême. Un moine jaïniste doit s’abstenir de mettre à mort tout être vivant, quel qu’il soit. Blesser, faire souffrir ou détruire les êtres vivants est considéré comme la faute la plus grave. Les sutras jaïnistes comme I’Acaranga-sutra et le Sustraksrtanga-sutra présentent à chaque page le meurtre (himsa) comme le péché majeur. « On ne doit ni tuer, ni commander, ni assujettir, ni faire souffrir, ni attaquer violemment aucune sorte d’être vivant », souligne l’Acaranga- Sutra 1(4,1,1).
Ce respect du moine jaïna pour la vie s’étend à toutes ses formes, qu’il s’agisse de l’homme, des animaux, des plantes, des eaux et même du feu. Il lui est interdit d’allumer le feu, car selon l’enseignement du Sustrakrtanga-sutra 1, (7,6) : « Allumer le feu, c’est mettre à mort des êtres vivants et éteindre le feu, c’est le tuer ; donc un homme sage qui se préoccupe de la loi n’allumera pas le feu. » Rejeter la violence par la bienveillance qu’on montre à l’égard de tout ce qui vit n’est pas suffisant ; il faut aussi s’abstenir de mentir et renoncer à toute forme de propriété. L’ahimsa est donc pratiquée par le moine jaïna sous une forme d’activité à la fois corporelle, mentale et verbale. L’ascète jaïna mène une vie errante. Il ne possède rien. Il n’allume jamais de feu. Il ne boit que de l’eau bouillie. Il marche toujours pieds nus et n’utilise jamais un moyen de locomotion pour ne pas blesser la terre. Son idéal ultime, c’est la réalisation de soi. Pour atteindre cet idéal, l’ahimsa est la loi suprême (ahimsa paramo dharma).
ZOROASTRE ET LE ZOROASTRISME
Le zoroastrisme est la religion la moins connue du monde. Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, il faut attribuer cette méconnaissance au nombre limité (200 000) de zoroastriens. D’autre part, les Occidentaux ont très souvent tendance à mélanger « Zarathoustra », le personnage de Nietzsche, et Zoroastre, le prophète et le fondateur du zoroastrisme. Enfin, très peu d’études non savantes ont été consacrées à cette religion. Un grand nombre d’ouvrages de référence écrits sur la religion de Zoroastre sont signés de la main des grands historiens des religions et des spécialistes de l’Iran antique. Ils sont pour la plupart épuisés et difficiles d’accès aux lecteurs moyens. Ainsi l’homme de la rue continue de considérer le zoroastrisme comme la religion du feu et les zoroastriens comme les adorateurs du feu. Or, bien que le feu soit un élément sacré dans la doctrine de Zoroastre, il faut éviter de s’en tenir à une telle généralité qui a pour effet de minimiser l’importance philosophico-morale de cette religion. En effet, d’une part celle-ci a exercé une grande influence sur la pensée grecque et le néo-platonisme, et quelque part juive et chrétienne. D’autre part, on peut la considérer comme une source fondamentale de la pensée de la justice et de la non-violence. Prophète de réforme et d’action, et non pas du renoncement et du repos, Zoroastre n’en est pas moins intégralement un prophète de la paix et de l’espoir.
Cette religion est fondée essentiellement sur une vision dualiste du monde, qui répartit l’organisation du divin dans l’univers en deux camps : d’une part le Bien, symbolisé par le Seigneur Sage, Ahura Mazda, qui incarne la vérité et la lumière ; d’autre part le Mal, qui représente les ténèbres, la destruction et l’injustice. Cette religion donne une grande place aux idées du Bien et de la Justice. Celle-ci n’est pas uniquement une affaire humaine, puisqu’elle s’applique aussi aux animaux (comme le montre l’exemple du bœuf - sixième extrait - qui adresse une plainte aux Seigneurs Immortels contre la cruauté des hommes).
SAADI : l’humanisme musulman
Pour beaucoup de nos contemporains l’islam incarne à l’heure actuelle une religion de la violence et de l’intolérance. Il est pour le moins erroné de juger hâtivement que l’expérience non violente manque dans la religion musulmane sans examiner les traditions mystiques arabes et iraniennes, qui ont marqué de leur empreinte les mouvements non violents à l’intérieur du monde islamique. Certes, il faudrait plus qu’un livre et sûrement plus qu’une vie pour parler de ces traditions. J’ai pris néanmoins la liberté d’évoquer une grande figure de la tradition mystique iranienne, le poète Saadi, pour symboliser les tendances de l’humanisme musulman. Car, comme disait W.A. Clarton : « Saadi a été assurément l’un des génies les plus doués de tous les temps. »
Saadi, de son vrai nom, Sheikh Musleh-ed-din ou Mocharef-ed-din Chiraz, né autour de l’année 1200 dans la ville de Chiraz, avait pour père un dignitaire de la cour de Muzaffar-al-din Takla ibn Zangi, troisième atabek de la province de Fars. Contemporain du règne de Genghis Khan en Asie, il a vécu sous le règne de la dynastie des Il Khanian en Perse ; les premières étapes de son éducation se déroulèrent à l’Université Nezamiyeh de Bagdad, établissement fondé par le grand vizir Nizam-ol-Molk. C’est à Bagdad qu’il a rencontré Abol Faraj ibn Jauzi et le grand Sheik Shahabeddine Sohrevardi. C’est aussi à cette époque qu’il s’est initié au soufisme de l’école Nagshbandie et a été subjugué par les paroles de Najmeddine Kobra de Nagshbandie. Grand voyageur, Saadi visita la Chine, l’Inde, la Turquie et le Maroc. Dans son œuvre majeure, le Gofestan (Le Jardin de Roses), il fait allusion à ses voyages. Ce recueil en prose mêlé de vers a été rédigé en 1258, deux ans après le retour de Saadi à Chiraz, époque à laquelle il écrivit également le Boustan (Le Verger), un recueil en vers. Le Golestan est inspiré essentiellement par les idées mères de la pensée soufie. Ce livre, conçu sous la forme d’un traité moral, pose des questions sur la conduite de la vie. Outre une introduction et une conclusion, il contient huit chapitres. Les deux premiers les plus longs, s’intitulent : « Du caractère et de la conduite des rois » et « De l’éthique des derviches ». Les six autres chapitres sont respectivement : « Des vertus du contentement », « Des avantages du silence », « De l’amour et de la jeunesse », « De la faiblesse et de la vieillesse », « De l’effet de l’éducation » et «De la conduite de la société. »
Le style clair et limpide, l’esprit rigoureux, ironique et didactique du Golestan ont contribué à la célébrité de Saadi : cette œuvre (plus que le Boustan) est lue et relue depuis 700 ans dans le monde entier. Nombre de grands auteurs des XVIII et XIX~ siècles citent Saadi : Goethe, Heine, Renan, Hugo, Pouchkine ou Sir Edwin Arnold. Adulé par les trans-cendantalistes américains comme Emerson et Thoreau, son nom apparaît dans quelques-unes de leurs œuvres. Dans son Journal, Emerson écrit : « La race humaine s’intéresse à Saadi, [car] Saadi est le poète de l’amitié, de l’amour, de l’héroïsme, du don de soi, de la bonté, de la sérénité, et de la divine Providence. »
L’amour chez Saadi est de nature mystique : il vise à l’union (wasl) avec le Bien-Aimé, qui est Dieu. Quand Saadi parle du vin, de la taverne, et du libertinage, il faut entendre par là l’ardeur et la dévotion d’un soufi aspirant à Dieu. C’est sans doute pourquoi il critique dans le Golestan la pseudo-pitié qu’affichent ceux qui prétendent être des derviches sans l’être vraiment, comme dans le conte 6 du chapitre II : « Ô toi qui exposes tes vertus dans tes mains ouvertes, et dissimule tes vices sous tes vêtements, Que comptes-tu acheter, homme plein d’illusion, le jour où tu seras dans le besoin, avec un argent faux ».
Mais il critique aussi l’égoïsme et la violence : Saadi est le poète de la générosité et de l’altruisme. Toute la première partie du Golestan est constituée de conseils au roi pour qu’il abandonne la voie de la violence et de la tyrannie. Ainsi, dans le conte 6 du chapitre 1 : « Le Roi qui suit la voie de la tyrannie fait de son meilleur ami un ennemi, le jour où il lui serait utile. » Et dans le conte 11 53 du même chapitre : « Ô vous qui tourmentez vos sujets. Combien de temps serez-vous capable de régner ? »
Saadi invite les hommes à ne pas se réjouir de la destruction de leurs ennemis, car la vie n’est pas un don éternel : « Je ne me réjouis pas de la mort d’un ennemi, écrit-il, puisque ma propre vie n’est pas éternelle » Il estime qu’il faut faire la paix avec ses ennemis, car les hommes sont « issus de la même source ».
La brève conclusion du Golestan, où il affirme ne pas avoir suivi la coutume de citer ses prédécesseurs, est complétée par une apologie : « Si mes conseils ne frappent pas d’oreilles sensibles, le messager a porté le message ! Ô lecteur, implore la miséricorde de Dieu pour l’auteur et pour le possesseur. Pour toi-même, recherche le bien, et ensuite le pardon pour le scribe. »
Saadi est mort vers l’an 1290 à Chiraz. Son mausolée est devenu un lieu de pèlerinage pour les mystiques et les amoureux de la poésie persane.
Ajouter un commentaire